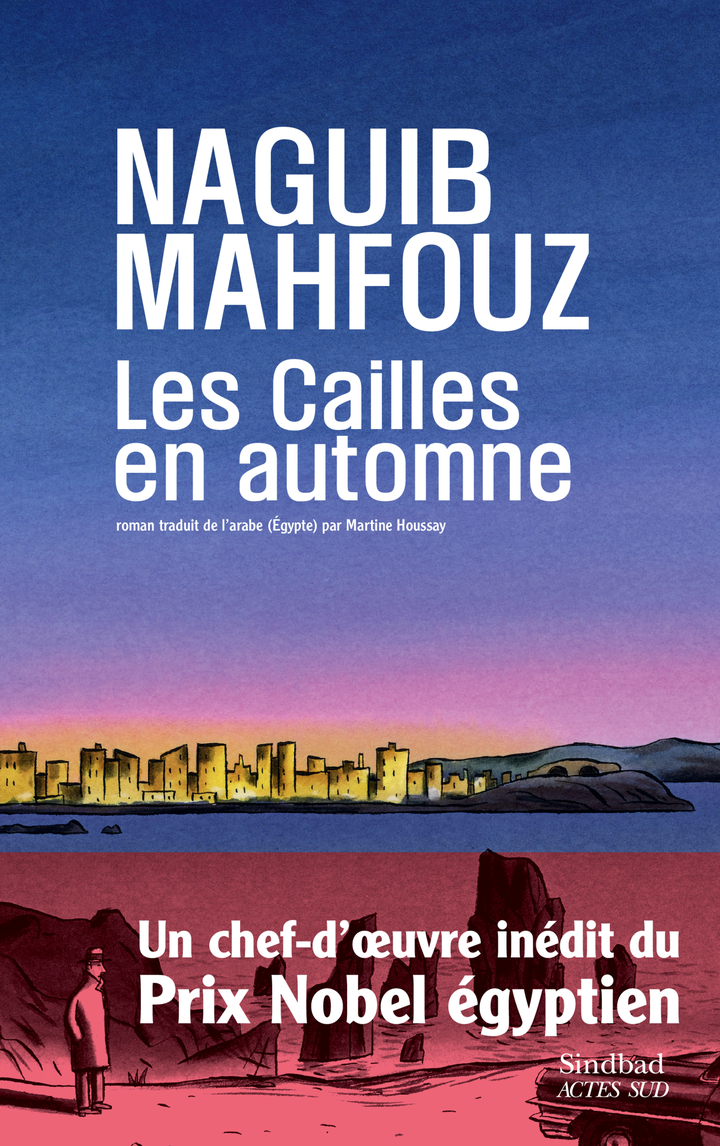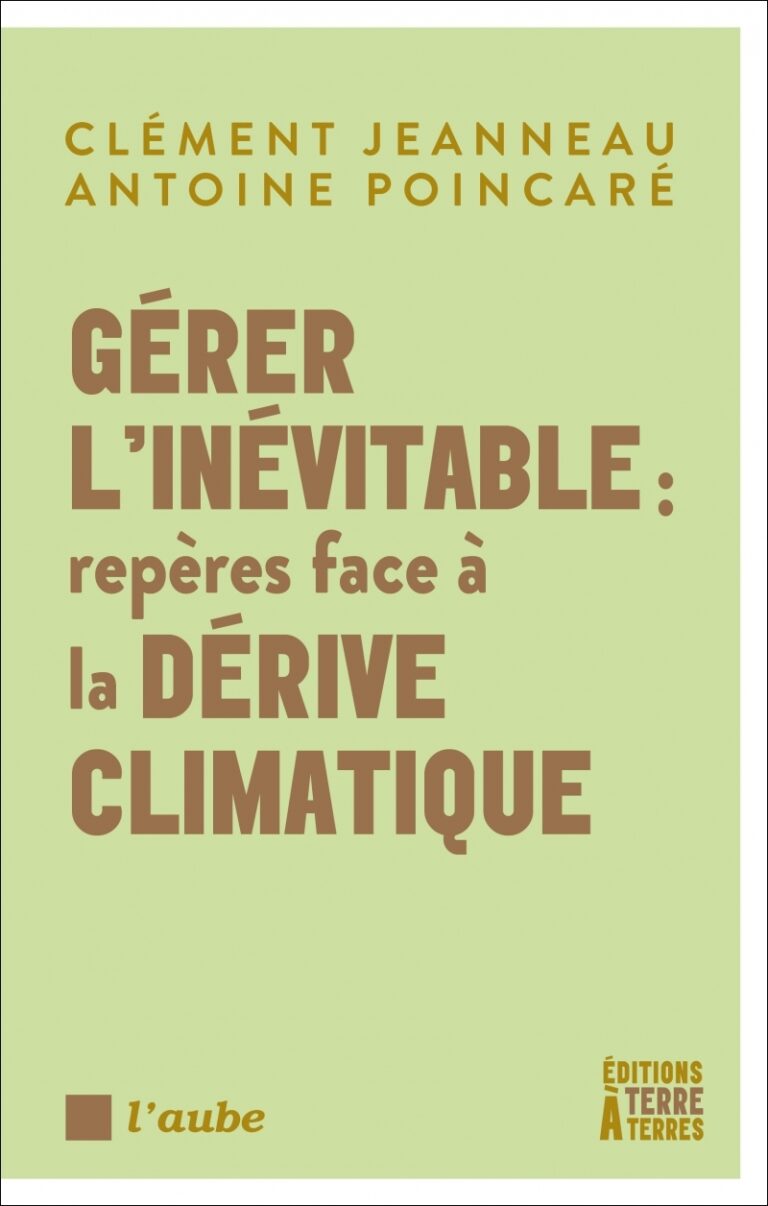C’est en 1945 que deux fellahs égyptiens découvrirent par hasard dans une grotte sur la rive sud du Nil, non loin de Nag Hammadi, un ensemble de treize codex de papyrus conservés depuis le IVe siècle dans une jarre enfouie dans le sol. Ces textes, pour la plupart gnostiques, d’une importance capitale pour la compréhension du christianisme primitif sont restés longtemps ignorés du grand public, sinon inaccessibles pour lui, et aujourd’hui encore le silence qui les entoure maintient largement les chrétiens dans la méconnaissance de leur contenu. Si “l’Évangile de Thomas” a fini par gagner une certaine, quoique relative, notoriété, il n’en va pas de même pour “L’Évangile de Philippe”. Édité dans la version copte originale par Walter C. Till en 1963, puis traduit en français par Jacques Ménard en 1967, celui-ci est longtemps resté réservé à quelques cercles d’érudits. Il faut donc savoir gré à Jean-Yves Leloup de mettre à disposition de tous cette nouvelle traduction particulièrement percutante d’un texte aussi magnifique que profond.
On sait que c’est à partir du Concile de Nicée en 325, puis de l’Édit de Thessalonique en 380, que l’Église, par la volonté des empereurs Constantin et Théodose Ier, a figé le credo et imposé la croyance en Jésus “fils unique de Dieu” qui, dans le pluralisme ecclésial des origines, n’était pas partagée par toutes les communautés. Ce dogme de la filiation unique procédait d’une lecture littérale des épîtres de Paul et de l’Évangile de Jean. Avec lui, l’expression “fils de Dieu” était prise au pied de la lettre bien que Jésus n’en ait à aucun moment revendiqué le statut. Composé entre les IIe et IIIe siècles, L’Évangile de Philippe nous rappelle qu’il existait une autre conception du message christique. Selon elle, la filiation divine devait se concevoir non comme état civil, mais comme métaphore. Elle désignait la condition de celui qui, disciple du Christ, atteignait à la connaissance de Dieu par une métanoia, une transformation intérieure. Dès lors, tout chrétien était appelé à devenir fils de Dieu, une idée que l’Église Orthodoxe, échappant à la sécheresse du juridisme romain, a su préserver grâce à sa doctrine de la déification (theosis).
Dans cette logique, la résurrection prenait une tout autre signification : “Ceux qui disent que le Seigneur est mort d’abord et qu’il est ressuscité ensuite se trompent, car Il est d’abord ressuscité, Il est mort ensuite. Si quelqu’un n’est pas d’abord ressuscité il ne peut que mourir” (21, 1-3). Or, cette résurrection dans la vie, supposant préalablement une mort à soi-même, était promise à chacun comme le cœur de l’expérience chrétienne, comme la condition et le moyen de sa transformation spirituelle. Au terme de celle-ci, le disciple pouvait atteindre la plénitude (plerôma) par insufflation du pneuma divin, c’est-à-dire de l’Esprit. Le centre de gravité de l’espérance n’était donc pas situé dans un au-delà supposant un acte de foi, mais dans un présent impliquant une ascèse : “Il te faut t’éveiller dès ce corps, car tout est en lui : ressusciter dès cette vie” (23). Cette lecture éclaire bien des passages obscurs et contradictoires du Nouveau Testament et donne tout son sens au propos sur “l’homme nouveau” par lequel Paul de Tarse exhortait les Éphésiens à abandonner le vieil homme pour renaître.
La voie de connaissance spirituelle, voilà donc la question centrale de ce document exceptionnel. Si certaines clefs de compréhension nous manquent faute d’une tradition vivante qui ait pu préserver la chaîne de la transmission, d’autres – comme la symbolique de la chambre nuptiale, de l’étreinte, du baiser – sont directement évocatrices. Elles soulignent l’importance de l’union amoureuse comme voie mystique et attestent que les premiers chrétiens n’ignoraient pas le concept de réunification des pôles masculin et féminin, conçue comme rétablissement d’un état primordial et bien connu du taoïsme, du tantrisme ou du pythagorisme. Ce n’est pas la seule surprise que réserve cet évangile apocryphe qui ne concède rien au merveilleux, au miraculeux ou au légendaire et se révèle étonnamment proche de la non-dualité vedantine. Par endroits, le lecteur familier de l’Orient pourra avoir le sentiment que les traditions par-delà les siècles se répondent. “Seul Yeshoua [Jésus] connaît la fin du devenir de tout ce qui devient” (107,6). Ce verset, par exemple, n’est pas sans évoquer ceux de l’Isha-Upanishad, un texte hindou trois fois millénaire : “Celui qui connaît à la fois le devenir et le non-devenir transcende la mort grâce au devenir et parvient à l’immortalité grâce au non-devenir” (14). Pour aborder cet évangile, il n’est pourtant pas besoin de connaître tous les textes sacrés, car c’est l’un des grands mérites de cette traduction de nous le rendre immédiatement accessible. Quant à l’amateur de philosophie, il ne sera pas déçu non plus. Jean-Yves Leloup, homme cultivé et espiègle, ne fait-il pas débuter sa traduction par un “devenir ce qu’on est” qui vole la vedette à Nietzsche ?
Philippe SÉGUR
contact@marenostrum.pm
“L’Évangile de Philippe”, Albin Michel, “Espaces libres. Spiritualités vivantes”, traduit et commenté par Jean-Yves Leloup, 25/11/2020, 1 vol. (206 p.), 8,90€
Retrouvez cet ouvrage chez votre LIBRAIRE indépendant près de chez vous et sur le site de L’ÉDITEUR