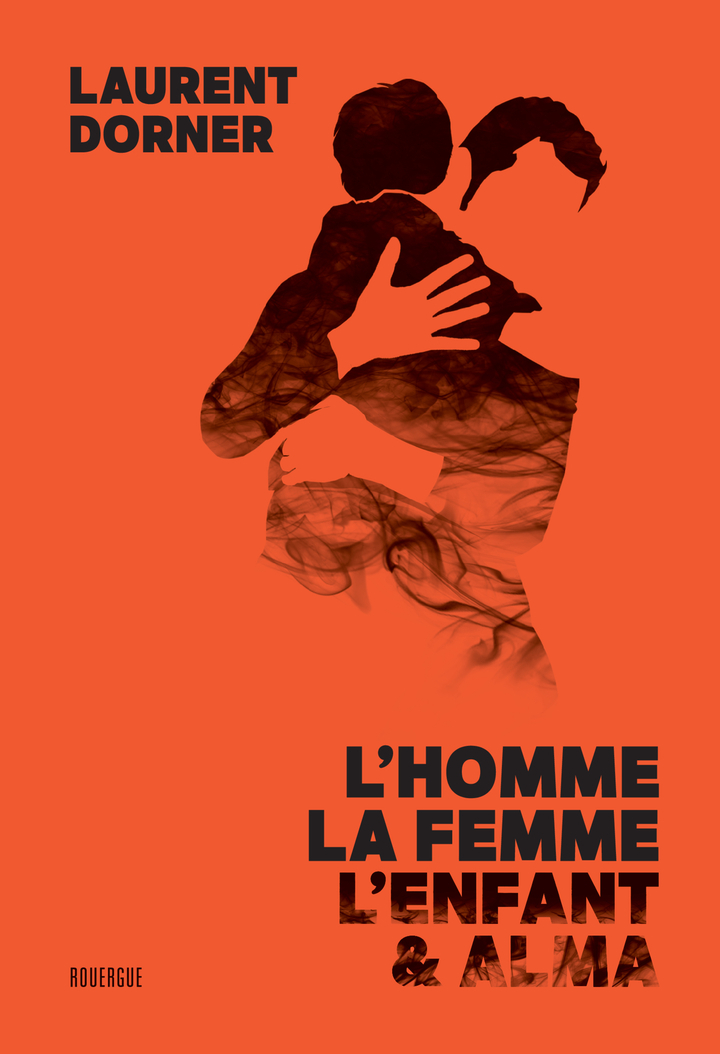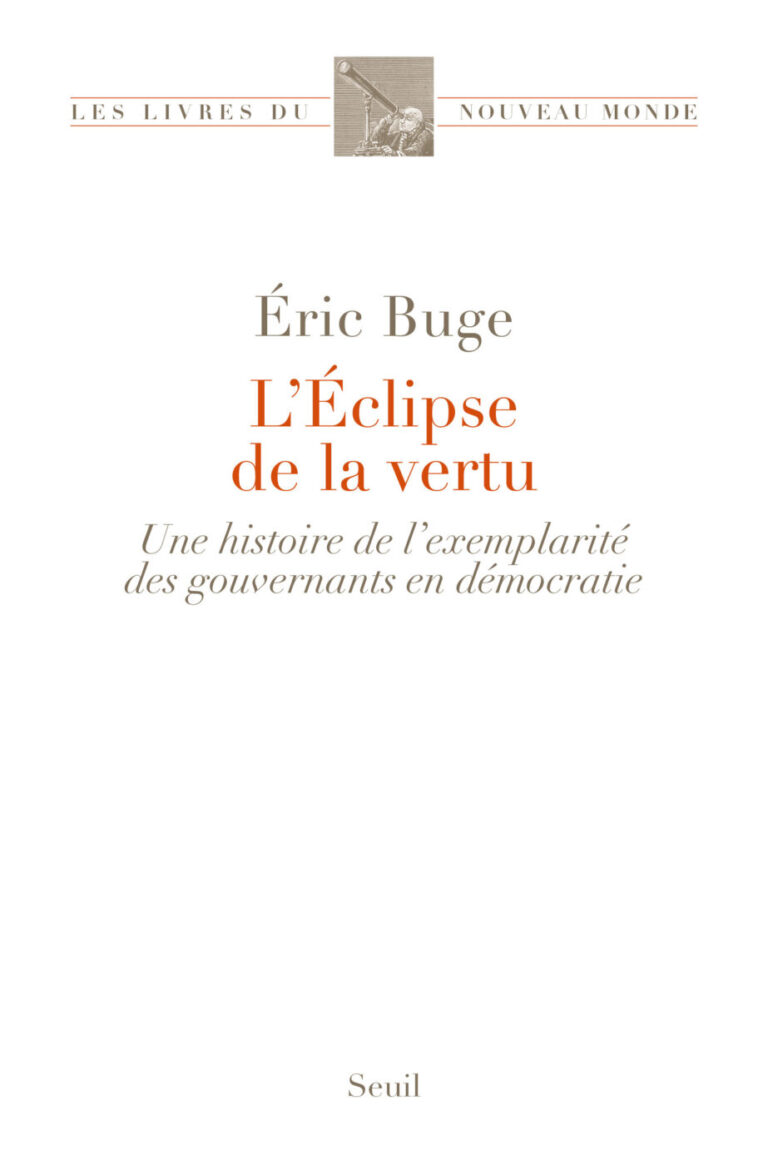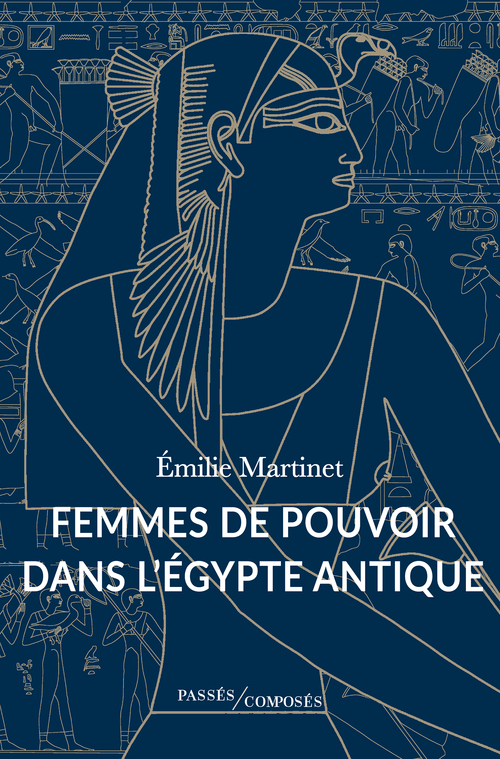Philippe Comar, Le lien et la grâce, l’Atelier contemporain, 21/11/2025, 464 pages, 28.00€
Au milieu du mois d’octobre 2025, le plus célèbre musée parisien s’est brusquement retrouvé sous le feu des projecteurs. Sur toutes les chaînes d’information, il n’était question du matin jusqu’au soir que du Louvre et du vol spectaculaire de huit bijoux royaux. Les polémiques n’ont d’ailleurs par tardé à pleuvoir : journalistes et représentants politiques s’indignant des failles de sécurité et cherchant dans la foulée des boucs émissaires. Rien n’aura été épargné au téléspectateur sur l’épaisseur des vitrines, la position des caméras de vidéo-surveillance, en passant par l’état des huisseries. Certains ont même émis l’idée de remplacer les œuvres originales par des copies afin de les protéger… Pourtant, au cours de cette bavarde séquence médiatique, où la sécurité était sur toutes les lèvres, on a rarement parlé d’art, et encore moins de l’institution muséale en tant que formidable espace de confrontation et de dialogue entre les œuvres et les artistes.
La publication par les éditions de L’Atelier Contemporain d’un recueil de textes du plasticien et romancier Philippe Comar, tombe à point nommé et permet de stimuler intelligemment la réflexion à travers un voyage dans l’histoire de l’art des plus enthousiasmants.
L’art comme sismographe des bouleversements intellectuels
Dans une première partie consacrée au “mythe de l’origine“, l’auteur rappelle d’ailleurs un slogan du jeune Paul Cézanne : “Il faut brûler le Louvre !“, saillie iconoclaste que l’artiste reniera d’ailleurs à l’âge de la maturité. Mais à la fin du XIXe siècle, cette condamnation des musées et l’appel à la destruction des chefs-d’œuvre de l’art classique n’ont rien d’un cri isolé et apparaissent même comme un marqueur de la modernité. Pour l’avant-garde occidentale, l’art archaïque devient à cette époque l’archétype de l’art, en réaction contre l’académisme. On veut retourner aux sources, que ce soit dans l’exaltation de l’art primitif, préhistorique ou même les dessins d’enfants. Philippe Comar s’attache à démontrer que ces postures ne tombent pas du ciel des idées mais sont la manifestation artistique de bouleversements intellectuels plus larges, dans le champ scientifique notamment. “L’histoire de la modernité est intimement liée au séisme provoqué par L’Origine des Espèces [de Charles Darwin] qui, ayant privé l’humanité de toute transcendance, a réveillé en elle l’angoisse existentielle de sa propre finitude et par contrecoup, l’obsession de sa genèse”. Un chapitre montre d’ailleurs les liens très forts qui existent entre art et science, à travers la figure méconnue de Mathias Duval, qui a enseigné les théories darwiniennes à l’École des Beaux-Arts de Paris. Le peintre Gustave Moreau, de son côté, s’est inspiré des planches de créatures aquatiques (algues, méduses, coquillages…) du biologiste Ernst Haeckel dans ses compositions symbolistes. La théorie de l’évolution influence jusqu’au cours d’anatomie et aux représentations du corps. En effet, on passe du modèle de l’être humain parfait et immuable – tel que symbolisé par l’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci – à un être davantage hybride et changeant. Ce n’est pas pour rien que le XIXe siècle voit l’essor des caricatures qui « étirent, allongent, compriment, défigurent » les visages et les corps.
Un voyage inspirant et inspiré à la rencontre d’œuvres et d’artistes
Philippe Comar, qui a été commissaire d’expositions, ne s’adresse pas à un public étroit d’initié, mais dans une langue claire, avec un souci didactique louable, invite le lecteur à explorer à ses côtés les thèmes qui lui sont chers, comme la représentation du corps, la question de la nudité et de la sexualité dans l’art. Loin d’entretenir le mythe du créateur isolé dans sa tour d’ivoire, l’approche historique adoptée permet de mieux saisir les interactions entre les artistes et le milieu dans lequel ils évoluent. Il postule la nécessité de “réinterpréter les ruptures qu’égrène l’histoire de l’art comme autant de tentatives menées par les artistes de créer de nouveaux points d’ancrage dans la société, c’est-à-dire comme une manière de relier les œuvres d’art à leur milieu, afin qu’elles prennent – à l’instar des statues de Dédale enchaînées à leur socle – toute leur valeur.”
La variété des textes et des approches est l’une des grandes forces de cette anthologie. On trouve tout à la fois des réflexions théoriques générales et des études plus spécifiques sur certains artistes majeurs (Pierre Bonnard, Egon Schiele, Lucian Freud) ou moins connus comme le sculpteur animalier Antoine-Louis Barye. Philippe Comar, qui est par ailleurs un écrivain de talent, a un sens aigu de la description. Son style d’une grande puissance évocatrice, avec la recherche constante de l’adjectif juste, donne à voir et à sentir les œuvres, notamment celles qui n’ont pu être reproduites et n’a rien à envier aux meilleurs pages des Salons de Baudelaire ou aux écrits esthétiques de Marcel Proust.
Le regard passionné de l’esthète cède parfois a place à des chapitres à la tonalité plus autobiographique. Dans “Le bocal et le vase”, Philippe Comar offre une réflexion intime sur le monstre à travers des souvenirs de la visite du musée d’anatomie Dupuytren, célèbre pour ses bocaux remplis de formol où flottent des fœtus difformes – et une lecture personnelle et sensible de L’Homme qui rit de Victor Hugo.
Le lien et la grâce, au-delà de la pertinence des textes qui le composent, est un magnifique ouvrage, d’une grande élégance formelle et servi par une iconographie de qualité. En ces temps où l’on préfère débattre des alarmes et de la sécurité des musées, le livre de Philippe Comar s’impose comme une lecture nécessaire pour réapprendre à considérer l’art, non comme de simples trésors matériels à protéger, mais comme une matière en mouvement, faite de liens subtils et de dialogues permanents.