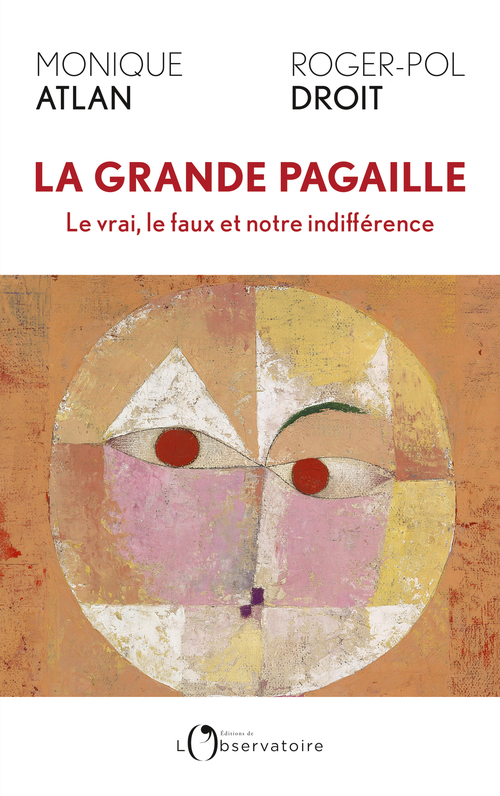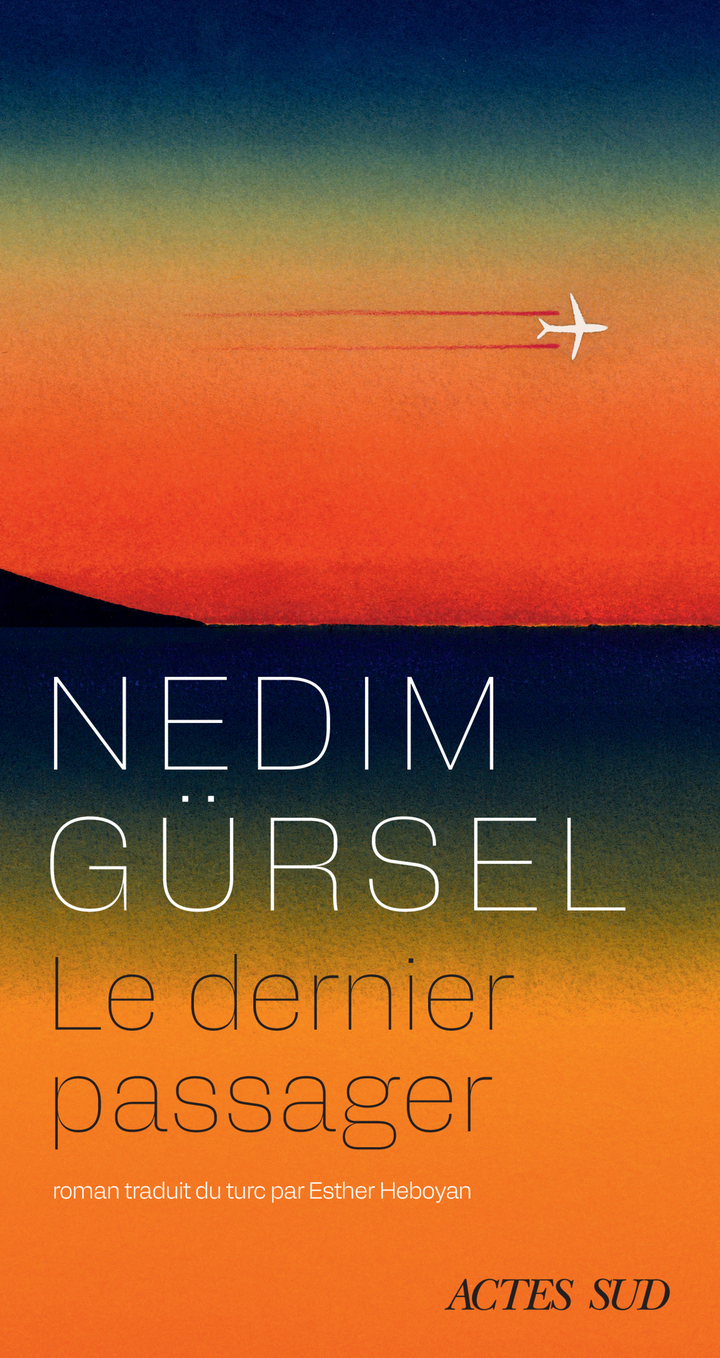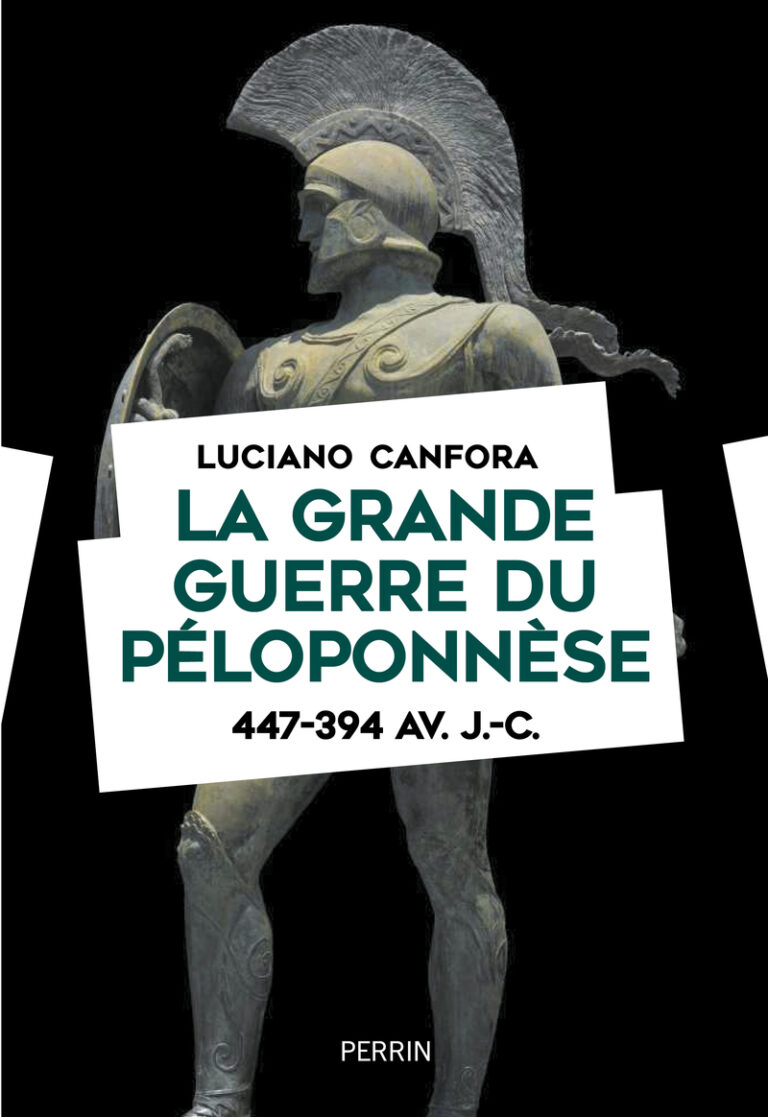Blanchard, Joël, Poétiques de l’amour : sexualité, genre, pouvoir : XIe-XVe siècle, Passés composés, 20/04/2022, 1 vol. (333 p.), 22€.
Poétiques de l’amour s’attache à étudier l’histoire de notre discours amoureux pendant un millénaire, depuis la théologie jusqu’aux formes les plus sophistiquées de fin’amor. Il reprend l’étude amorcée par John Baldwin sur le sujet en la menant jusqu’au XV è siècle, et constate que le fondement des croyances sur le sexe et l’amour relève autant de la mythologie que de la religion chrétienne.
La démarche de l’auteur
La glose des textes antiques ou bibliques apparaît à l’origine des divers discours sur l’amour. Le Moyen Âge a connu plusieurs renaissances intellectuelles. Les clercs, plus particulièrement, ont formalisé et enrichi le discours amoureux, un discours non linéaire, que caractérise un équilibre instable, entre inventivité et mouvements antagonistes qui entrent en concurrence. La fiction ouvre le champ des possibles et pose la question du locuteur, lorsque le poète se dissimule sous divers masques. Dans sa démarche, Joël Blanchard s’écarte des travaux de Duby pour privilégier l’apport de la sociologie allemande, qui met en évidence le lien entre la matière amoureuse et les transformations féodales. Il estime que dans le domaine de ce discours, la fiction s’avère tout aussi éclairante que les traités de médecine. Il se réfère également aux études de genre, qui conçoivent la féminité et la masculinité comme une construction sociale. L’histoire de la sexualité apparaît liée au politique. Joël Blanchard prend toutefois des distances avec les études historiques ou sociologiques, en choisissant une approche littéraire qui « met l’accent sur les aspérités, les turbulences, les résistances, les formes de restauration ou de réactivation à partir desquelles se construit le discours amoureux dans l’imaginaire médiéval. »
Matrices et modèles
Joël Blanchard constate l’impossibilité d’un compromis entre mythologie antique et christianisme. La théologie paulinienne, centrée sur la virginité et la chasteté, constitue le point de départ de la réflexion médiévale sur l’amour, en cristallisant divers courants intellectuels. Renoncement aux plaisirs de la chair, dénonciation de l’homosexualité et préférence marquée pour le célibat caractérisent cette pensée. Si l’abstinence est préférée, le mariage n’est toutefois pas exclu, mais se conçoit comme indissoluble et monogame. Les convictions de Saint Paul s’ancrent dans l’imminence de la Parousie. Il considère que le mystère de l’amour est réservé à la personne divine. Ses textes ont ouvert la voie à de multiples réflexions sur le sujet.
D’autres théologiens, comme Saint Augustin, envisagent la question de la concupiscence selon deux aspects : la première, exempte de péché, liée au désir d’enfant, la seconde, condamnable, ne revendiquant que les plaisirs de la chair. Mais, au XII è siècle, on constate un regain d’intérêt pour l’amour sensuel dans les ouvrages de philosophie et de cosmologie. Les écoles de Chartres reprennent les idées de Platon sur la question. Le plus proche de cette pensée reste Abélard. C’est ainsi que l’on assiste à l’émergence de deux tendances, amour mystique et amour courtois, qui semblent avoir éclos dans le voisinage de ce dernier. Le Cantique des Cantiques demeure le texte le plus commenté dans les monastères de l’époque, plus spécifiquement par Bernard de Clairvaux ou Aelred de Rievaulx. Tout aussi étudié, Les noces de Mercure et de Philosophie compile différentes formes de savoir antique et passionne le Moyen Âge. L’écriture poétique n’est plus envisagée comme une simple technique, mais dans la perspective du salut des âmes, ce qui permet à la poésie rythmique de s’imposer.
Au temps de la réforme grégorienne
Avec le pape Grégoire VII, l’Église renforce sa domination du monde séculier. Deux textes de Cicéron influencent la pensée de l’époque, De inventione et Rhétorique à Herennius. Geoffroy de Vinsauf adapte la rhétorique antique au christianisme, en particulier le procédé d’amplification. C’est en s’inspirant des courants puissants de l’hermétisme et du platonisme que Bernard Silvestre et Alain de Lille écrivent sur la sexualité. L’histoire qui fascine le plus est celle d’Héloïse et d’Abélard, devenue au fil du temps mythique. Ovide exerce aussi une influence prépondérante sur les écrivains de l’époque.
L’importance des troubadours dans l’élaboration du discours amoureux
Guillaume de Poitiers, Marcabru et d’autres auteurs-compositeurs inventent l’art d’aimer dans le sud de la France, à travers une ligne mélodique qui confère au texte sa dimension rythmique. Ils créent des genres : sirventès, pastorale, devinalh, etc. La plupart d’entre eux, issus de l’aristocratie, conçoivent l’amour sous la forme d’un engagement chevaleresque. Bernard de Ventadour, Jaufré Rudel projettent sur la fin’amor les structures de la féodalité. Le comportement amoureux obéit à la mezura (mesure), et ne conçoit l’amour que de loin. Les cinq sens organisent le parcours amoureux.
Savoirs de l’amour
Deux discours, l’un médical, l’autre théologique, traitent de l’amour. Le désir sexuel apparaît au centre de la pensée scientifique avec Albert le Grand, Roger Bacon et Saint Thomas d’Aquin. D’autres, comme Gilles de Corbeil, voient la femme comme un homme inversé. Ces recherches renforcent la signification des valeurs de la fin’amor, par un transfert de connaissance du monde des clercs à celui des laïcs. Les mythes grecs, comme celui de Pyrame et Thisbé, renforcent l’idée d’une quête amoureuse parsemée d’obstacles. Mais c’est Le Roman de la Rose, rédigé par Guillaulme de Lorris puis Jean de Meung, qui connaît une réception très importante, et les écrits de Christine de Pizan sur ce même roman, qui marquent le discours amoureux. En parallèle, le genre de la satire manifeste une misogynie violente. Elle s’exprime dans les fabliaux mais aussi chez des écrivains confirmés comme Rutebeuf. Joël Blanchard interroge également Le Décaméron et La bourgeoise de Bath, de Chaucer.
Amour de l’écriture
Les auteurs passent de l’amour à l’amour de l’écriture. Guillaume de Machaut, avec ses insertions lyriques et la dimension polyphonique de ses textes, contribue à renouveler le discours amoureux. Les Ballades composées par Charles d’Orléans font du motif du cœur la métaphore de la lecture et de l’écriture. Mais on voit aussi émerger les voix des femmes, avec les trobairiz ou Christine de Pizan, qui s’attache à mettre en valeur l’écriture. La question féminine apparaît au centre de ses livres, et plus particulièrement la figure de Jeanne d’Arc.
Ainsi, le discours amoureux médiéval apparaît traversé par de nombreux courants. On ne pourrait les citer tous. Le beau livre de Joël Blanchard, qui explore six siècles d’écriture, met l’accent sur cette vitalité et cette inventivité. Destiné en priorité aux médiévistes, historiens ou spécialistes de littérature, il pourra séduire un public plus vaste, épris d’érudition. Un ouvrage riche et complexe, qui montre que loin de s’avérer monolithique, le Moyen Âge est une époque traversée par de multiples courants de pensée, parfois contradictoires, mais toujours féconds. Il nous permet aussi, par cette mise en perspective, de comprendre les discours actuels sur l’amour, dans une gamme qui va du rigorisme le plus strict, chez les chrétiens évangélistes ou traditionalistes, à une sexualité débridée, issue de la révolution sexuelle. L’époque médiévale, souvent dépréciée et présentée comme obscurantiste, échappe à la caricature, dans ce livre tout en nuances, qui en revisite les multiples aspects au cours des siècles. Brillant, érudit, fondé sur des connaissances très précises, il intéressera autant les spécialistes que les amateurs de médiévisme.
NOS PARTENAIRES
Précédent
Suivant