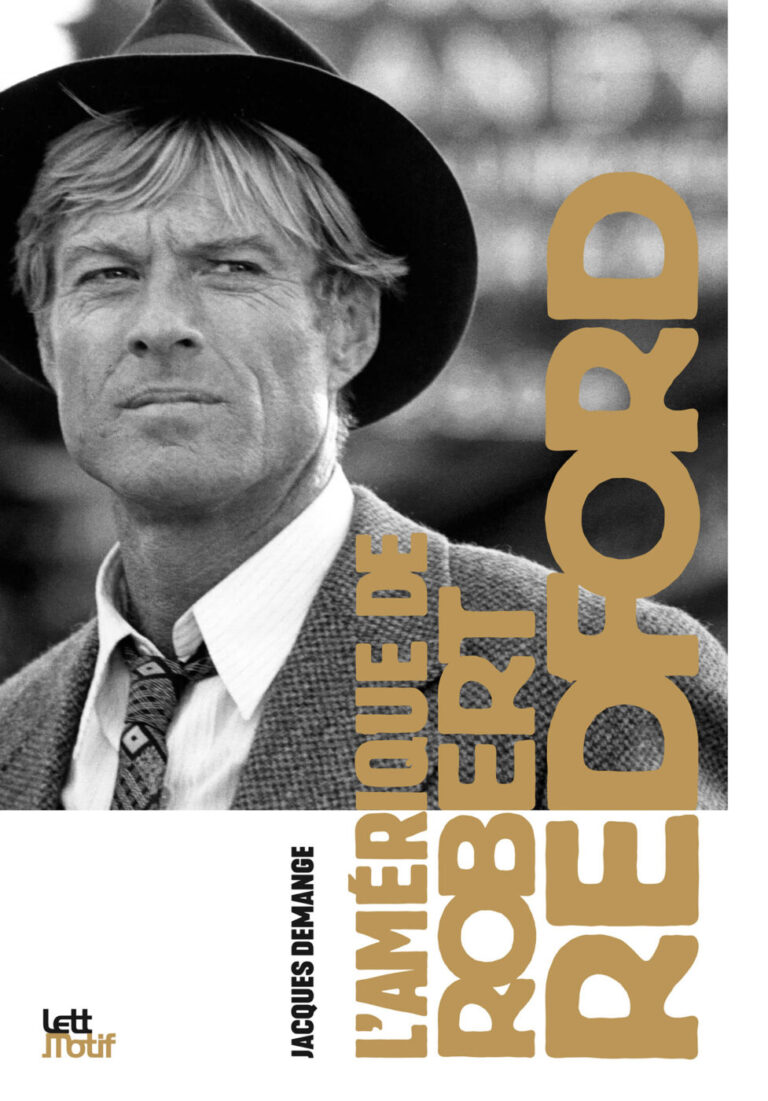Hyam Yared, Du feu autour de l’œil, Mémoire d’encrier, 11/04/2025, 156 pages, 15€
Découvrez notre Podcast
Du feu autour de l’œil se lit comme un long poème en apnée, où chaque mot semble chercher une sortie du chaos. Hyam Yared y déroule un fil narratif sinueux, fait d’éclats, de ruptures et de retours, où le désir affleure dans l’ombre des ruines. À travers une écriture éclatée, presque incantatoire, l’autrice offre une expérience sensorielle et intellectuelle rare, entre l’exil et l’étreinte.
Une conversation avec soi-même
Imaginez une poète qui, vingt ans après avoir écrit sur l’amour et le désir à travers la métaphore de l’eau, décide de lui répondre. C’est le geste audacieux de Hyam Yared dans Du feu autour de l’œil. Le livre commence par cette mise en scène : un recueil d’aujourd’hui, marqué par le feu et la destruction, dialogue avec un recueil d’hier, Blessures de l’eau, dédié à la sensualité des corps. Yared les publie ensemble, mais dans un ordre inversé, comme pour dire que le présent hante toujours le passé. Elle nous prévient : pour la poésie, le temps n’existe pas.
Ce qui lie ces deux époques, ces deux livres, c’est le corps. Hier, il était un paysage à découvrir, une source de plaisir. Aujourd’hui, il est un territoire ravagé, un champ de bataille où les guerres du dehors et du dedans se rejoignent. Le feu qui brûle les villes est le même qui consume les amants. Face à cette violence, l’eau n’est plus une caresse, mais le souvenir des naufragés en Méditerranée, ces migrants devenus des « chiffres muets ». Yared nous demande, avec une tendresse presque brutale : « Viens, / colle ton trou à mon trou et dis-moi / si cela fait un monocle par où rendre / l’horizon aux naufragés ». Avec cette image, tout est dit : c’est à travers nos blessures les plus intimes que l’on peut, peut-être, regarder la grande tragédie du monde.
Les amours qui tuent, les villes qui souffrent
Dans ce livre, Hyam Yared ne se contente pas des mots existants pour décrire la douleur. Elle en invente un, essentiel : « amouricide ». C’est l’idée que l’on peut mourir d’un amour raté comme une ville meurt sous les bombes. Pour elle, les guerres ne sont peut-être que « des amours trop brûlantes à force d’avoir été déçues ». La destruction d’un couple, d’un corps ou d’une cité relève du même malentendu tragique.
Cette fusion entre le corps et la ville est partout dans ses poèmes. Beyrouth n’est pas un simple décor ; c’est un être vivant que l’on torture. On lui dit de danser « avec ses moignons en bouquet sur des ruines ». On lui ordonne de baiser, de tuer, jusqu’à ce qu’elle ne sache plus comment aimer. Cette ville martyrisée, c’est aussi le corps de la femme, pris au piège des mêmes injonctions : être forte mais soumise, désirable mais silencieuse. Dans ce monde patriarcal, le corps féminin et la cité partagent le même sort : ils sont des territoires que l’on cherche à posséder et à contrôler, quitte à les détruire. « Nos villes sont des femmes qui pissent debout. / Elles sont punies pour ça. »
Un cri qui dépasse les frontières
Même si le cœur du livre bat au rythme des explosions de Beyrouth, sa voix s’adresse au monde entier. On y entend l’écho des guerres en Syrie, en Ukraine, à Gaza. Le poème devient un refuge pour tous les exilés, tous ceux qui ont vu leur nation devenir un « naufrage ». Dans ce chaos, que reste-t-il ? L’amour, l’étreinte. Le corps de l’autre devient la seule patrie possible, le seul endroit où, pour un instant, on peut oublier « le temps qu’il fait dans un charnier ». Le contact des peaux est un acte de résistance, un refuge où « le dictateur se tait ».
Face à l’effondrement, Hyam Yared propose une arme : réinventer la langue. Elle cherche des mots plus puissants que les discours officiels qui « enferment l’humanité malade ». Sa poésie n’offre pas de réponses faciles ni de guérison. Elle nous plonge dans le vertige, dans la perte, mais c’est justement là que se trouve une forme de survie. En nommant la fracture avec des mots neufs et précis, elle nous aide à ne pas sombrer complètement. Le livre se termine sur cette idée : l’horizon tue, mais l’écriture, elle, est comme le dernier mur qui reste debout après le bombardement. Une trace fragile, mais une trace quand même.