Raphaëlle Red, Adikou, Grasset, 10/01/2024, 1 vol. (219 p.), 19,50€.
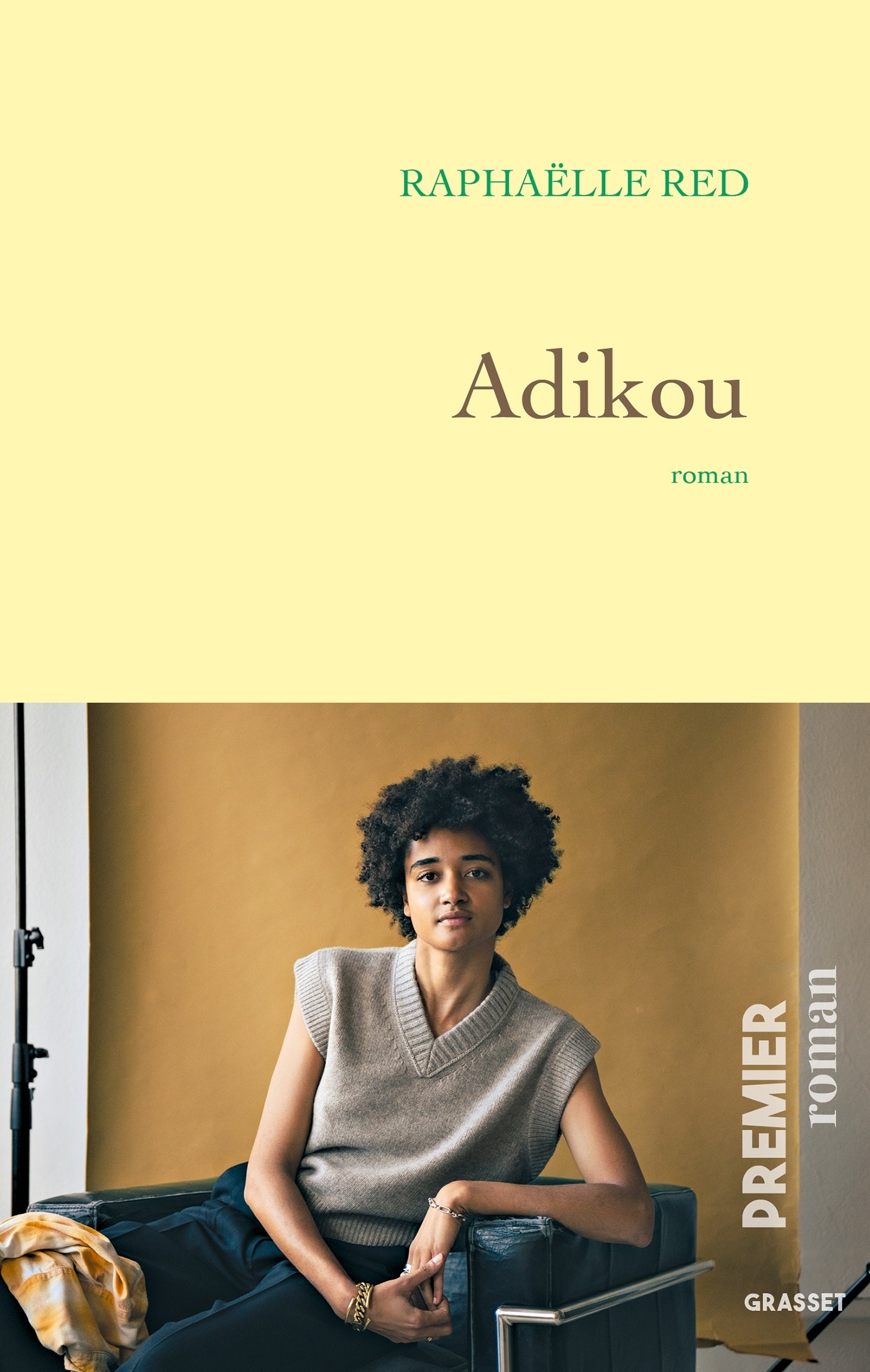
Deux figures féminines émergent, la narratrice, dont on ignore le nom, qui travaille dans un fast-food, et son amie, dont on connaît le nom de famille. C’est celui de son père, Adikou. Le livre nous entraîne dans les pas des deux jeunes filles, à la recherche des origines africaines de cette dernière.
La recherche des origines
Partagée entre deux identités, l’une française, l’autre africaine, Adikou entame une quête de soi. Un besoin impérieux, presque d’ordre onirique, sous la forme de “rêves étranges et bleus“, la pousse à partir en Afrique.
En dormant elle imaginait, dans son cou, des points de suture qui tissaient une carte. Le fil était chargé de minéraux et le sang de sel. L’aiguille laissait une odeur de fer. Elle se réveillait fatiguée : la texture de la poussière, la lumière du soleil écrasé sur sa peau.
Presque organiques, ces rêves, qui font corps avec le sien, revêtent une signification qui s’éclairera par la suite. L’aspiration de l’héroïne s’exprime de manière imagée, en particulier dans cette description du sud des Etats-Unis, et des paysages longeant la Mississippi, lors de son voyage précédent, en Amérique.
Quelque chose les tient debout depuis des siècles dans cette partie du pays qui sent la survie, fait implorer puis danser sous un soleil trop mûr. Il éclaboussait de suc le wagon de verre. Adikou respirait fort et elle attendait la lune. Elle viendrait renverser sa lueur sur la terre humide, sur les peaux sèches. Adikou espérait une pluie épaisse comme du beurre de karité, des mots qui disparaissent et sont remplacés par des vérités.
La narratrice, pour sa part, est envahie de visions violentes qui expriment une colère rentrée. Cette fureur plaît à Adikou, qui lui intime de la suivre, pour faire le récit de l’aventure, un tandem parfait. Le voyage initiatique passe par des seuils et de multiples rencontres. Le périple d’Adikou la mène jusqu’à Aklako, pas très loin du Bénin, un village créé “par trois frères guerriers lors d’un combat”. L’un d’eux a appelé ce lieu “Là où il s’est réveillé”. Le récit étiologique fait à Adikou se mue en diatribe nationaliste : “Et ensuite les Blancs ont entendu cela à leur manière, l’ont écrit sur leurs cartes : ils ne veulent pas laisser l’Afrique en paix.” Le narrateur de cette histoire évoque ensuite le rôle joué par les Blancs dans l’esclavage. Dougbé, un autre village, a été créé par trois vieux, ou “par accident par une enfant joueuse”. Les récits défilent, convoquant la mémoire et les origines, à la façon de ceux des griots. La famille du conteur et celle d’Adikou appartiennent au même groupe de familles, issues du Ghana.
Raphaëlle Red excelle à décrire les atmosphères des pays que son héroïne traverse, comme lorsqu’elle évoque Adikou marchant sur une plage africaine, mais la description ne s’avère jamais gratuite :
En détournant la tête de l’eau blanche et remuante, de l’écume qui y dessine des pierres précieuses et des silhouettes de méduses ; en plissant les yeux contre le soleil matinal, qui frappe contre le regard à droite, elle aperçoit des pirogues, des couleurs aussi, des filets verts et blancs et bleus et des jeunes et des vieux et des enfants qui sautent.
Cette image idyllique précède la prison conçue pour contenir jusqu’à huit femmes rebelles, l’évocation des viols et des difficiles conditions d’hygiène.
La difficulté d’être : récit d’une Histoire troublée
L’ombre de l’esclavage, de la colonisation et de la décolonisation se profile, depuis le rêve initial, à travers le passage à l’aéroport :
Elle a dit Roissy, et puis qu’elle était pas là pour honorer les tortionnaires, n’empêche que l’aéroport s’appelle Charles-de-Gaulle et que ça pose question, comme si on ne saisissait pas toujours les moments dans lesquels on prête allégeance. Le style indirect libre mêle les deux voix, celle de la narratrice et celle du personnage éponyme, rappelant leurs conversations, corps rapprochés, « dans la langue de l’anguille ou celle du lézard.
La figure du tortionnaire ressurgit à l’atterrissage, avec le nom de l’aéroport, précisé un peu plus tard dans le récit, La figure du tortionnaire ressurgit à l’atterrissage, avec le nom de l’aéroport, précisé un peu plus tard dans le récit, celui d’un ancien dictateur togolais. Adikou revendique une identité d’apatride, formulation inexacte selon la narratrice, mais qui traduit bien sa difficulté d’être. Dans ses divers voyages, d’autres figures s’interposent, celle de Michelle Obama, qui descend d’une esclave nommée Melvinia, achetée dans les années 1850 par un propriétaire de plantation, pour 475 dollars. La Louisiane a confronté Adikou à la rupture et au manque, mais aussi à une étrange forme de justice, incarnée par ce planteur blanc qu’on a enterré avec sa jambe amputée. Les Etats-Unis, lieu emblématique de l’esclavage, lui causent une souffrance physique et morale. Une migraine fait enfler son cerveau “comme un moignon” et le pousse contre la paroi de sa boîte crânienne. La force et la violence de l’image vont de pair avec celle de la critique formulée :
Mais il fallait bien lui dire, aussi, qu’on vendait à son cœur un rêve qui n’était pas le sien et qui puait le maître, puait l’accumulation de richesses qui puait la superpuissance américaine qui puait les simulacres de démocratie les lobbies et les drones.
L’anaphore renforce la puissance rhétorique de la dénonciation, qui sonne comme un plaidoyer, et s’achève sur l’idée de la conjugaison du capitalisme et de la Maison Blanche, se livrant pendant 400 ans à l’esclavage et l’extermination des personnes noires.
La douloureuse question du métissage de l’écriture et de soi
La première question qui lui posée à Adikou, à son arrivée à l’aéroport de Lomé, par un homme d’affaires, est celle du métissage, à laquelle elle répond par l’affirmative. Le passage de la douane suscite des images, en lien avec son père, qui lui a donné son identité togolaise. Son nom de famille est celui de sa mère, originaire du nom de la France “qui sent la cassonade et les crêpes et les banlieues industrielles, un nom bien de chez nous.” Le nom du père, “celui des passeports et des visas”, que la narratrice définit comme un “danger qui s’aiguise ici”, en Afrique, renvoie aux migrations. Sa double appartenance s’exprime à travers des dissensions, parfois alimentaires, comme sa difficulté à manger du piment, expérimentée lors d’un premier voyage avec une ONG.
Elle sait limiter le risque qu’on repère sa galère – les remarques sur le décalage entre son sang supposément d’ici et l’inadaptation de son corps étaient déjà assez nombreuses lors de son dernier voyage.
Est-elle Blanche ou Noire, puisqu’une seule goutte de sang noir suffit à colorer une personne. Quel côté choisir ? La couleur elle-même se fait problématique
Il faut faire la différence entre marron migrante et marron française, sonder les peaux en quête de la teinte marron intégration, regarder mal le marron blanchi aux produits éclaircissants, parce que c’est quand même terrible de s’infliger ça.
Si les signares, comme on les nomme au Sénégal, ont joué un rôle important dans l’esclavage, Adikou trouve sa couleur “vénère”, car elle a “la teinte criarde de la trahison, le silence du viol“, et raconte partout des histoires de pouvoir.
Mais le métissage concerne aussi l’écriture du livre, qui mêle des mots éwés au français : zémidjan (ou moto-taxi) foufou (le nom d’un plat typique) kori, un coquillage servant de monnaie d’échange, ouvézon, wézon, bonjour, eyisso, à demain, akpé, merci, midyo, partons. Yovo, yovo, bonsoir. Un autre métissage linguistique intervient, celui de l’anglais, initié par l’évocation d’un voyage à New-York, puis réactivé à l’occasion d’un autre en Louisiane. Whiteboy, my god, and you should call, wow, amazing, great to meet you, you are travelling alone ! jalonnent le récit en français, écho des multiples voix du continent nord-américain. Le livre est rythmé par l’évocation de diverses musiques, comme Tennessee, de Kalash et Ninho.
D’une écriture précise, dénuée d’exotisme, qui restitue avec justesse les atmosphères, ce premier roman de Raphaëlle Red pose avec lucidité la question de l’appartenance et de l’identité. L’œuvre met en évidence l’africanité à travers les évocations des matières et les couleurs qui la parsèment, mais se fait aussi interrogatrice, voire polémique. Ce premier roman de Raphaëlle Red évoque, avec force, émotion et complexité, la difficulté d’être née métisse, à la confluence de deux cultures. Une réussite.
marion.poirson@gmail.com
















