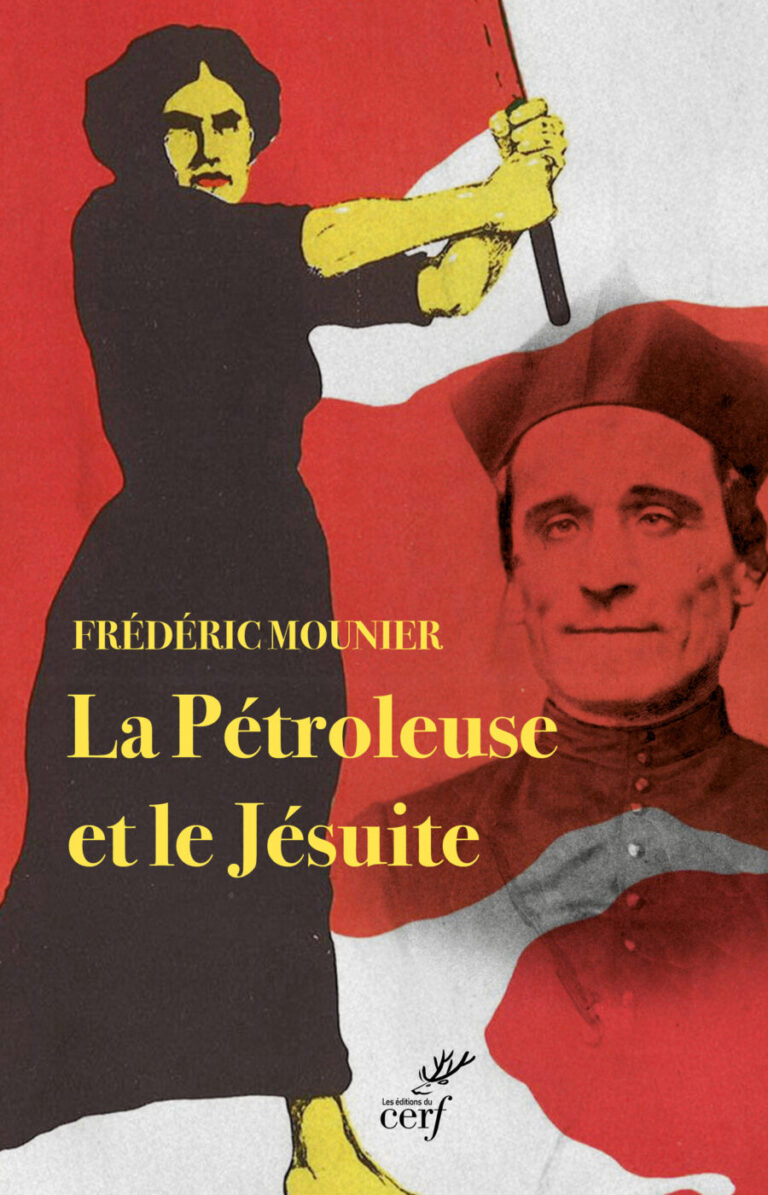Mona Azzam, Et au bout, le tunnel – Tome 1 : Beyrouth, un jour… – Tome 2 : Beyrouth, toujours, Les éditions d’Avallon, 21/03/2025, 296 et 274 pages, 22€ chaque tome.
C’est un effacement. Une femme, libraire à Montpellier, s’évapore, laissant derrière elle une famille suspendue au-dessus du vide. Ainsi s’amorce le diptyque romanesque de Mona Azzam, Et au bout, le tunnel, composé de 1. Beyrouth, un jour… et 2. Beyrouth, toujours… Œuvre dense et polyphonique, ce n’est pas tant le récit d’une disparition que l’autopsie d’une mémoire fracturée, où l’intime et le politique se livrent un combat sans merci. En déployant une structure chorale magistrale, Mona Azzam plonge ses personnages – et son lecteur – dans les zones grises de l’histoire libanaise, là où les secrets personnels et les traumas collectifs s’entremêlent pour former un labyrinthe dont personne ne sort indemne.
Nina a disparu : chronique d’un effondrement intérieur annoncé
La première force des deux romans est de dynamiter la quiétude domestique. À Montpellier, la disparition de Nina n’est pas un événement, mais une onde de choc qui sape les fondations d’un foyer. Le récit s’ouvre sur trois solitudes : Yvan, le mari, journaliste de guerre dépossédé de ses outils d’analyse face au mystère de sa propre vie ; et les jumeaux, Hugo et Léa, adolescents brutalement projetés dans un monde adulte fait de silences et de demi-vérités. « Où est Nina ? Comment une femme, ma femme en l’occurrence, peut-elle se volatiliser du jour au lendemain ? » La structure chorale devient ici un sismographe des âmes. Chaque voix porte sa propre musique du deuil : l’angoisse rationnelle d’Yvan, la colère rentrée d’Hugo, l’intuition mélancolique de Léa.
L’enquête qui débute est d’emblée une archéologie des apparences. Les premiers indices ne sont pas matériels, mais spectraux : des archives de courriels qui exhument un passé insoupçonné, un journal intime retrouvé qui révèle des blessures enfouies. La progression narrative est celle d’une dépossession. Les personnages croyaient se connaître ; ils découvrent des étrangers. Cette première partie est un remarquable traité sur l’opacité de l’autre, même le plus proche. La figure de l’agent Dupont, policier ambigu qui se propose comme allié, incarne d’emblée cette instabilité : est-il un sauveur ou un prédateur ? Mona Azzam installe une tension psychologique redoutable, où le doute n’est pas un ressort, mais l’air même que l’on respire.
Un journal intime déterre l’horreur enfouie d’un pays
À mesure que les pistes se brouillent, le roman révèle son véritable cœur battant : Beyrouth. La capitale libanaise est bien plus qu’un décor ; elle est une entité vivante, un personnage à part entière dont la présence irrigue chaque page, jusqu’à devenir l’obsession centrale de Beyrouth, toujours… Le diptyque organise une confrontation magistrale entre une ville du sud de la France, lumineuse mais soudain vide de sens, et cette métropole levantine, chaotique, violente, mais vibrante de mémoire. Pour les personnages, retourner au Liban n’est pas un voyage, c’est une déflagration mémorielle. Le passé de Nina y refait surface, et avec lui les fantômes de la guerre civile.
C’est dans les pages du journal de Nina, « Les bleus de Nina », que le roman atteint une noirceur bouleversante. On y découvre le trauma fondateur, cet événement indicible qui a scellé son destin : un viol collectif dans le tunnel du Ring, cette artère qui séparait Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest durant la guerre. Cet acte de barbarie devient la métaphore centrale de l’œuvre : le tunnel n’est pas seulement un lieu de passage, c’est une cicatrice, un lieu de profanation physique et symbolique. La disparition de Nina n’est plus une fuite, mais la réactivation d’un exil intérieur. Elle ne fuit pas sa famille, elle fuit le spectre d’une violence qui l’a dépossédée d’elle-même. Cette révélation, pivot du premier tome, confère au diptyque toute sa portée tragique et politique.
Guillaume Dupont, le flic infiltré dans la famille, devient alors une figure encore plus complexe. Son parcours, qui le lie lui aussi au Liban, n’est pas fortuit. Mona Azzam le construit comme le double pervers d’Yvan : là où le journaliste cherche la vérité, Dupont la manipule, instrumentalise la douleur des autres pour combler son propre vide. C’est un personnage d’une grande intelligence narrative, car il n’est pas un simple antagoniste ; il est une pathologie, un homme qui cherche à s’inventer une famille en détruisant celle qu’il convoite, un stratège du chaos dont les motivations profondes constituent l’un des mystères les plus angoissants du livre.
La mémoire ne se fuit pas, elle s’écrit dans le corps
À travers cette double enquête – sur la disparition de Nina et sur les secrets de Dupont –, Mona Azzam pose une question fondamentale : comment hérite-t-on d’une histoire que l’on n’a pas vécue ? Les jumeaux, Hugo et Léa, sont les dépositaires de ce tremblement. Initialement coupés de leurs racines libanaises par une mère qui voulait les en protéger, ils sont contraints par le drame à s’approprier ce passé. Leur trajectoire est magnifique. Hugo embrasse cette nouvelle identité avec une ferveur quasi mystique, tandis que Léa, plus rétive, se politise et finit par incarner une forme de résilience lucide et combative. Leur immersion dans le Beyrouth de la Thawra (la révolution d’Octobre 2019) est un des moments les plus forts du second tome. Ils ne découvrent pas un pays de ruines, mais une jeunesse vibrante qui, comme eux, cherche à se libérer des fantômes de la guerre.
Cette œuvre s’inscrit ainsi dans une lignée littéraire qui interroge les plaies mal refermées de l’Histoire. On pense à Sorj Chalandon pour la manière dont la trahison intime et le conflit libanais se répondent, ou à Patrick Modiano pour cette esthétique de l’enquête mémorielle où chaque indice est une porte ouverte sur une absence. Mais la voix de Mona Azzam est singulière : elle combine la rigueur quasi documentaire d’une fresque géopolitique à la sensibilité à fleur de peau d’un drame psychologique.
Finalement, le titre porte en lui toute l’ambiguïté du projet. Il n’y a peut-être pas de « bout » au tunnel de l’Histoire, pas de sortie définitive du trauma. Il y a des traversées, des moments de lumière arrachés à l’obscurité, des mains que l’on se tend pour ne pas sombrer. Le roman ne propose pas de résolution facile. Il laisse le lecteur avec cette certitude fragile : la seule issue est dans la transmission, dans le courage de nommer les fantômes pour apprendre à vivre avec eux. Car si « Beyrouth est un tunnel obscur où même les échos se meurent », la littérature, elle, est l’art de faire résonner les voix les plus faibles, de les transformer en un chant têtu, inoubliable, et profondément humain. Avec Et au bout, le tunnel, Mona Azzam ne nous promet pas la lumière au bout du chemin, mais nous apprend à regarder la nuit en face, et à y trouver la force de continuer à avancer.