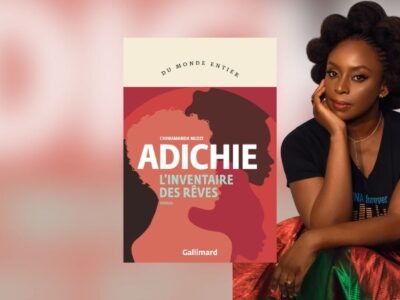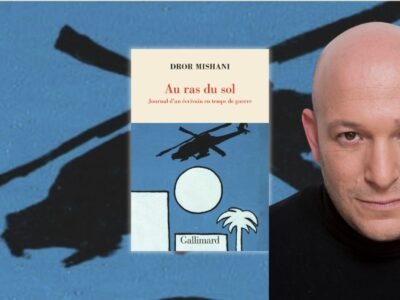Velibor Colic, Guerre et pluie, Gallimard, 01/02/2024, 1 vol. (285 p.), 22€
Avec Guerre et pluie, titre qui fait écho au célèbre roman de Tolstoï sur l’épopée napoléonienne, vue du côté russe, Velbor Colic poursuit une œuvre qui mêle réalité, fiction et souvenirs personnels. Dans cet ouvrage, il évoque ses souvenirs de la guerre de Bosnie, alors qu’à peine âgé de vingt ans, il avait été enrôlé dans l’armée, avant de déserter.
Un syndrome post-traumatique
Le roman commence par une évocation de la maladie dont souffre l’auteur, et qui se déclenche un an tout juste après la pandémie, alors qu’il réside en Belgique. Un virus qui ne soucie ni de l’âge, ni des classes sociales, mais dont lui-même semble être exclu, car il souffre d’une autre affection, extrêmement douloureuse, le pemphigus vulgaris. Cette pathologie rare le fait terriblement souffrir. Il la décrit par le menu, avec force détails, avant de faire la liste des symptômes pour pouvoir la considérer de manière abstraite, créant ainsi une distance : “Je saigne. Je suis plus maigre qu’Alberto Giacometti. Il ne reste presque rien du moi d’avant. Peut-être le nez, probablement les yeux et c’est tout.” Aliénation, déperdition, métamorphose : l’attention de l’écrivain se concentre tout entière sur la souffrance et la maladie :
J’existe à travers ma douleur. Un million de petites bougies brûlent à travers ma peau. J’imagine que chacun de ces points lumineux a son âme et sa vie. Que ces boutons douloureux forment une constellation où l’on peut voir et comprendre tout l’univers : le soleil et les étoiles, les lunes déclinantes et les planètes fertiles.
La spécificité de l’art de Velibor Colic s’exprime dans ce bref passage, où apparaissent tout à la fois la dimension organique de son style et l’attention portée au corps, également visible dans Manuel d’exil (2016), et que l’on retrouve dans ses descriptions de la guerre et de l’errance, mais aussi le caractère poétique de son œuvre, qui culmine dans Ederlezi (2014) et transparaît dans cette évocation cosmique, sublimant la douleur et la maladie. Avec une grande finesse, il analyse ses sensations et toutes les pensées qui traversent son esprit, alors qu’il se sent “faible et desséché comme un nénuphar cueilli.” Il s’inquiète aussi de son apparence physique, se voit comme issu “du théâtre japonais nô”, comme un “masque vide.” Sa description avoisine parfois la monstruosité : “Une tête d’aigle sur le corps d’un koala, cou penché de Quasimodo et longs bras minces d’une poupée de chiffon.” Les métaphores animalières comme l’image de la poupée visent à le déshumaniser, voire à l’objectifier. Son parcours, en particulier dans une clinique à la structure labyrinthique, prend des accents kafkaïens. Un réflexologue lui donne enfin l’explication qu’il recherche :
Votre maladie de peau… n’est rien d’autre que la guerre qui sort de vous… Et c’est moche, toutes ces blessures et ces inflammations, parce que la guerre est très, très moche.
Le refus de la guerre
L’auteur ne cesse de questionner la réalité, le sens de la vie. La guerre est venue bouleverser une existence heureuse. En 1992, il travaille à la radio pour une émission de jazz intitulée “La Mosaïque culturelle”, un peu morne, et un autre, “Rock Express“, très différente, peuplée de morceaux de Lou Reed ou Velvet Underground, lui donnant l’impression qu’une “nuit new-yorkaise pleine d’étoiles scintille et brille sur le vinyle“. Cette expérience lui fait croire au sens de la vie, à la fraternité universelle et à la protection de millions de dieux. Tout l’inverse, en fait, de sa terrible expérience de la guerre, dont les prémices s’annoncent fin février. Pluie, fonte des neiges, crues, inondations, qui transforment les paysages en marécages, précèdent de peu les conflits. Déjà, les habitats se montrent insensibles aux intempéries car “Les Serbes, les Croates et les Bosniaques ont commencé une guerre, mesquine, laide et sale. Ils ont sorti leur haine, leurs drapeaux et leurs armes et ont commencé une chasse cruelle.” L’auteur décrit les cadavres flottant sur la rivière avec un mélange d’horreur et de poésie, “comme des nénuphars dont personne ne veut.” À cette ophélisation s’ajoute le détournement d’une expression baudelairienne “comme les fleurs blanches mortes du mal”, tandis que résonne le Beau Danube Bleu.
Velibor Colic analyse toutes les manifestations physiques provoquées par l’angoisse de la guerre, qu’il résume en une formule lancinante et répétitive : “Douleur, diarrhée, solitude, peur.” Il en décrit, de façon terrible et précise, la cruauté, l’horreur.
Entre humour et poésie, le regard de l’écrivain
Le style de Velibor Colic joue beaucoup sur l’humour et l’autodérision. Ainsi, il vérifie sur internet la manière dont sont mortes des célébrités, Prévert, Boris Vian, Marie Curie, Frida Kahlo, Jimmy Hendrix, etc., une nécrologie associée à diverses pathologies létales. Son imaginaire marque une obsession de l’avalement, qu’il s’agisse du ventre du scanner, ou de la guerre elle-même. La scanner est perçu comme un “gosier nucléaire”, il l’imagine tel un requin blanc, entre les mâchoires duquel il glisse, “lié comme une saucisse.” Dans la seconde partie, on retrouve le réseau d’images de la première, avec l’obsession de la dévoration, nous rappelant que la maladie constitue le miroir de la guerre, lorsque les corps déchiquetés par les poissons deviennent : “Un banquet géant, un festin somptueux de viande pourrie, d’algues et de micro-organismes, de bactéries et de plancton.” La proximité des métaphores permet d’établir le lien entre les deux, de comprendre l’origine de la pathologie : “Ma peau est un miroir. Un papier de tournesol pour mon feu intérieur, pour ma stupide et violente guerre. La guerre est un énorme estomac qui avale tout. Surtout les vies.” Pourtant, il plaisante, constatant que sa chemise, qui dévoile ses fesses, “le couvre aussi mal” que son “assurance maladie.” Ailleurs, il remarque qu’elle lui donne “l’air d’un poulet hypnotisé.” À la guerre, il est un “Chveik moderne, maladroit et perdu, inquiet, anxieux qui porte sur lui une photo d’Emily Dickinson.”, et ressemble plus “à une caricature baba cool qu’à un soldat et un patriote croate“, ce dont il se félicite, n‘en étant pas un. Son humour vise également les autres, comme dans ce portrait de Marc, l’hypnotiseur, “un sosie de Jack Nicholson“, au point qu’en fermant les yeux, il pense inexorablement à Shining. Les références au cinéma ou à la musique sont nombreuses dans le livre.
Mais la mémoire le renvoie aussi au souvenir des jolies choses : “Longues vacances d’été. Le sourire de Milena, belle, inaccessible. Les mains blanches de ma mère. Sa robe fleurie d’été. Le parfum des abricots mûrs dans sa cuisine.” Des images de bonheur, de tendresse, de sensualité traversent alors le récit. Les femmes aimées et les joies simples se confondent. “Les caresses douces, comme de la soie, d’une Claire sous la pluie, folle et perdue. Son visage qui se perd dans un sfumato sépia.” Laure, Enka, Barbara, Mireille, Eva, leurs noms s’égrènent dans une évocation quasi magique, entraînant le rappel d’une autre figure féminine, un soir de neige, sous un luminaire qui “ressemble à une crème glacée entièrement composée de cristaux de vanille.”
L’écriture comme moyen de lutte
Comme il le raconte dans la suite du récit, Velibor Colic se livre à l’activité qui est aussi la seule arme dont il dispose, et à laquelle tout écrivain peut avoir recours en ces circonstances, il noircit des carnets, encore un point commun entre la guerre et la maladie. Dans cette action se mêlent le désir de garder en mémoire, de témoigner et de survivre. Dès le début de la guerre, il exhibe dans un café un manuscrit au titre surréaliste : L’écume de mer est un chien qui aboie aux étoiles, avant d’écrire son manifeste poétique, entre provocation et farce : Le manifeste de la Révolution éthylique, dont il livre des extraits. Ses amis ivrognes sont des épaves, des âmes perdues, des alchimistes, tandis qu’il lit Bukowski, Miller, Hemingway. La guerre offre, étrangement, quelques moments d’intense poésie, comme l’apparition inattendue d’un cerf rouge qui dévisage les soldats, tandis qu’à l’emplacement de ses sabots, l’auteur aperçoit quatre buissons de fleurs sauvages, qui pourraient faire songer à un miracle médiéval.
D’une grande puissance d’évocation, le roman de Velibor Colic décrit les ravages et les monstruosités de la guerre civile dans l’ex-Yougoslavie. Apre et pourtant plein d’humour, de poésie et d’humanité, le livre permet une jonction avec son récit d’exil. Un texte fort, qui subjugue d’un bout à l’autre son lecteur. A lire absolument.

Chroniqueuse : Marion Poirson-Dechonne
marion.poirson@gmail.com
NOS PARTENAIRES
Faire un don
Vos dons nous permettent de faire vivre les libraires indépendants ! Tous les livres financés par l’association seront offerts, en retour, à des associations ou aux médiathèques de nos villages. Les sommes récoltées permettent en plus de garantir l’indépendance de nos chroniques et un site sans publicité.