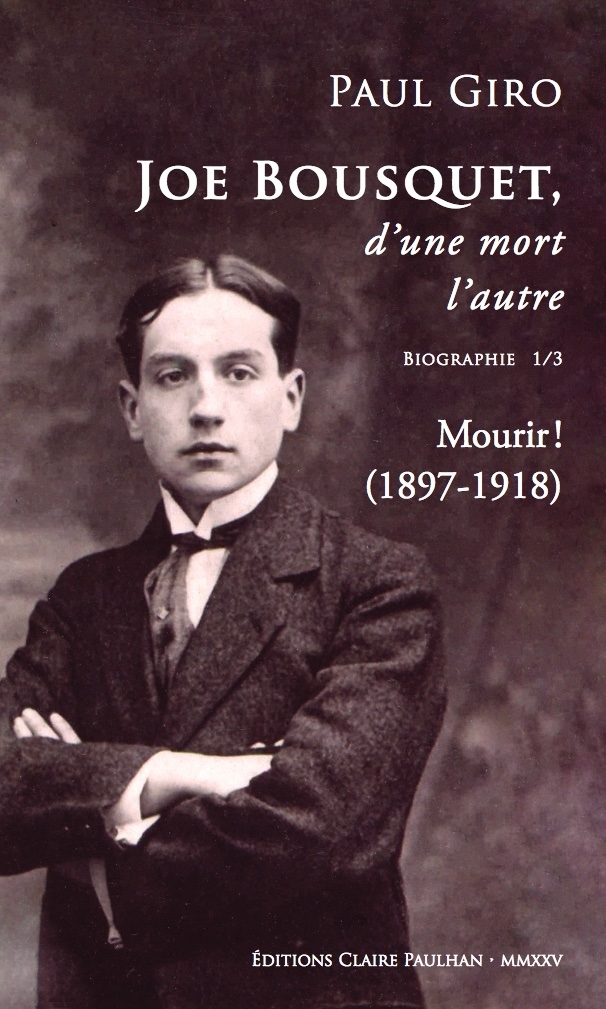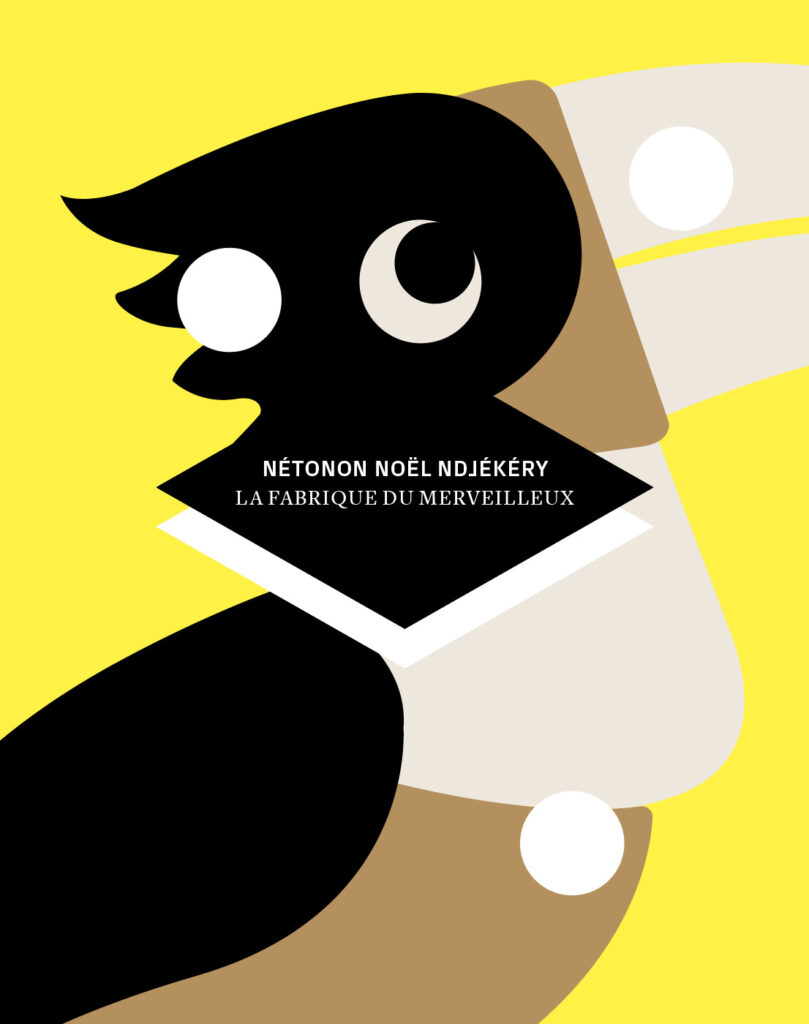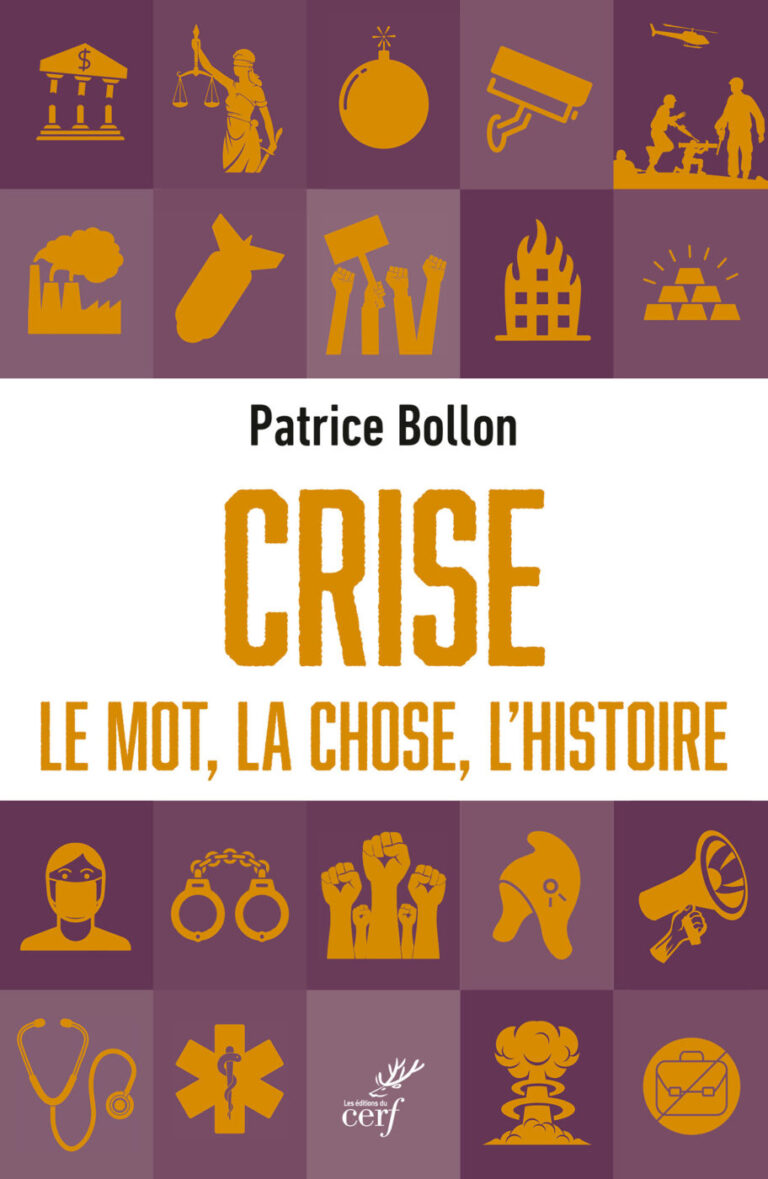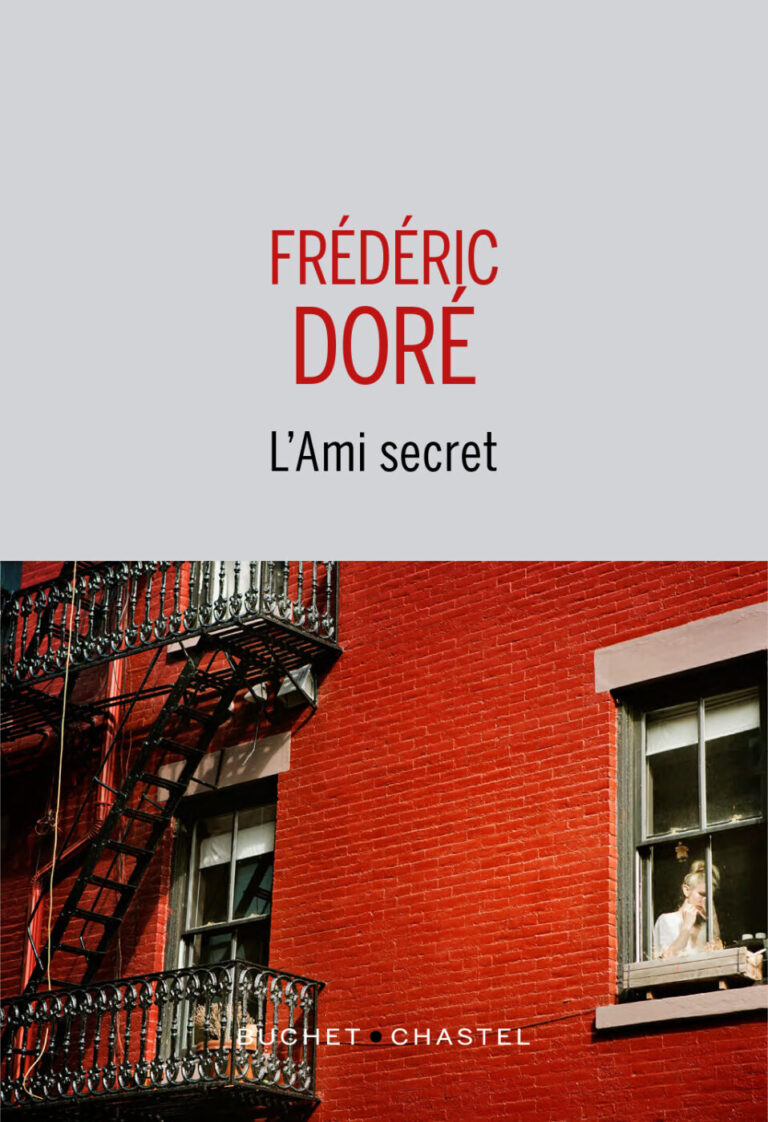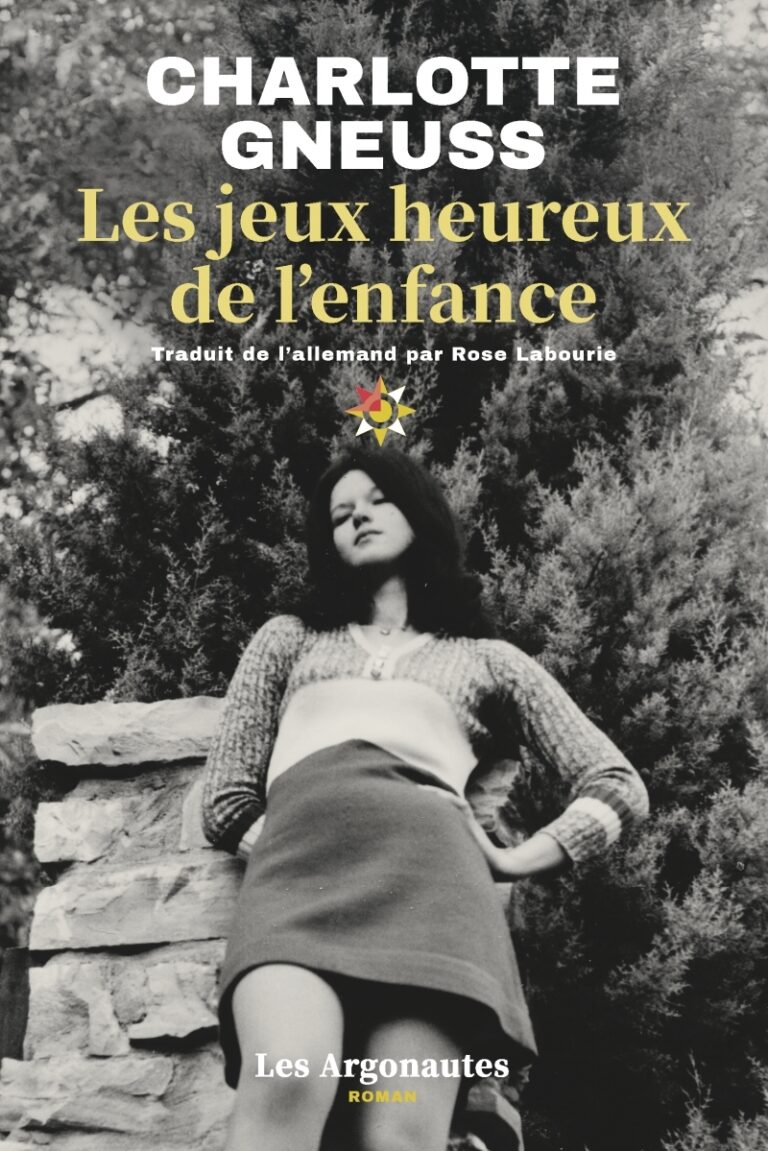Paul Giro, Joë Bousquet, d’une mort à l’autre. Mourir ! 1897-1918, Éditions Claire Paulhan, 10/03/2025, 460 pages, 28€
Découvrez notre Podcast
On ouvre le volume de Paul Giro comme on entrouvre un coffret de famille longtemps resté aux mains des seuls héritiers. L’objet, d’abord : un volume dense sans être massif, 460 pages dans le format sobre de la collection « Pour mémoire », un premier tirage à 550 exemplaires sur un très beau papier et sous une couverture granuleuse où le nom de Joë Bousquet affleure comme une inscription déjà patinée par le temps. Le soin quasi bibliophilique des éditions Claire Paulhan ne relève pas de la coquetterie : il prolonge un catalogue tout entier voué aux écritures de l’intime – journaux, correspondances, mémoires – de l’Affaire Dreyfus à mai 1968, cette zone vibratile où la littérature se confond avec la vie nue. Qu’on songe aux lettres de Rachel Bespaloff, d’Hélène Hoppenot ou de Catherine Pozzi, Mireille Havet exhumées par la maison : la biographie de Joë Bousquet vient naturellement prendre place dans cette constellation d’archives ardentes, et l’objet lui‑même, constellé de quarante fac‑similés couleur, impose d’emblée la promesse d’une fréquentation lente, presque cérémonielle.
Joë Bousquet : de Narbonne au Chemin des Dames, itinéraire d’un poète immobilisé
Mais il faut aussitôt replacer Joë Bousquet dans son siècle pour mesurer ce que fait ce premier tome. Né à Narbonne en 1897, grandi à Carcassonne dans une bourgeoisie catholique provinciale, Joë Bousquet aurait pu n’être qu’un médecin ou un officier parmi d’autres, si la catastrophe de 1918 ne l’avait pas cloué pour toujours dans une chambre rue de Verdun. De ce lit – devenu, on le sait, poste d’observation, chambre noire et salon littéraire – partiront des livres d’un genre indécidable, entre poème, conte métaphysique et journal, auxquels viendront rendre visite Éluard, Aragon, Simone Weil, Paulhan, Max Ernst. Reclus de Carcassonne, certes, mais aussi nœud de forces : surréalisme, spiritualités hétérodoxes, politique de l’esprit, tout passe par ce corps immobile qu’entourent des toiles de Tanguy, d’Ernst ou de Fautrier. Pourtant la mythologie a tout figé : l’icône du « blessé héroïque », de la « balle allemande » et du lieutenant romantique a recouvert l’homme et son histoire. C’est à ce voile que s’attaque Paul Giro.
D’une mort l’autre : comprendre la double naissance tragique de Joë Bousquet
Son projet tient en un titre programmatique : D’une mort l’autre. Première mort : la naissance catastrophique de 1897, l’enfant qu’on croit mort‑né, arraché in extremis au néant, sur fond de phrase paternelle assassine – « dommage, c’était un garçon », rapporte la tradition familiale. Seconde mort : la blessure du 27 mai 1918 sur le plateau de Brenelle, non plus le mythe d’un tir ennemi presque romanesque, mais la violence anonyme d’un éclat de shrapnel qui traverse le thorax, pince la moelle et laisse un jeune homme de vingt et un ans à jamais privé de ses jambes. Entre ces deux morts, Paul Giro déploie ce qu’il appelle, à la suite de Joë Bousquet, un « mal natal » : une mélancolie presque clinique, née de la chaîne de traumatismes inaugurale – nourrice morte en le tenant dans ses bras, fièvre typhoïde, sentiment tenace d’avoir usurpé sa place parmi les vivants. C’est là l’un des apports décisifs de ce volume : déplacer l’épicentre de la légende, de la blessure militaire vers cette préhistoire douloureuse où s’invente déjà la tonalité d’une œuvre.
Cette archéologie de la mélancolie va bien au-delà d’une biographie classique : elle reconstruit, presque jour après jour, la topographie intérieure d’un enfant, puis d’un adolescent en lutte avec lui‑même. Marseillens, la Palme, Villalier : autant de lieux minutieusement restitués, où Paul Giro suit le jeune Joseph arpentant domaines viticoles, parcs et salles de classe, « cancre brillant » et « petit salaud » tour à tour, cruel avec les animaux, bravache, constamment en porte‑à‑faux avec les attentes paternelles. Loin de l’image d’un enfant rêveur apprenti poète, il met au jour un adolescent dandy, provocateur, que les études ennuient, promis à HEC par un père qui rêve de carrière solide, école où il n’ira jamais, rectification bienvenue d’une légende trop souvent répétée. Le livre excelle ici à croiser archives scolaires, lettres, témoignages pour reconstituer, presque à la manière d’un roman balzacien, la petite société carcassonnaise : notables, camarades de lycée (Jean Mistler, René Nelli, Ferdinand Alquié), prêtres, « dames » de province, tous dessinés à traits justes, jamais caricaturaux. On voit naître, dans ce théâtre restreint, l’homme qui plus tard fera de sa chambre un centre de gravité : même besoin d’emprise, même goût pour les constructions imaginaires, même passion des mots.
Démolir les légendes : comment Paul Giro rétablit la vérité sur Joë Bousquet
C’est lorsque la guerre survient que la puissance critique de Paul Giro se déploie dans toute sa rigueur. Il commence par faire tomber, un à un, les panneaux de carton-pâte de la légende : non, Joë Bousquet n’a pas devancé l’appel, il est incorporé en janvier 1916 avec sa classe ; non, il n’est pas lieutenant pendant le conflit mais aspirant, puis sous‑lieutenant à titre temporaire ; non, la blessure ne se produit pas à Vailly même, mais sur le plateau de Brenelle ; non, Max Ernst ne se trouve pas dans les troupes opposées ce jour‑là ; non enfin, la colonne n’est pas « sectionnée », la moelle est pincée. Ces « non » répétés – que l’éditeur met déjà en exergue sur la quatrième de couverture – ne relèvent pas du pinaillage érudit : ils défont un récit héroïsant qui, loin de grandir Joë Bousquet, l’aplatissait en figure d’Épinal. À la place, Paul Giro restitue un jeune officier d’infanterie du 156ᵉ RI, commandant une section de repris de justice, admirable de courage mais aussi traversé de paniques, de scrupules, de gestes manqués (la main qui tremble au moment de tirer sur un ennemi à bout portant).
Surtout, il ancre la blessure de guerre dans une autre dramaturgie, amoureuse celle‑là. La rencontre avec Marthe Marquié, au soir du 19 novembre 1916, lors d’un Werther à l’Opéra de Béziers, surgit comme un coup de foudre dont André Breton dira qu’il fut « le mystérieux, l’improbable, l’unique, le confondant et l’indubitable amour ». Paul Giro rectifie la date, examine le dossier Marquié avec la patience d’un enquêteur : lettres, récits rétrospectifs, on‑dit provinciaux sont passés au crible. Il montre comment cette femme plus âgée, divorcée, étonnamment ressemblante à la mère de Joë Bousquet, concentre chez le jeune officier tout un imaginaire de l’amour sacrificiel, de la pureté compromise, de la faute sociale : épouser une divorcée dans la Carcassonne d’alors, c’est l’exil intérieur assuré. Au fil des pages, la correspondance de Marthe, ses silences, ses reculs, les fuites du jeune homme lui‑même composent une mécanique tragique d’une précision grecque : plus l’un et l’autre tardent à assumer la transgression, plus la logique de mort se referme. Lorsque Joë Bousquet quitte Béziers pour retourner au front, Paul Giro laisse affleurer, sans jamais forcer la note, l’idée d’un suicide différé : il ne va pas chercher la mort de façon théâtrale, mais il s’expose un peu plus, désire « en finir » avec cette vie où l’amour et la filiation semblent impossibles.
27 mai 1918 : le cœur brûlant du récit biographique de Paul Giro
Les nombreuses pages consacrées au 27 mai 1918 comptent parmi les plus fortes du livre. Là encore, Paul Giro évite l’emphase. Il suit le journal de marche du régiment, les cartes, les témoignages, et reconstruit heure par heure cette matinée de chaleur écrasante où la troisième compagnie du premier bataillon reçoit l’ordre de « tenir coûte que coûte » pour couvrir le repli des autres unités. À mesure que le récit s’approche du plateau de Brenelle, le texte se resserre, gagne en blancheur : très peu de commentaires, presque pas de psychologisme, mais la juxtaposition de documents et de notations de Joë Bousquet lui‑même (D’une autre vie, Lettres à Carlo Suarès), où l’on voit le jeune officier ramener de force des hommes fuyant le fossé, puis se dresser, seul, lorsqu’il comprend « que c’était fini ». L’éclat frappe, le corps s’effondre, et c’est toute la construction du volume qui paraît soudain justifiée : cette blessure ne vient pas interrompre brutalement une vie radieuse, elle accomplit un long travail de mort intérieure, commencé dès la naissance et aiguillonné par la passion amoureuse. Là réside, me semble‑t‑il, la grande force interprétative de Paul Giro : faire de la biographie, non un trop classique enchaînement d’événements, mais la mise au jour d’une logique de destin, sans jamais se livrer au déterminisme paresseux.
Entre “mal natal” et “scène primitive” : une lecture psychanalytique contrôlée
On pourrait craindre, à lire ces lignes, une biographie pesamment psychanalytique. Il n’en est rien. Certes, Paul Giro revendique le recours à un lexique freudien – « mal natal », « scène primitive », « compulsion de répétition » – mais il l’adosse constamment aux textes de Joë Bousquet, qui lisait Freud, et aux diagnostics implicites portés par Jean Paulhan ou René Nelli. Là où tant d’essais se contentent de plaquer une grille, l’auteur travaille à partir des lettres, des articles, des journaliers, de ces carnets noirs où Joë Bousquet note ses insomnies, ses fantasmes, sa haine de soi. Le résultat est une prose biographique très tenue, d’une grande clarté, qui ménage cependant des percées lyriques : un portrait de la mère, une description de la campagne audoise, quelques pages bouleversantes sur le jeune soldat qui, entre deux attaques, relit ses vers et rêve encore d’une vie d’homme debout. On sent, derrière le biographe, le lecteur de Paulhan et des moralistes, attentif à l’inflexion d’une phrase, à un adjectif qui trahit un basculement intérieur.
Sortir Joë Bousquet du purgatoire littéraire : la révolution opérée par Paul Giro
Enfin, il faut dire un mot de la place de ce livre dans le paysage critique. Joë Bousquet, on le sait, demeure un écrivain de l’entre deux : trop singulier pour entrer dans les manuels, trop identifié à sa légende carcassonnaise pour être lu dans la continuité de son temps. « Prisonnier d’une mythologie », notait déjà la présentation de l’éditeur ; « confiné dans un purgatoire littéraire », renchérira Bernard Baillaud, saluant dans cette biographie l’ouverture d’« une nouvelle période » des études « bousquétiennes ». Le Grand Prix de la critique littéraire 2025, qui est venu couronner le volume, n’a rien d’un prix de circonstance : il entérine le sentiment, largement partagé, que Paul Giro a déplacé la donne, en sortant Joë Bousquet du carcan régionaliste où certains l’avaient enfermé pour le rendre enfin à la grande histoire de la littérature du XXᵉ siècle.
Reste l’essentiel : le bonheur de lecture. Car malgré la masse de documents mobilisés, ce premier tome se lit avec l’élan d’un roman – roman noir d’une enfance mortifère, roman de formation d’un adolescent rétif, roman de guerre enfin, mais où l’héroïsme se gondole, se fissure, laisse passer la peur, le dégoût, la tentation de fuir. Giro réussit cette chose rare : maintenir l’exigence érudite d’une édition critique et la relance narrative d’un feuilleton, en terminant chaque chapitre sur un léger suspens, un détail promis à revenir plus tard, un mot de Joë Bousquet qui fait écho à un texte de maturité. Le lecteur bousquétien y trouvera de quoi revisiter Traduit du silence, La tisane de sarments ou le Cahier noir à la lumière de leur soubassement biographique ; le lecteur non initié y rencontrera une figure d’écrivain d’une puissance insoupçonnée, dont la vie, déjà, a la densité d’une fiction extrême.
La naissance de l’écrivain immobile : ce que promettent les prochains volumes
On referme Mourir ! 1897‑1918 avec l’impression d’avoir accompagné Joë Bousquet jusqu’au bord du plateau de Brenelle, d’entendre encore le silence après le choc du métal dans la chair, et de savoir que, pour lui comme pour nous, l’histoire ne fait que commencer. On attend désormais les deux autres volets de cette Biographie d’une mort à l’autre – la lente invention de l’écrivain immobile, la chambre devenue cosmos, le réseau de correspondances avec Jean Paulhan que l’éditeur annonce déjà en trois volumes – avec une impatience presque physique. Qu’un livre de critique et de recherche suscite ce type d’attente romanesque est le meilleur signe : Paul Giro n’a pas seulement rendu justice à Joë Bousquet, il a réinscrit sa vie dans le grand récit de notre modernité blessée, et l’on se surprend à guetter la suite comme on attendrait le prochain chapitre d’un feuilleton dont on sait, tragiquement, que la fin est déjà écrite, mais dont tout l’enjeu est, précisément, de nous apprendre à relire cette fin autrement.