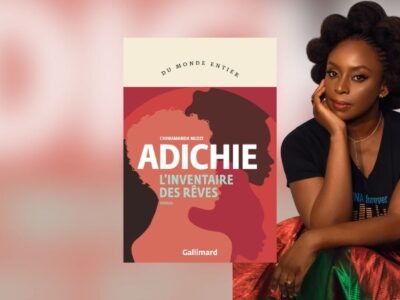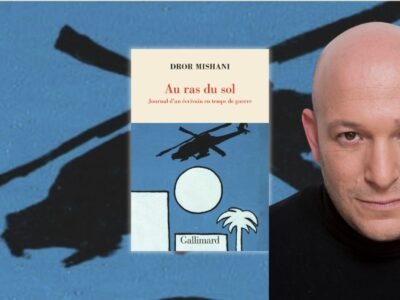Frederika Amalia Finkelstein, Aimer sans savoir, être sans comprendre, Gallimard, 26/10/2023, 1 vol. (130 p.), 16€.
Aimer sans savoir, être sans comprendre est un questionnement poétique sur la manière dont les événements historiques configurent les destinées individuelles. Frederika Amalia Finkelstein, l’autrice et narratrice, relate à quel point son existence témoigne du “monde qui cogne dans l’intime”.
À l’occasion d’un séjour en Argentine, pays, où fuyant les persécutions perpétrées contre les Juifs, son arrière-grand-père et son grand-père polonais ont trouvé refuge et où sa mère est née, la narratrice interroge avec subtilité et sensibilité la thématique de l’identité. À l’aune de l’histoire de l’Argentine et de celle de sa famille, elle se demande notamment ce que signifie et implique être de quelque part et ce que produit la transmission de l’exil d’une génération à l’autre.
L’Argentine terre d’exil et de recommencements
Si, dans les années 1920, l’installation de son arrière-grand-père et de son grand-père en Argentine est “liée au cauchemar de l’histoire” (les pogroms qui eurent notamment lieu à Cracovie), en accostant dans le port de Santa Fe, ils ne surent pas moins qu’ils se trouvaient sur une “terre de recommencements” possibles.
Ayant grandi en Argentine dans une famille juive orthodoxe, épris de liberté et d’arts, Jacob – le grand-père de la narratrice – monta, à 18 ans et au hasard, dans un bus pour Resistancia, une ville de la province désertique du Chaco dont le nom lui inspira confiance ! Là, Jacob rencontra Elsa, sa seconde épouse qui donna naissance à la mère de la narratrice. Conformément à ses aspirations, Jacob prit part à la création du Fogon de los arrieros, un espace culturel où se retrouvaient des artistes divers et où se donnaient des lectures, des conférences et des concerts dans un contexte sensible à la politique.
La naissance d’un fils souffrant de troubles mentaux amena Jacob et Elsa à devoir renoncer à la vie intéressante qu’ils avaient à Resistancia. Dans les années soixante, “la génétique venant configurer leur destin”, la nécessité de trouver une structure apte “à accueillir le mal-être et la singularité” de leur fils imposa le déménagement à Buenos Aires. Se sentant d’abord arrachée à son monde et avant un nouveau “cauchemar de l’histoire”, la mère de la narratrice finit par apprivoiser la capitale.
Au moment de son entrée dans la vie adulte, la mère de Frederika Amalia Finkelstein porte en elle deux Argentines très opposées : celle des possibles et celle de l’extrême violence. Au début des années 1980, ravivant l’expérience douloureuse du déracinement de ses aïeux déposée en elle tel un héritage de l’ombre, la seconde la contraint à l’exil en France ; exil que la narratrice dit avoir à son tour « avalé » en venant au monde, exil “qui s’est tapi dans mon corps”.
L’Argentine terre de dictature
À partir de 1976, la dictature militaire et ses escadrons de la mort déversent des torrents de violence extrême sur l’Argentine. Pour la mère de la narratrice, s’exiler est devenu une évidence au regard de la lancinante et terrible question qui alors tenaillait de nombreux résidents en Argentine : “qui était sur les listes ? Qui n’y était pas ?”. En effet, tous et toutes savaient que les vies étaient confisquées sur la base de dénonciations et de malentendus, “qu’on assassinait par fratries, par cercles d’amitiés ou de travail”.
Largement partagée, la peur d’être enlevé chez soi, de venir grossir le flot des Disparus était d’autant plus accaparante et centrale pour la mère de la narratrice qu’elle faisait inévitablement écho à celle de son arrière-grand-père et de son grand-père fuyant les pogroms et leurs innommables listes et délations. Alors qu’elle démarrait tout juste ses études supérieures, elle était anéantie par un régime politique qui, “pendant que des femmes accouchaient de force, les yeux bandés, et se voyaient retirer leur enfant instantanément sans l’avoir touché, sans l’avoir vu”, avait l’audace ignominieuse d’organiser la Coupe du monde de football en 1978.
Petite fille, la narratrice a vécu intensément la terreur politique et la peur qui s’était infiltrée partout sans entendre les mots de sa mère pour la dire, privée de la moindre prise, sans aucun pouvoir… Cela alors qu’elle voyait cette terreur et cette peur sur le visage de celle-ci qui, exilée en France, imperturbablement lui refusait toujours d’y accéder, substituant à l’indicible, des adages clichés détestés : “il faut se blinder, il faut penser à autre chose”.
La mère de la narratrice s’est évertuée à être économe de ses mots afin que le monstre ne sorte pas de sa boîte. Sa seule concession fut le mot “cafard”. Pendant l’enfance de Frederika Amalia Finkelstein, en permanence ce mot “se promenait à la maison : quel cafard, ça me donne le cafard…”. Sans équivalent dans la langue argentine, c’est l’expression de la langue française “avoir le cafard”, qui autorisait donc sa mère à nommer indirectement le monstre.
L’Argentine et la France : "ce vertige de l’entre-deux"
La douleur de l’exil que la mère de la narratrice, à la fois, taisait et criait en usant si souvent du mot “cafard” s’est ancrée dans le cœur de sa fille, transformant l’exil géographique de la première en l’exil corporel et langagier de la seconde ; le cafard de la mère a été comme inoculé dans le sang de la fille, scandant douloureusement l’amour qui les liait.
Privée de la mise en mots de l’histoire de sa famille maternelle, de ses cruels exils successifs mais aussi de ses recommencements et élans vitaux, le quant-à-soi de la narratrice a donc pris forme dans le silence : en effet, comment dire ce dont l’accès nous est fermé ? Comment faire avec une fermeture posée par amour ? Comment avoir confiance en ses propres mots quand leurs assises réelles et imaginaires sont obstinément tues ?
Ne pas savoir et ne pas comprendre pour cause de non-transmission a d’abord installé la narratrice dans “la peur de dire, de s’adresser”. Cette peur s’est matérialisée dans ce qu’elle nomme “la désagrégation de mon langage” jusqu’à la perte d’identité et la honte afférente associée à la conviction suivant laquelle : “je ne suis rien, alors je n’ai rien à dire”. Puis, li y a eu la certitude qu’elle devait sortir du silence et de la honte en affirmant qu’elle était de quelque part et qu’avec l’écriture, elle pouvait dire.
À la trentaine, c’est notamment en parcourant seule Buenos Aires à pied que Frederika Amalia Finkelstein a reconnu avec intensité que l’Argentine est le lieu de la mémoire qui lui a tant manqué, le pays des siens, entre amour et “vérité de la peur” dont, jusque-là, elle n’avait pas les codes d’entrée. L’assurance d’être de ce pays l’investit au moment de la mort de Diego Maradona (novembre 2020) et de l’hommage grandiose tout aussi immodéré et insensé que lui rend le peuple argentin. Se demandant ce qui lui a pris d’être dans la rue ces jours-là, elle perçoit que son appartenance à l’Argentine est aussi forcément faite du rapport de ce pays au football : “une relation charnelle, éminemment politique”.
Alors que la narratrice est soucieuse de ne plus avoir à affronter “l’épuisement des combinaisons de mots” hérité de son enfance et de lui substituer la “foi dans le langage”, c’est une peinture d’Edwin Parker Twombly Junior vue lors d’un voyage en Italie qui va l’amener à retrouver le chemin de l’écriture. Ce tableau lui suggère que de la vulnérabilité peut sortir la force et qu’écrire peut cesser d’être “le combat de la grammaire et de la fureur” pour devenir “la simple traversée par l’alchimie”.
Aimer sans savoir, être sans comprendre est la voix profondément habitée d’une jeune femme qui, questionnant le vertige que longtemps les non-dits lui ont provoqué, suggère “comment l’Histoire et l’intime se rencontrent pour faire naître un destin ?” Quand elle parvient enfin à faire usage de l’oralité et de l’écriture pour savoir et comprendre d’où elle est, plurielle et suffisamment libre, elle peut appréhender la plénitude de sa mère par-delà la souffrance qui l’a entravée : “Tu es argentine. Tu es juive. Tu es française. Tu es d’Europe. Tu es du monde”. Oui, sa mère est tout cela aussi et c’est une chance…
Chroniqueuse : Eliane le Dantec
NOS PARTENAIRES
Faire un don
Vos dons nous permettent de faire vivre les libraires indépendants ! Tous les livres financés par l’association seront offerts, en retour, à des associations ou aux médiathèques de nos villages. Les sommes récoltées permettent en plus de garantir l’indépendance de nos chroniques et un site sans publicité.