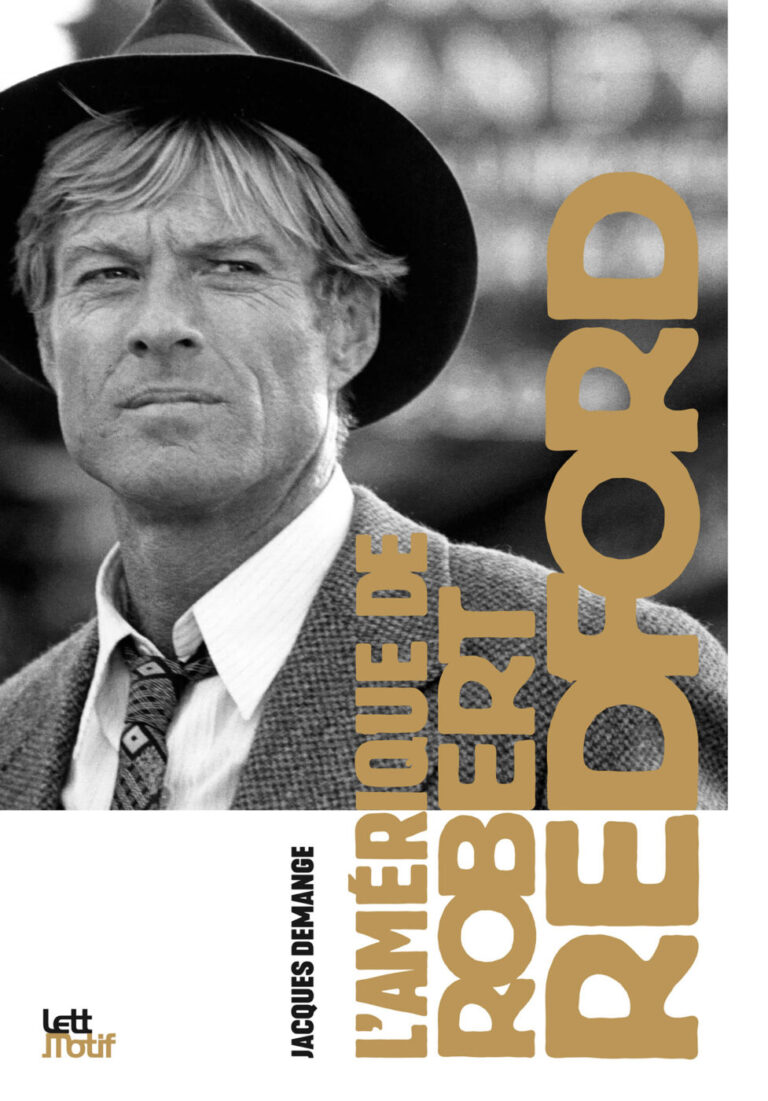Alice Kaplan, Baya ou le grand vernissage, Le Bruit du Monde, 02/05/2024, 264 pages, 23,00 €
Baya Mahieddine, figure iconique de l’art algérien, incarne à la fois le génie artistique et le destin tumultueux d’une nation tiraillée entre héritages coloniaux et affirmation d’une identité souveraine. Son ascension fulgurante dans les cercles artistiques parisiens en 1947, à l’âge de 15 ans, s’est opérée sous le signe du “primitivisme”, faisant d’elle une figure fantasmée, entre exotisme et instrumentalisation. Alice Kaplan, écrivaine et historienne, professeur de littérature française à Yale, nous entraîne avec Baya ou le grand vernissage dans une fascinante enquête mêlant biographie et réflexion socio-historique, faisant ressortir les multiples regards qui ont convergé vers cette artiste extraordinaire.
Baya avant Paris : une enfance volée et la découverte d’un don
Baya n’est pas née sous une bonne étoile. Orpheline de père dès l’âge de sept ans, puis de mère à neuf, Fatima Haddid, son véritable nom, se retrouve confiée à sa grand-mère dans le douar Sidi M’hamed, quartier indigène situé en marge d’Alger. Son enfance est marquée par la pauvreté, l’exploitation, et la violence. Forcée de travailler dans la ferme florale d’Henri Farges, c’est là que son don va se révéler, alimenté par l’observation et l’assimilation des formes et des couleurs de son environnement. Les parterres de strelitzias, surnommées “oiseaux de paradis” avec leurs couleurs chatoyantes, deviendront un leitmotiv de ses gouaches.
C’est en feuilletant les magazines de mode de Mireille, la fille de son employeur, que Baya va s’approprier l’esthétique des jupes : vastes étendues de couleur accueillant un monde foisonnant de fleurs, d’oiseaux, de motifs géométriques. “Des années plus tard, dans le silence d’une chambre d’hôtel à Toulon, elle dira à sa belle‑fille Salima que ces magazines marquent le début de sa vie de peintre”, écrit Alice Kaplan. Ses premières œuvres ne s’inscrivent pas seulement dans une découverte du style et de la couleur européennes, mais puisent aussi leur source dans les traditions de la Kabylie : rayures et carreaux des robes, ornements céramiques. Alice Kaplan nous rappelle ainsi l’influence méconnue de l’art islamique sur Baya. Elle évoque l’artiste et calligraphe Mohamed Racim et ses miniatures aux motifs floraux et aux figures féminines, faisant écho au bestiaire fantastique qui habite les gouaches de Baya.
Marguerite et Frank : entre mécénat et ambiguïtés coloniales
L’arrivée de Marguerite Caminat dans la vie de Baya est le moment fondateur, l’élément déclencheur d’un destin exceptionnel. Tombée sous le charme du “génie” de l’enfant, Marguerite, mariée au peintre anglais Frank McEwen, l’installe chez elle en qualité de domestique. Si ce choix peut paraître ambigu à l’heure d’une réflexion critique sur le colonialisme, il faut toutefois le nuancer en prenant en compte le dévouement profond de Marguerite envers Baya. Alice Kaplan souligne toutefois le vocabulaire employé par Marguerite : “On me la donne”, trahissant une relation fondée sur un rapport de possession. Elle encourage son émancipation officielle vis-à-vis d’une grand-mère jugée abusive et violente, lui offrant accès à une nouvelle vie.
L’appartement de Marguerite devient alors un espace de liberté où Baya développe sa pratique artistique, entourée des tableaux et des livres d’art de Frank. Celui-ci, obsédé par sa propre quête de reconnaissance, observe d’abord Baya à travers le prisme d’une certaine condescendance. Fervent partisan d’une théorie, chère aux surréalistes, selon laquelle le génie artistique est présent chez tous les enfants avant de s’estomper à l’âge adulte, il se désintéresse progressivement de Baya. Alice Kaplan explore avec finesse la complexité de ce personnage : issu d’une riche famille anglo-juive liée aux milieux artistiques parisiens, McEwen s’est construit une identité en rejetant son héritage et son véritable nom, devenu une source de danger dans la France occupée. Son mariage avec Marguerite l’a sauvé, lui permettant de s’installer en Algérie où il bénéficiera du confort d’une vie bourgeoise et des privilèges d’un “Blanc” dans la société coloniale.
La perception de Baya par le monde européen est indissociable de la fascination exercée par les contes berbères que Marguerite transcrit avec assiduité, les considérant comme des témoignages bruts et authentiques d’une culture “primitive”. Alice Kaplan souligne la dimension à la fois tragique et fantasmée de ces récits. La grand-mère sorcière, la mère prostituée, la misère du douar : autant de clichés que la presse se fera un plaisir d’exploiter. Le titre d’un article paru dans Combat en novembre 1947 est symptomatique : “Baya, la petite-fille de la sorcière”. La voix de Baya se trouve ainsi médiatisée, déformée, réduite à une image exotique.
Paris 1947 : un vernissage au cœur des tensions postcoloniales
Quand Baya débarque à Paris en novembre 1947 pour son vernissage à la galerie Maeght, son arrivée est orchestrée avec soin par Aimé Maeght, Marguerite, et le cadi Benhoura, juge musulman chargé de veiller à son bien-être. L’enjeu dépasse le cadre artistique : il s’agit aussi d’une tentative de démonstration d’apaisement dans le climat tendu des relations franco-algériennes. Les massacres de Sétif et Guelma de 1945, réponse brutale du gouvernement français aux revendications nationalistes, hantent encore les mémoires.
L’exposition Baya se situe ainsi au carrefour de multiples enjeux : Yves Chataigneau, gouverneur général de l’Algérie et artisan malheureux d’une impossible réforme, espère montrer une Algérie apaisée. Kaddour Ben Ghabrit, recteur de la Grande Mosquée de Paris, se fait le gardien des traditions musulmanes, veillant à ce que Baya porte ses somptueuses robes traditionnelles confectionnées par des artisans d’Alger. La presse française, quant à elle, se jette sur le sujet, exploitant les contes rapportés par Marguerite, fabriquant une légende. Baya incarne malgré elle l’espoir d’un impossible “mariage d’amour”, formule employée avec un cruel cynisme par un préfet d’Alger en 1947 pour évoquer l’idéal fantasmé de l’union entre colonisateur et colonisé.
Les regards croisés sur Baya : Breton, Picasso, Matisse, Camus
Le succès de Baya va l’exposer aux regards, aux analyses, aux jugements d’une pléiade d’artistes et d’intellectuels. Alice Kaplan restitue avec précision les positions de chacun, les croisant avec sa propre lecture du parcours et de l’œuvre de Baya. Pour André Breton, fasciné par les formes “primitives” et l’art des enfants, Baya représente une source d’inspiration dans un monde occidental qu’il juge décadent. Elle est “le début d’un âge d’émancipation et de concorde”, écrit-il dans le catalogue de l’exposition.
André Breton et les surréalistes n’étaient pas les seuls, en 1947, à percevoir les enfants comme des figures de l’espoir après le traumatisme de la guerre. Le cinéma néoréaliste italien (Rosselini, De Sica), les films français comme “Jeux interdits”, montraient des enfants chargés de reconstruire un monde dévasté. Baya, avec sa jeunesse, son expression artistique débordante de vie, s’inscrit dans ce contexte. Mais Alice Kaplan souligne qu’on ne sait pas ce que Baya pensait de ces projections. Elle répondait volontiers : “Quand je peins, je suis dans un autre monde, j’oublie”. Face aux grands hommes, elle saura garder son intégrité.
Matisse quant à lui, admiratif, verra dans son travail une confirmation de ses propres intuitions, nourries par la lumière algérienne qu’il avait découverte au début du siècle. Plus tard, en 1948, Baya sera invitée dans les ateliers de céramique de Vallauris où elle rencontrera Picasso, l’observateur avisé de ses figurines d’argile, qui, selon certains, aura trouvé en elle une inspiration pour sa propre pratique.
Alice Kaplan, loin de se contenter de la rhétorique des influences, questionne le mythe de l’artiste « primitive » et l’appropriation par le modernisme européen. Baya a certes pu être influencée par ces artistes, mais elle ne les a jamais cités. Alice Kaplan note : “Elle savait déjà quel genre d’artiste elle était”.
Albert Camus, qui a fait la connaissance de Baya à Alger, a pour elle une tendresse particulière. Témoin des massacres de Sétif et Guelma, confronté aux ambiguïtés de l’administration coloniale dans laquelle il travaille lui-même, l’écrivain observe le vernissage de Baya avec un regard plus lucide que les autres invités. Sa formule lapidaire à propos de la jeune fille, “la princesse au milieu des barbares”, reste le meilleur commentaire du vernissage. Elle trahit sa conscience du caractère à la fois triomphal et aliénant de cette consécration parisienne.
Au-delà de l’Exposition : Baya après Paris, silences et résilience
L’après-Paris est un temps de ruptures et de retours. Marguerite et Baya sont séparées à la suite d’une décision judiciaire. Mariée de force à un homme beaucoup plus âgé qu’elle, Baya cesse de peindre et disparaît de la scène artistique pendant près de dix ans. La révolution algérienne marque un tournant. Encouragée par Mireille Farges et Jean de Maison, fervent partisan de l’indépendance et futur directeur du Musée des Beaux-Arts d’Alger, Baya reprend ses pinceaux et participe à la construction d’un nouvel art algérien. Alice Kaplan souligne l’ambiguïté de cette période : on reprochera parfois à Baya son lien avec les Français, la considérant comme une artiste instrumentalisée par le pouvoir colonial, alors que sa décision de se remettre à peindre est avant tout un acte personnel. Elle est déterminée à construire une “vraie vie” autour de sa famille et de son art.
Son travail se développe dans les années qui suivent l’indépendance : ses femmes, ses enfants, ses oiseaux occupent désormais de vastes espaces délimités par un trait noir plus affirmé. En 1969, la poste algérienne émettra un timbre reproduisant un de ses tableaux : une consécration qui inscrit son œuvre dans l’imaginaire national. Baya devient une icône, une source d’inspiration pour une génération d’artistes algériens. Comme le résume l’écrivain et éditeur algérien Sofiane Hadjadj : “nous cheminons depuis notre enfance avec Baya… ses personnages font partie de notre paysage mental”.
Au-delà de l’Exposition : Baya après Paris, silences et résilience
Alice Kaplan ne propose pas une hagiographie. Le destin de Baya reste contesté : certains la voient comme une victime d’un système colonial qui s’est approprié son talent, une figure soumise à la domination masculine au sein de la société algérienne. D’autres saluent son indépendance, sa force créatrice qui transcende les catégories, une figure précurseure du féminisme et d’un art national. L’œuvre elle-même continue d’interpeller avec ses couleurs audacieuses, sa maîtrise ludique des styles et des motifs, occidental et nord-africain, inventant une langue propre, une résistance au vacarme des interprétations.
Baya ou le grand vernissage nous rappelle que derrière le mythe, derrière le regard colonial et les attentes d’une époque tourmentée, Baya n’a jamais cessé d’affirmer son autonomie à travers sa pratique artistique. L’ouvrage d’Alice Kaplan, à travers une écriture à la fois sensible et rigoureuse, nous permet d’approcher la complexité de ce destin exceptionnel et de mieux comprendre l’héritage puissant, encore palpable aujourd’hui, de Baya Mahieddine.

NOS PARTENAIRES
Précédent
Suivant