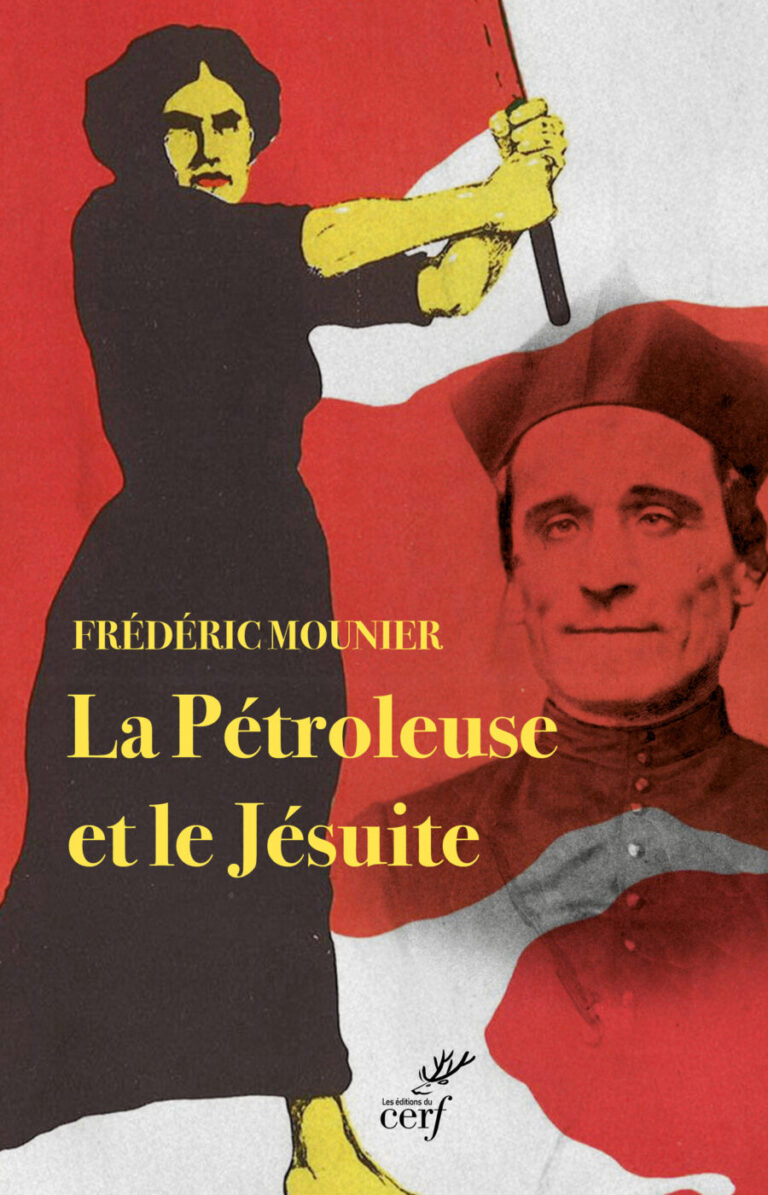Tehila Hakimi, 16 parties de chasse, traduction de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech, Denoël, 20/08/2025, 208 pages, 20€
Découvrez notre Podcast
Un tir. Un arbre. Et le silence qui s’ensuit. Dans ce silence primordial, Tehila Hakimi installe d’emblée la pulsation de son roman : celle d’une précision qui frôle la cible et révèle un monde où chaque geste est une balistique du pouvoir, chaque regard une ligne de mire. 16 parties de chasse s’ouvre sur cette scène fondatrice où une femme, une ingénieure expatriée en Amérique, apprend une nouvelle grammaire du territoire et de l’existence, celle du chasseur. Mais la véritable proie se dérobe, mobile, changeante, fuyant des forêts glacées de l’Amérique du Nord aux open spaces aseptisés du capitalisme transnational.
Publié en cette rentrée littéraire 2025 aux éditions Denoël dans la collection “& D’ailleurs”, et porté en français par la traduction sensible et exacte de Rosie Pinhas-Delpuech, ce roman de l’autrice israélienne Tehila Hakimi incarne une voix littéraire singulière, qui explore les fissures du monde contemporain avec une acuité poétique et politique redoutable.
La structure même du livre, découpée en seize parties de chasse numérotées, orchestre une mécanique narrative implacable. Chaque “partie” est un fragment, une scène ciselée qui travaille la psyché de la narratrice, une femme dont on ne saura jamais le nom, comme si son identité se dissolvait dans sa fonction et son déracinement. La prose est blanche, tendue, faussement détachée. Tehila Hakimi cisèle une langue qui mime l’épuisement et le contrôle de soi. Les phrases, courtes et factuelles, décrivent des procédures – régler un viseur, écrire un e-mail à un client, nettoyer un fusil, dépecer une bête – et laissent le vertige sourdre dans les interstices, dans les ellipses entre un chapitre et l’autre. Le récit se déploie à la première personne, nous emprisonnant dans le champ de vision étroit de cette femme qui observe tout, analyse tout, mais peine à nommer l’oppression diffuse qui l’enserre.
16 parties de chasse ausculte la condition d’une femme naviguant dans un univers masculin où la technique, le pouvoir et la violence s’entremêlent. La multinationale qui l’emploie est un premier terrain de chasse, un biotope où la survie exige l’apprentissage de codes culturels et linguistiques opaques. Sa collègue américaine lui apprend à amender la rudesse de son hébreu, à enrober ses e-mails de formules pour ne pas paraître autoritaire, car “Chacun a déjà un directeur sur le dos”. Le travail est un théâtre de la performance, une aliénation qui contamine jusqu’à la sphère intime. Cette violence symbolique de l’entreprise trouve son double concret, presque rituel, dans la chasse au cerf, où son collègue David l’initie.
David est la figure pivot du roman, mentor ambivalent, figure paternelle et prédateur potentiel, qui lui prête son premier fusil et l’invite à entrer dans ce cercle viril. Leur relation, faite de silences pesants et d’une camaraderie technique, révèle les dynamiques de pouvoir et de désir qui traversent les corps. Le corps de la narratrice est ici un enjeu central : il est le lieu du contrôle – par le jogging, la diète imposée par le dégoût, la discipline de la tireuse – mais aussi de la mémoire involontaire, du souvenir du service militaire en Israël qui resurgit dans la manipulation des armes. Il est le territoire ultime où s’inscrivent la solitude de l’exilée et la menace d’une appropriation. Le roman superpose brillamment la militarisation des corps, héritée de la société israélienne, et la logique prédatrice de la culture d’entreprise américaine.
C’est ici que l’œuvre prend toute sa portée politique. La chasse, à défaut d’être la toile de fond, devient la métaphore du système qu’elle dissèque. Viser le “tir propre”, la “kill zone” pour abattre l’animal sans souffrance inutile, devient l’écho troublant de l’efficacité managériale qui peut éliminer un poste avec la même froideur clinique. Dans ce jeu de miroirs, les rôles de chasseur et de chassé deviennent réversibles. Si la narratrice apprend à tuer, elle est aussi constamment évaluée, observée, menacée de devenir superflue, elle-même une cible pour la restructuration de son entreprise. Son combat pour exister est une guérilla silencieuse, où elle affûte non seulement ses compétences de tireuse mais aussi ses stratégies de survie.
Peut-être la véritable interrogation du livre se niche-t-elle dans une réplique glaçante sur la proximité phonétique entre deux mots anglais : “womb” et “tomb”, l’utérus et la tombe. L’autrice interroge la place d’un corps de femme, capable de donner la vie, dans un monde obsédé par la maîtrise et la mort. 16 parties de chasse est ainsi une œuvre d’une puissance tellurique, qui capture l’épuisement d’une époque et le combat sourd d’une femme pour ne pas devenir une simple proie dans la grande partie de chasse existentielle. Le roman se referme, mais en nous, lecteurs, une vibration sourde persiste, celle d’une question en suspens, d’une cible encore floue à l’horizon. La dernière balle n’a peut-être pas encore été tirée.