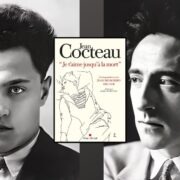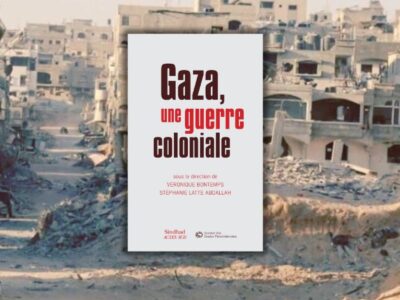Jennifer Kerner, Le mari de nuit : expériences du deuil et pratiques funéraires, Gallimard, 05/10/2023, 1 vol. (217 p.), 20 €.
Car une fois passé le deuil du mort, une épreuve autrement insurmontable s’impose : le deuil impossible de la première histoire d’amour perdue. Guérir de la perte d’un homme prend du temps. Guérir de la perte d’un premier amour, même l’éternité n’en viendrait pas à bout.
Un récit de perte et d'amour
Avec Le mari de nuit, Jennifer Kerner nous offre un récit tout à la fois intime et universel, mêlant le témoignage personnel sur son propre deuil à une réflexion anthropologique stimulante sur le rapport des sociétés humaines à la mort. Tout commence par une blessure profonde et irréparable : la perte brutale d’une overdose à vingt ans de J. – ce mari de nuit –, son premier amour. C’est à la suite de ce drame, pour tenter de donner un sens à l’absurdité de cette disparition, que la jeune Jennifer décide de se consacrer corps et âme à l’étude archéologique des rites funéraires à travers les âges et les cultures. Comme Friedrich Novalis à la mort de Béatrice, l’écriture devient l’acte mémoriel. En couchant sur le papier le souvenir du premier amour disparu, l’autrice lui insuffle une nouvelle vie et l’arrache à la mort. Ses mots font renaître la présence, ravivent les traits aimés, raniment la flamme éteinte. Dans le dialogue entre Jennifer et J., on retrouve dans Le mari de nuit, le même romantisme et la même puissance initiatique que dans les Hymnes à la nuit de Novalis.
Ici-bas, nous avons fort peu parlé de toi. Les circonstances de ton départ ont été tues. Tu es "parti" comme en voyage, sans laisser d’adresse. Même mes plus proches amis ne savent pratiquement rien de ce que tu étais. Il faut croire que tu étais cadenassé dans un coffre-fort secret au fond de ma mémoire et que, jalouse de te garder pour moi, j’avais jeté les clés. Aujourd’hui, j’ai décidé de te rendre ta liberté entre les pages d’un livre… Car c’est bien l’endroit où vivent mieux les morts.
S’ensuit alors un fascinant voyage à la découverte des traditions liées à la mort : de l’embaumement dans l’Égypte ancienne aux funérailles collectives imaginées dans le Japon contemporain, en passant par le cannibalisme, rituel pratiqué par certaines tribus, ou les moines du Tibet qui démembrent les corps avant de les confier aux oiseaux. Chaque escale est l’occasion de s’émerveiller de l’infinie créativité déployée par l’humanité pour apprivoiser l’absence de l’être aimé. Mais au fil des pages percent aussi l’amertume et la colère de Jennifer Kerner lorsqu’elle constate, au détour d’une phrase ou d’un regard, combien nos sociétés occidentales contemporaines se sont appauvries spirituellement, au point de réduire les obsèques à leur plus simple expression technique et matérielle. C’est là tout le génie et l’originalité de cet essai intimiste : à travers le prisme d’une blessure personnelle, interroger les carences de notre modernité en matière de rituels funéraires, au sein d’une société occidentale qui “nie et réprime” toute idée de mort. Car, qui mieux qu’une endeuillée peut porter un regard à la fois sensible et lucide sur nos tabous et nos dénis face à la mort ?
Regarder la Mort droit dans les yeux est encore le meilleur moyen de ne pas trop se tromper à son sujet… Et lorsqu’on se trouve face à un ennemi aussi redoutable qu’omniprésent, mieux vaut se montrer lucide !
Une plongée bouleversante dans l'intimité du deuil
La force de l’ouvrage de Jennifer Kerner est de nous plonger au plus près de l’expérience du deuil, dans ce qu’elle a de plus viscéral et de douloureusement physique. Avec pudeur mais sans fard, l’auteure nous fait ressentir toute l’ampleur du vide laissé par la mort de J., cette sensation de manque irrémissible, d’injustice ultime. Elle évoque ses nuits sans sommeil, ses crises de larmes incontrôlables, cette impression tenace que le monde s’est éteint avec l’être aimé.
“J’avais l’impression de tomber dans un puits de tristesse dont les bords tranchants me lacéraient la peau au fur et à mesure que je chutais”, confie-t-elle dans un passage poignant, mais également :
Je circumambule dans notre salon à en user le tapis persan qui, pourtant, en a vu d’autres, mais qui n’a jamais été piétiné par femme plus désespérée en trois cents ans d’existence [...] Tu es sur le canapé, mort depuis la nuit des temps. Je ne sais pas quoi faire de toi et de mon chagrin.
Cauchemar éveillé où elle erre comme une âme en peine, incapable de réaliser pleinement la perte de l’être aimé. L’appartement familier est devenu territoire hostile, lieu d’une présence-absence obsédante. Autre passage déchirant : lorsqu’elle évoque le lent travail d’effacement des traces de J., elle utilise cette formule glaçante : “À l’eau, à l’eau tous tes souvenirs de camelot.” On devine derrière la métaphore légère toute la violence qu’il a fallu déployer pour vider l’espace des reliques du disparu, ces “encensoirs à tristesse“. Enfin, elle confie avec un sens aigu de la formule, avoir eu l’impression pendant toutes ces années “de [se] vautrer dans la douleur après avoir essayé, vainement, de la chasser.“
Cette idée de “se vautrer dans la douleur” face à un deuil fait directement écho à la fameuse formule de Schopenhauer selon laquelle “la douleur est l’essence même de la vie“. Pour le pessimiste allemand, il n’est nul bonheur terrestre qui ne porte en lui le germe de la souffrance et du manque. Dans cette perspective, s’abandonner corps et âme au chagrin quand l’être aimé disparaît ne serait donc pas qu’un simple réflexe masochiste ou morbide. Ce serait dans une certaine mesure répondre à l’appel tragique au cœur de la condition humaine. En choisissant de ne pas fuir la douleur, l’endeuillé accomplit le destin de l’homme éternellement voué à souffrir. Jennifer assume pleinement le tragique de la perte, au lieu de le nier ou de le fuir dans des faux-semblants d’apaisement.
Elle fait même de ce tragique le moteur d’une quête spirituelle, à la manière des ascètes qui cherchent l’illumination à travers la mortification. Sa souffrance devient une sorte de compagne mystique, une amie paradoxale avec laquelle elle entretient une étrange relation de familiarité, et même de nécessité.
Bien sûr, un tel choix comporte le risque de sombrer dans une souffrance autocentrée, qui ne mènerait à rien de transcendant. Mais dans le cas de Jennifer Kerner, ce compagnonnage douloureux avec l’absence de l’autre l’entraîne vers une forme de sagesse : celle de mieux comprendre et de sublimer les rituels funèbres humains.
“La vie est tissée avec les fils de la douleur, chaque pas en avant est un arrachement dans la chair, une blessure de l’âme et il faut pourtant avancer car la loi est immuable“, écrivait Maurice Magre en 1941…
Un fascinant voyage anthropologique autour de la mort
Heureusement, le chagrin de Jennifer Kerner trouve un exutoire dans le travail. En se lançant à corps perdu dans ses recherches archéologiques, elle canalise sa peine dans un projet intellectuel exigeant : comprendre comment l’humanité, depuis la nuit des temps, affronte la mort et tente de l’apprivoiser à travers ses rites. Commence alors un passionnant périple anthropologique qui nous conduit tour à tour dans les hypogées égyptiens, sur les sites funéraires mésolithiques de Chine, ou encore dans les villages malgaches prompts à “retourner” leurs morts dans de joyeuses cérémonies collectives.
Ainsi, lors de son passage à Madagascar, elle assiste à l’un de ces fameux “retournements” des défunts si caractéristiques de certaines traditions locales. Au bout de quelques années, les ossements des disparus sont exhumés, nettoyés, puis réinhumés au cours de joyeuses cérémonies collectives.
Autre rite intrigant évoqué par Jennifer Kerner, cette fois chez les Sulkas de Mélanésie : pendant plusieurs jours après un décès, il est interdit à quiconque dans le village de… s’endormir ! Objectif : éviter que les âmes encore errantes des vivants ne soient happées par les esprits affamés du défunt. Une manière radicale d’expier collectivement le deuil.
Troisième exemple marquant : la description très vivante de ces fameuses “momies parlantes” en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui intriguent tant notre archéologue. Perchées en haut de falaises escarpées, ce sont des ancêtres embaumés qui veillent sur le village, telles des vigies bienveillantes. Les descendants n’hésitent pas à les “réparer” régulièrement pour qu’elles servent de réceptacle à l’âme des morts… Bref, à chaque page ou presque, le lecteur est happé par ces trouvailles rituelles déconcertantes, à mille lieues des convenances occidentales. Le talent de conteuse de Jennifer Kerner fait de cette odyssée macabre un véritable enchantement ethnologique. Même si elle ne s’interdit pas un regard critique lorsque certains rites lui paraissent reposer sur des conceptions arriérées (notamment le sort réservé aux veuves dans certaines traditions hindouistes), Jennifer Kerner réussit dans l’ensemble à regarder ces pratiques funéraires avec une saine distance ethnologique.
Sa curiosité intellectuelle insatiable et son absence de condescendance sont d’ailleurs ce qui fait tout le sel de son récit de voyage, qui parvient à allier rigueur du propos et enchantement de la découverte.
Un réquisitoire contre la déshumanisation des obsèques modernes
Mais le périple de Jennifer Kerner vire parfois au chemin de croix lorsqu’elle prend la mesure, par contraste, du terrible appauvrissement spirituel des rituels funèbres dans nos sociétés contemporaines. C’est avec effarement et une colère froide qu’elle décrit la froideur clinique des funérariums occidentaux, où les défunts sont traités comme de vulgaires marchandises dans des complexes commerciaux anonymisés. Car la mort est devenue le fruit d’un business plan élaboré par de jeunes cadres en costume, au sein de ces complexes funéraires impersonnels conçus sur le même modèle que les plus tristes zones commerciales. Comme dans un supermarché, le chaland endeuillé déambule de rayon en rayon pour trouver le cercueil et l’urne qui correspondront au standing du défunt. Mais il y a bien pire :
Dans notre monde où la priorité est de produire, nous peinons à trouver le temps de vivre… Alors, perdre du temps pour réaliser que l’on va mourir, ne m’en parlez pas ! C’est dans ce principe de rendement qu’ont été créés les drive-in de la mort aux États-Unis et au japon. Le principe est la même que pour la restauration rapide. Vous roulez en voiture devant une vitrine, momentanément obstruée, qui contient le cercueil de votre défunt. Lorsque vous passez votre code-barres devant le scanner, le lever de rideau mécanique se déclenche et votre défunt apparaît. Vous pouvez lui faire un simple geste et repartir sans même avoir serré le frein à main.
Zygmunt Bauman dirait que ce phénomène participe de la “modernité liquide”, où tout se consume à grande vitesse, y compris les émotions et les relations humaines les plus profondes. Ce que dénonce Jennifer, c’est la perte du sens du sacré dans nos sociétés hyper rationalisées. Au passage, elle souligne combien le triomphe de la crémation – pratique somme toute assez récente dans l’histoire de l’humanité – prive les endeuillés d’une ultime image du défunt allongé paisiblement. Autre violence symbolique de taille.
Selon le philosophe allemand Walter Benjamin, l’image dialectique désigne la mise en tension de deux temporalités : celle du présent et celle du passé. Contempler cette image, c’est avoir une intuition fulgurante du passé à travers le présent. Or n’est-ce pas exactement ce à quoi nous renvoie cette ultime vision du défunt allongé paisiblement ? En observant le visage endormi de l’être aimé avant la crémation, l’endeuillé perçoit dialectiquement la persistance de son existence passée. Pour quelques instants, le défunt redevient vivant aux yeux de ses proches : l’image fait resurgir le souvenir de sa vitalité avant que les flammes du crématoire ne l’effacent à jamais.
Voilà pourquoi, selon Jennifer Kerner, renoncer à cette vision apaisante du repos éternel, c’est se priver d’une image dialectique essentielle au travail de deuil. Sans cette ultime contemplation, impossible de réconcilier le mystère de ce visage aimé avec la dure réalité matérielle du corps qui se consume et retourne au néant. La crémation coupe court à ce dialogue métaphysique avec le mystère de la mort.
L'urgence de réenchanter nos rituels funèbres
À travers ce récit intimiste aux résonances universelles, Jennifer Kerner sonne donc l’alarme : il y a urgence à réintroduire de la spiritualité et de la sacralité dans les rituels funéraires occidentaux.
Certes, elle ne verse jamais dans un passéisme béat en prônant un simple retour aux traditions ancestrales. En revanche, elle appelle de ses vœux l’élaboration de nouveaux rites, empreints de poésie et propices au recueillement, à même de sublimer la douleur des endeuillés :
Un rite de séparation permet au sujet de sortir de la société par la grande porte, avec un dernier cérémonial, plutôt que sur la pointe des pieds dans des chambres d’Ehpad sordides ou sous la seringue de médecins charitables de nos pays limitrophes.
Au terme de ce périple bouleversant de l’intime à l’universel, le message de Jennifer Kerner est ainsi porteur d’espoir : oui, il est possible de réconcilier modernité et sacré, innovation et tradition, pour rendre toute leur dignité aux défunts comme à ceux qui restent. Oui, il est possible – si on a l’oreille un peu fine – d’entendre le chant mélodieux des morts sous la terre. Tout le bonheur de vivre est dans le souvenir de nos chers disparus. Réenchanter nos morts sans renier nos vivants : telle est l’ambition salutaire de ce vibrant plaidoyer qui touchera encore plus les esprits lumineux qui ont su guérir de l’immense douleur de la perte d’êtres aimés. Ils sont admirables, car eux seuls savent combien la mort est une nouvelle forme de vie que nous ne comprenons pas encore.
“J’ai fouillé les cœurs des autres endeuillés pour en extraire l’encre de ce récit“, écrit Jennifer Kerner. Alors je le dis sans ambages : Le mari de nuit est un vrai chef-d’œuvre qui s’inscrit dans la lignée des écrivains – comme Robert Redeker (L’éclipse de la mort) – qui suivent les pas de l’immense Maurice Maeterlinck qui, en 1913, écrivait dans La Mort :
La figure de la mort, dans l'imagination des hommes, dépend avant tout de la forme de la sépulture ; et les rites funéraires ne règlent pas seulement le sort de ceux qui partent, mais encore le bonheur de ceux qui demeurent, car il dresse tout au fond de la vie la grande image sur laquelle viennent s'apaiser ou se désespérer leurs yeux.

Chroniqueur : Jean-Jacques Bedu
NOS PARTENAIRES
Faire un don
Vos dons nous permettent de faire vivre les libraires indépendants ! Tous les livres financés par l’association seront offerts, en retour, à des associations ou aux médiathèques de nos villages. Les sommes récoltées permettent en plus de garantir l’indépendance de nos chroniques et un site sans publicité.