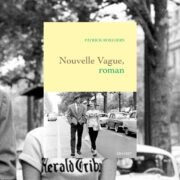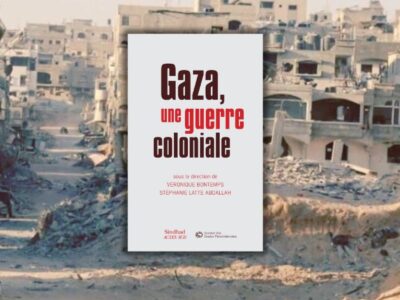Fabienne Kanor, La poétique de la cale : variations sur le bateau négrier, Rivages, 05/10/2022, 1 vol. (432 p.), 23€.
Fabienne Kanor narre son cheminement vers la cale du bateau négrier avec l’espoir de connaître ce qui s’y est passé depuis que “les monstres de bois aux entrailles de chaînes se sont mis à avaler leurs milliers de captifs”. Dès les premières pages de l’ouvrage nous sommes prévenus qu’un tel cheminement se heurte aux nombreuses lacunes obstruant l’accès à la réalité de ce “bas-lieu” où, contre leur gré, l’existence de celles et ceux que l’auteure nomme les “esclavisés” a basculé à jamais.
Pour tenter d’approcher “la cale qui est et qui n’est pas”, Fabienne Kanor fait le choix d’y “redescendre en poésie” en s’appuyant sur des créations artistiques tendues vers la nécessité impérieuse de l’appréhender malgré son indicibilité. L’auteure souligne que dire la cale du bateau négrier c’est devoir notamment affronter des questions vertigineuses et des images terrifiantes, l’aborder comme greffée au corps des esclavisés et de leurs descendants, ou encore, l’envisager au prisme de la symbolique de la chambre.
L’étendue de la lacune en questions et en images
Si l’abolition de l’esclavage (en France, le 27 avril 1848) et sa reconnaissance comme crime contre l’humanité (le 21 mai 2001 pour la France) sont aujourd’hui célébrées, la mémoire très lacunaire de la cale témoigne de la difficulté persistante à penser l’ignominie du commerce triangulaire et de la traite des populations africaines comme fait historique total. Or, vouloir la révéler au grand jour suppose de s’attacher “à débusquer un passé dont le présent a gardé si peu de traces”.
Aspirer à donner une mémoire à la cale comme ont à cœur de le faire les descendants des esclavisés, c’est l’imposer comme moment décisif du voyage sans retour de plusieurs millions de personnes brutalement extirpées de leur maison et de leur monde pour être jetées “dans l’inconfort, l’instable et l’éparpillement”. Cette aspiration à dé-absenter la cale oblige à se poser des questions essentielles telles que : de quel village venaient les enfants, femmes et hommes mis en cale comme des marchandises ? Quels étaient leurs noms? Se sont-ils interrogés sur comment survivre entassés dans l’obscurité de la cale et pouvoir malgré tout et tant soit peu y faire société ? Quelles sont les options qui s’offraient à eux : reprendre le cours de leur vie en sautant dans les flots ou en se révoltant ? Se demandaient-ils s’ils devaient tuer quelqu’un pour se sauver et sauver tous les autres ?…
Saisir ce qu’était la cale, c’est aussi devoir “se dépatouiller” avec les terribles images que le défaut de mémoire reconnue a constitué en visions horrifiantes et obsédantes : celle d’un cloaque aux odeurs fétides et à la promiscuité extrême où la sous-alimentation était la norme, où les maladies infectieuses pullulaient, où les châtiments corporels pleuvaient et où les morts, aussitôt débités du stock de marchandises vendables transportées, étaient jetés par-dessus bord.
La cale greffée au corps
Fabienne Kanor note que “la symbiose effroyable” entre les esclavisés, biens meubles et la parcelle de la cale à laquelle chacun était cloué s’est bien sûr immiscée en profondeur dans leur corps et leur psyché mais aussi dans celui et celle de leurs descendants. Elle postule donc que c’est dans ce « bas-lieu » que la blessure se fit et que “la blès” (dans la médecine traditionnelle antillaise : grave affection portée par un coup violent) fut attrapée puis ne cessa pas d’être transmise aux générations suivantes, les conduisant “à ne plus s’appartenir, à être habitées par une entité invisible”. Comme l’auteure a entendu son père le répéter “la douleur de la blès, tu la vois pas mais ça fait mal”.
Au démarrage de la fusion orchestrée par les puissances colonisatrices entre les corps des esclavisés et leur portion de cale, se trouve l’injonction brutale à renoncer définitivement aux croyances, aux connaissances, aux organisations sociales et aux structures mentales africaines, Souffrance indissolublement collective et personnelle, “la blès” concentre toutes ces composantes identitaires broyées sans une once de ménagement.
C’est ainsi que pour exprimer les contraintes dans lesquelles l’exiguïté de la cale emprisonne les corps et les têtes, des danseuses afro-descendantes contemporaines chorégraphient leur “blès” en rentrant leurs têtes dans leur cou et en gardant leurs jambes fléchies. De même, alors qu’elle est installée au Libéria depuis 1974 en quête de ses racines africaines, le 3 juillet 1976 sur la scène du festival de jazz de Montreux, Nina Simone a voulu faire savoir au public d’où elle venait, lui dire la cale qui lui a été greffée. Revenant sur scène à la fin de son concert, l’artiste admirée choisit d’interpréter, en en assumant le caractère presque impossible, ce que Fabienne Kanor appelle “la danse de l’éternelle quête et de l’éternelle lacune”. Il faut retenir que pour les danseuses comme pour Nina Simone, “essayer de venir d’Afrique” dans une cale est une démarche ardue et douloureuse, imposant d’accepter que, paradoxalement, les racines n’ont rien de fixé, qu’avec le temps et ses ressorts politiques, sociaux et culturels, elles “se renouvellent sans cesse”.
La cale et la symbolique de la chambre
Depuis les années 1960, des hommes écrivains et cinéastes afro-descendants se sont emparés de la proximité entre la promiscuité de la cale et l’intimité de la chambre. Selon Fabienne Kanor, les chambres à coucher aménagées par ces créateurs sont hantées par les fantômes de la cale et les protagonistes (une femme blanche et un homme noir) qui s’y retrouvent enfermés sont des êtres vulnérables et névrosés. La cale-chambre ou la chambre-cale exprime alors la sédimentation du système esclavagiste en imbriquant les empreintes et phantasmes qu’il a laissé dans les corps et les têtes des descendants des esclavisés et ceux des colonisateurs.
Ici, les romans et les films montrent ce qui se joue entre les deux occupants du huis clos dans lequel la cale et la chambre sont fondues en une même sombre entité : d’un côté, des hommes noirs portant, à la fois, le poids de leur “blès” où suppurent le souffrance et la terreur de leurs ascendantes violentées par les maîtres et leur assignation présente au statut de “super mâle dangereux” ; de l’autre, des femmes blanches sujets de leur présence dans la chambre mais objets du rôle expiateur qui leur y est attribué. Romans et films dessinent les contours de la complexité et des ambiguïtés du processus contemporain de fabrication de l’homme noir en dominé / dominant et de la femme blanche doublement dominée, courant le risque de se perdre dans l’affreux et l’obscène..
On l’aura compris, La poétique de la cale. Variations sur le bateau négrier n’est pas un livre d’histoire structuré autour de l’exposition et l’interprétation de faits précis. Il s’agit d’un essai rendant compte de l’épreuve et du tâtonnement qu’est nécessairement la quête de la cale spectre par les descendants des esclavisés. En effet, comment dire un processus qui, au fil des générations, s’est avéré être “inarrachable des mémoires mais irreprésentable” ?
L’ampleur et la puissance du travail de quête de la cale entrepris par Fabienne Kanor ont imposé à cette chronique des choix qui, je l’espère, permettent cependant d’en saisir la pertinence et les enjeux ; notamment, la transmission, d’une génération à l’autre, d’une profonde blessure indissociablement collective et individuelle qui ne trouve toujours pas pleinement les conditions requises pour s’apaiser.
Chroniqueuse : Éliane le Dantec
NOS PARTENAIRES
Faire un don
Vos dons nous permettent de faire vivre les libraires indépendants ! Tous les livres financés par l’association seront offerts, en retour, à des associations ou aux médiathèques de nos villages. Les sommes récoltées permettent en plus de garantir l’indépendance de nos chroniques et un site sans publicité.