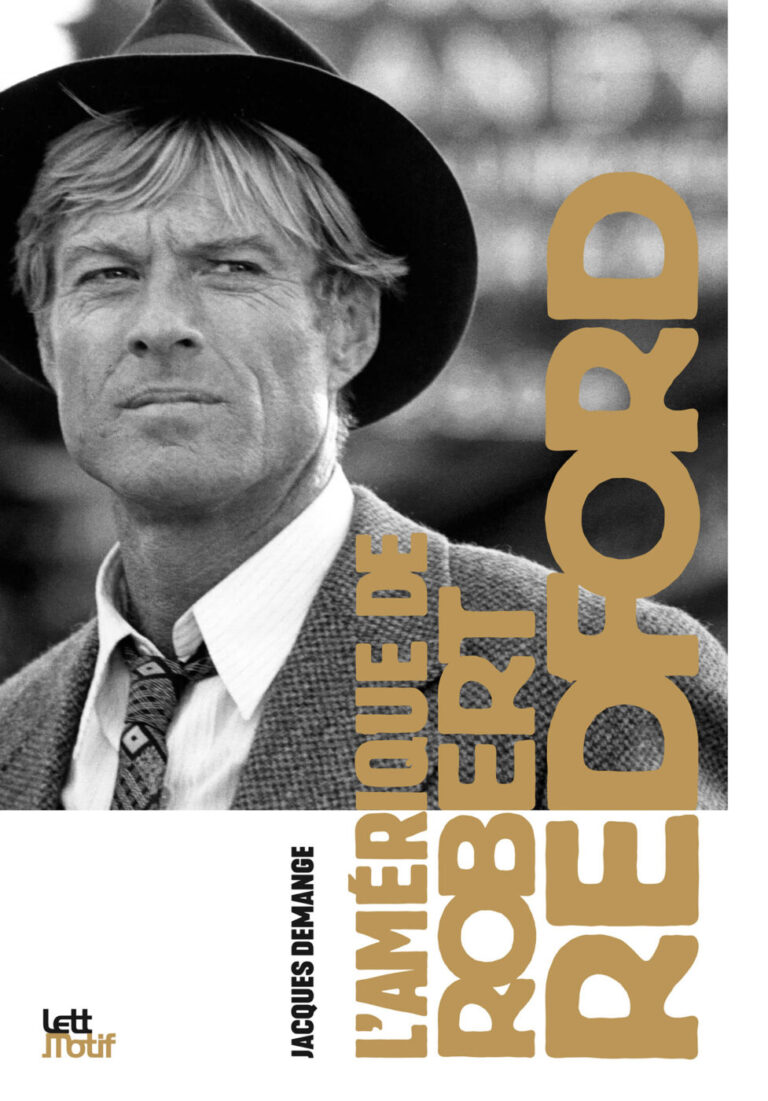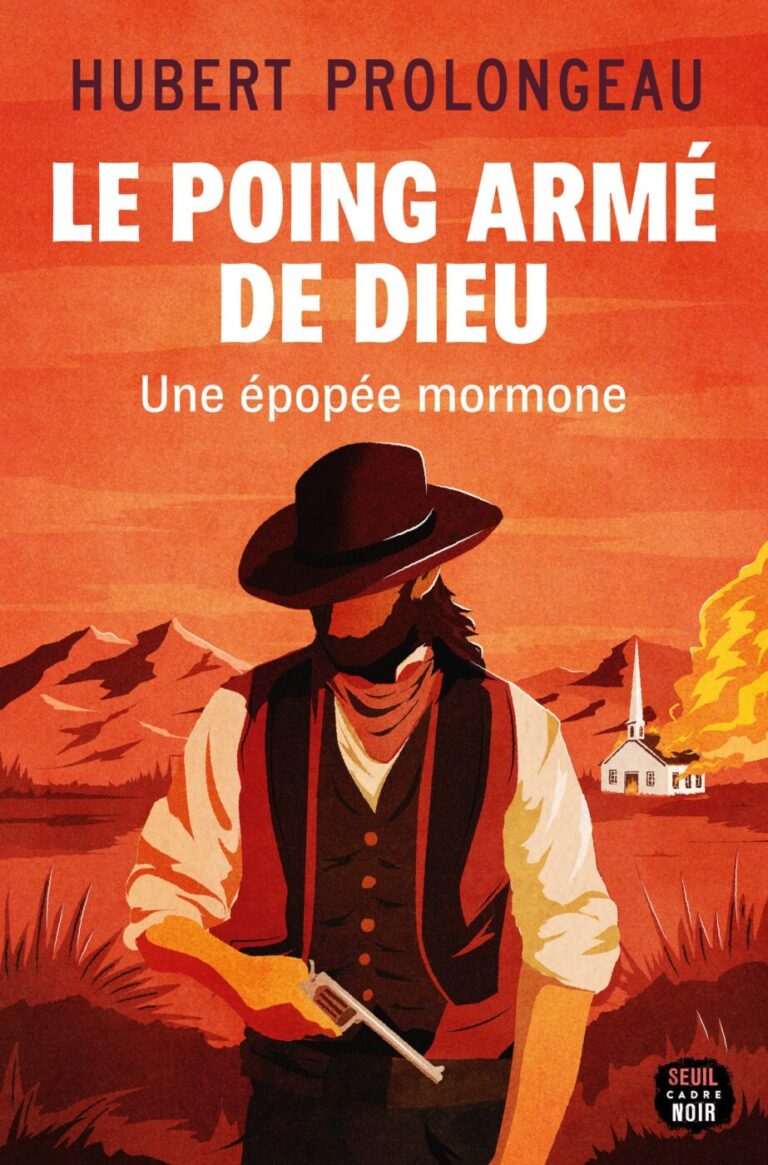Si vous n’avez pas suivi la chronique de l’écrivain Robert McLiam Wilson relatant le procès de l’attentat de Nice dans les colonnes de Charlie Hebdo, le journal satirique a eu l’excellente idée de réunir ses textes dans un ouvrage intitulé La vilaine veuve. Nice, le procès oublié. (Hors-série publié le 30 décembre). Comme il le rappelle en introduction, un mois après l’attentat du 14 juillet 2016, Robert McLiam Wilson écrivait déjà dans Charlie Hebdo sur l’horreur de l’acte :
Il y a un peu plus d’un mois, une ignoble disgrâce d’être humain lançait son 19-tonnes sur une promenade de France, écrasant la chair innocente de ses semblables, faisant 86 morts et [plus de 400] blessés. À la fin d’un feu d’artifice – soit un événement qui garantit la présence d’enfants. Prenons un instant pour bien absorber l’ampleur de la chose. Ça, c’est nouveau : écrabouiller volontairement des enfants. L’homme, cet animal, est une merveille infatigable de folie, d’immoralité, d’insondable haine, mais, en général, il évite d’assassiner les enfants. Les pires y rechignent. Rejet biologique.
Il s’interrogeait déjà sur une question primordiale qui reviendra comme fil conducteur de ses chroniques : l’oubli de l’horreur de l’acte. Car un mois plus tard il n’y a plus rien dans les médias français : “C’est comme ça, c’est la vie. Qui continue. […] Viennent les jours noirs et puis, après un moment, on reprend le fil du quotidien, on pense argent, bouffe, cul. C’est ce que nous sommes. Mais ce ”moment” passe de plus en plus vite”.
Six ans après, le constat est amer avec un oubli rapide de l’événement doublé aujourd’hui d’une indifférence encore plus dégueulasse :
L’attentat de Nice fait tapisserie parmi les attentats terroristes en France des dix dernières années. Oui, c’est vraiment la vilaine veuve […] Ces choses sont littéralement impensables. Alors on essaie de ne pas y penser. Et on est incroyablement bon dans cet exercice, ne pas penser. C’est parmi nos plus grands dons. L’attentat de Nice et tout ce qui le concerne sont peut-être ce à quoi nous avons appliqué ce talent pour ne pas penser avec la plus grande force […] Le procès de Nice s’est ouvert à Paris dans l’indifférence générale, devant un public clairsemé, sous une couverture médiatique largement ignorée.
On ne peut s’empêcher – et Robert McLiam Wilson ne s’en prive pendant les semaines d’audiences – de comparer avec le traitement des procès d’autres attentats comme ceux de Charlie Hebdo justement, ou du 15 novembre 2015.
La hiérarchie dans la souffrance n’a pas beaucoup de sens on le sait, mais force est de constater que les victimes de ces attentats ont eu bien plus d’égards médiatiques que ceux de Nice.
Comment l’expliquer ? Cela ne peut pas être l’absence de l’auteur dans le box des accusés (c’est souvent le cas avec les kamikazes…). Pour Robert McLiam Wilson, le drame de Nice est “arrivé” après Paris et notre quota de compassion pour de tels drames était peut-être dépassé : “On s’en fiche, de l’attentat de Nice. On n’a plus le temps. On a donné toute notre énergie pour ce qui s’était passé avant”.
Avec son regard britannique, il peut se permettre une autre explication qu’on retrouve tout le long de sa couverture du procès : L’attentat de Nice est oublié, sous-médiatisé, également car il y a en France un ethnocentrisme parisien, certainement dû à la concentration des lieux de pouvoirs et de direction dans la capitale. Les décideurs et les journalistes nationaux vivant à Paris, ce qui s’y passe a forcément toujours plus d’importance dans la Presse et la psyché nationale. On peut aussi rajouter au mépris de la province en général, un dédain tout particulier des Niçois : “À Nice, il n’y a que des vieux réacs. Que des riches. Que des ploucs. Que des mafieux”.
Robert McLiam Wilson, s’est déplacé et a rencontré de nombreux proches de victimes. Bien au-delà de la caricature qu’on en fait à Paris, il a trouvé des parties civiles qui osent rire, applaudir, se moquer des accusés. Une ambiance quasi familiale, avec ses clans, ses engueulades, et surtout sa franchise.
Ce procès n’a cependant donc pas trop intéressé à Paris, excepté lors de la venue de celui qu’il appelle “Beyoncé ” l’ancien Président François Hollande, et de la diffusion des images du camion fonçant dans la foule, écrasant une multitude de corps, tuant 86 personnes dont 15 enfants.
Un débat d’ailleurs s’est tenu entre magistrats et avocats pour savoir s’il fallait diffuser ou non cette vidéo. Seul le son – qu’on dit terrible – a été finalement retiré. C’est aussi l’occasion d’une analyse de la justice française, avec les mauvais côtés comme le business de certains avocats cumulant l’aide juridictionnelle des parties civiles, la froideur des psychologues du fonds de garantie : “Vous n’avez perdu que votre fille ?”, ou le combat d’une mère afin de dénoncer les organes prélevés par la médecine légale et pas rendus six ans plus tard… Mais aussi les bons côtés de notre système judiciaire, comme le temps donné et non compté à la parole des familles de victimes, la préservation de leur intimité.
C’est bien entendu surtout l’occasion de relater l’horreur de l’acte afin de ne pas oublier et de révéler des faits infâmes faisant douter de l’humanité au-delà du geste isolé du terroriste : “De plus en plus de victimes parlent des pourritures venues dépouiller les corps des morts, et même des blessés. C’est peut-être la pire des histoires tues autour de l’attentat”.
Fort heureusement, il y a également beaucoup de la solidarité dans le récit, de l’amour aussi, tragique, celui des survivants, de leurs familles, de ceux qui comme Thierry Vimal, écrivain, père d’une enfant de douze ans tuée ce soir-là, sont “figés dans le malheur”, ou celui de Kamel Sahraoui, qui a perdu sa mère, son neveu de huit ans et sa fille de deux ans aux côtés de laquelle il est resté allongé toute la nuit, sur le bitume, pour la veiller.
On comprend que raconter ce procès n’a pas été une sinécure, mais comme le rappelle fort justement Robert McLiam Wilson au milieu de son compte rendu :
J’ai remarqué un truc qui m’avait échappé jusqu’ici. Quand on est un peu malade (nous, les hommes, en tout cas), notre parole est hyperbolée, elle s’envole en analogies grandioses. ”Je suis malade comme un chien, je suis mort.”. Plus possible. Après ce que j’ai entendu pendant cinq semaines, je ne peux plus décrire une situation banale comme ”terrible” ou ”atroce”. Ce procès a rétréci mon vocabulaire. Il m’a volé mes métaphores.