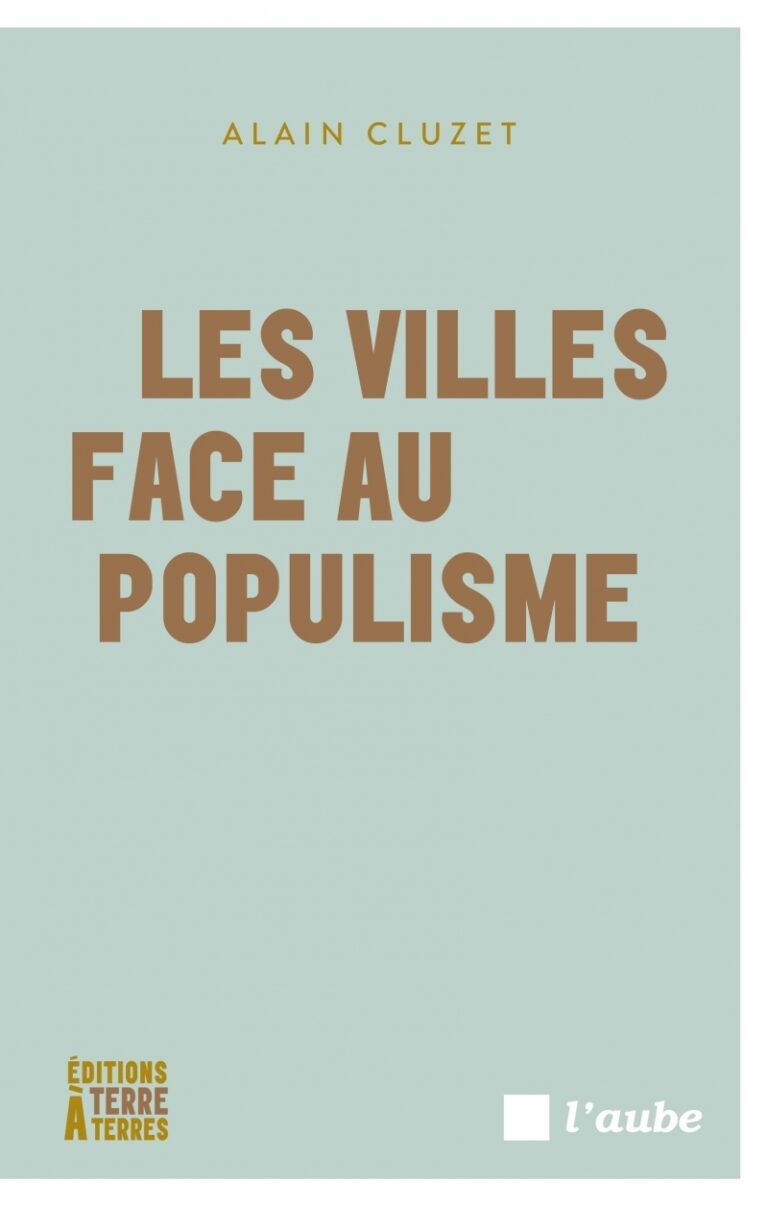Usama Al Shahmani, Les arbres ici parlent aussi l’arabe, traduit par Lionel Felchlin, Éditions La Veilleuse, 23/09/2025, 224 pages, 18€
Quand un Irakien se met à parler aux arbres suisses dans sa langue maternelle, quelque chose se déplace dans l’ordre du monde. Les arbres ici parlent aussi l’arabe, d’Usama Al Shahmani, traduit de l’allemand par Lionel Felchlin, déploie une cartographie intime de l’exil où chaque essence végétale devient miroir, interlocuteur, archiviste. Le narrateur, requérant d’asile arrivé en Suisse en 2002, découvre qu’on peut transplanter une âme à condition de lui parler, et que les forêts thurgoviennes accueillent aussi bien le dialecte du sud de l’Irak que le silence des disparus.
Le roman s’ouvre sur une scène fondatrice : la rencontre avec le mot “randonner”, concept absent du lexique arabe, pratique incompréhensible pour qui vient d’un pays où la forêt incarne le chaos et la menace. Pourtant, le narrateur pénètre dans ce qui deviendra son territoire de survie psychique. Dès cette première marche, un tilleul lui renvoie l’écho de ses mots arabes : hub, sama, shagar : amour, ciel, arbres. Ce prodige acoustique et symbolique inaugure une relation thérapeutique entre l’homme déraciné et les êtres verticaux qui structurent le paysage helvétique.
Sept arbres, sept chapitres : une architecture organique
Usama Al Shahmani construit son récit sur une structure végétale : l’arbre de l’amour (le grenadier), de l’espoir (l’épicéa), de l’incertitude, de la mort (l’eucalyptus bagdadi devenu gibet), de la patrie (le dattier), du rêve, de la patience (le doum du désert). Cette nomenclature tisse une généalogie affective où se superposent géographies irakienne et suisse, mémoires familiale et collective, temps de la dictature et temps de l’attente administrative. L’auteur procède par strates, retours, échos, comme si la mémoire elle-même avait adopté la structure rhizomique des racines.
Le frère disparu, ou le trou noir gravitationnel du récit
Au cœur du roman plane l’ombre d’Ali, le frère cadet disparu à Bagdad en avril 2006, avalé par les milices de la guerre civile irakienne. Usama Al Shahmani tresse chronologie intime et grande Histoire : l’embargo des années 1990, les bombardements de 1991 (« la pluie noire » de pétrole brûlé), la chute de Saddam en 2003, puis l’explosion confessionnelle qui transforme la capitale en cimetière à ciel ouvert. Le narrateur apprend la disparition d’Ali dans une forêt argovienne, téléphone en main, flyers publicitaires éparpillés par le vent. Cette collision entre quotidien suisse et tragédie bagdadie crée une faille temporelle que l’écriture tente de suturer.
La recherche d’Ali structure la narration comme une quête impossible : appels vers l’Irak, mails du frère Naser décrivant les morgues, les photos de cadavres torturés, les chantages de soi-disant intermédiaires. Le romancier décrit le commerce de la mort avec une sobriété glaçante : « Même dans la mort, il n’y avait pas de justice. » Face à l’absence de corps, de tombe, de certitude, le narrateur invente une liturgie personnelle : parler aux arbres, leur confier l’absent, transformer le paysage suisse en mausolée vivant.
Une langue triple, une syntaxe de l’entre-deux
La langue du roman porte les stigmates de son triple passage : arabe d’origine, allemand d’adoption, français de traduction. Cette polyphonie transparaît dans la syntaxe, parfois légèrement décalée, qui restitue l’effort d’habiter une langue seconde. Le narrateur note qu’écrire en allemand lui donne faim ; détail trivial devenu métaphore d’un corps qui digère lentement la grammaire de l’Autre. Certaines pages résonnent comme des exercices de prononciation : « Hub, sama, shagar » devient litanie, mantra contre l’oubli, vaccination linguistique contre l’effacement.
Animisme syncrétique et sacralisation de la forêt
La dimension spirituelle du texte échappe aux catégories religieuses classiques. Le narrateur, formé par une grand-mère qui plantait des jujubiers contre le malheur, élabore un animisme syncrétique où cohabitent sourates coraniques et souvenirs de Dante, prières chiites et culte des essences locales. Le chêne rencontré sur un sentier thurgovien devient confident, le dattier planté sur le balcon frauenfeldois remplace l’autel. Cette sacralisation de la nature compense l’effondrement des cadres : disparition du frère, perte de la patrie, délitement familial.
L’écriture d’Al Shahmani charrie aussi l’humour noir des survivants. Le narrateur ironise sur les flyers qu’il distribue pour un pizzaiolo peu scrupuleux, note que les retraités irakiens n’ont d’autre passe-temps que d’éteindre les lumières. Ces touches légères aèrent un récit qui refuse le misérabilisme.
Aimer deux patries incompatibles
Le roman pose une question rarement formulée : que signifie aimer deux patries incompatibles ? Le narrateur ne choisit pas. Il construit une existence bipolaire, alternant séjours en Suisse et retours périlleux en Irak. Cette oscillation génère une mélancolie particulière, celle de l’entre-deux permanent, du double deuil : pleurer l’Irak en Suisse, pleurer la Suisse en Irak.
La conclusion ouvre sur une renaissance symbolique : Luma, la sœur, accouche d’un fils qu’elle prénomme Ali. Un nouveau dattier pousse dans un jardin de Nasiriya. Ce dédoublement temporel refuse la clôture narrative. Usama Al Shahmani suggère que la mémoire persiste par réincarnations successives, que les morts continuent de croître dans les vivants comme les arbres prolongent leurs racines sous la terre.
Les arbres ici parlent aussi l’arabe invente une géographie de l’exil où les frontières deviennent poreuses grâce au langage végétal. Usama Al Shahmani prouve qu’on peut habiter simultanément plusieurs lieux, plusieurs langues, plusieurs temporalités — à condition d’accepter que l’identité pousse désormais comme un arbre en terre étrangère : lentement, patiemment, sans jamais cesser de parler à voix basse aux racines enfouies.