Philippe Collin, Les Résistantes. Le rôle crucial des femmes face aux nazisme, Albin-Michel, 02/04/2025, 448 pages, 25,90 €
Écoutez notre Podcast
Et si l’histoire de la Résistance française ne se racontait pas uniquement au masculin ? Philippe Collin et son équipe de chercheurs redonnent voix et chair à cinq femmes aux parcours hétérogènes mais unies par le refus de l’oppression. D’un récit choral immersif, nourri d’archives et d’entretiens, émerge une vérité essentielle : la Résistance fut aussi, et souvent d’abord, une affaire de femmes. Une plongée intime et politique dans l’ombre de l’Histoire.
Les veilleuses de l’Histoire
Pénétrer dans l’ouvrage Les Résistantes orchestré par Philippe Collin revient à accepter un décentrement du regard, une subversion salutaire des grands récits nationaux. Plutôt qu’une monographie classique ou un essai surplombant, le livre déploie une fresque documentaire incarnée, une histoire polyphonique où les archives, les témoignages et les analyses d’experts s’entrelacent pour tisser une vérité à hauteur de femme. Loin des « clichés romantiques » d’agentes de liaison à bicyclette, que l’introduction dénonce avec justesse, le projet met en lumière l’injustice mémorielle qui a longtemps frappé les actrices de la lutte clandestine. L’intention de Philippe Collin et de ses collaborateurs – historiens chevronnés tels que Laurent Douzou, Catherine Lacour-Astol, Claire Andrieu ou Frédérique Neau-Dufour – est claire : restituer non seulement des faits, mais une ontologie de l’engagement féminin. Il s’agit de comprendre la « double transgression » de ces femmes qui, en défiant l’occupant nazi et le régime de Vichy, remettaient simultanément en cause « sa propre fonction dans une société française éminemment rigide et inégale ». Elles défendaient une nation où elles n’avaient, pour la plupart, pas même le droit de vote, invisibles civiques devenues piliers d’une guerre souterraine. L’ouvrage navigue avec une remarquable fluidité entre la rigueur pédagogique de l’enquête historique et la puissance émotionnelle du témoignage. Il interroge la genèse de la conscience politique, la nature du courage, les ressorts psychologiques de la désobéissance et, enfin, les mécanismes de la reconnaissance – ou de son absence. Les grandes questions de la visibilité, du genre et de la transmission irriguent chaque page, conférant au projet sa densité et son urgence contemporaine.
La Résistance en cinq portraits
La force de l’ouvrage réside dans sa structure narrative, véritable mécanique de précision qui fait des destins croisés un puissant moteur de sens. Organisé en dix chapitres chronologiques, de « 1923, le Putsch de la Brasserie » à « Le Courage en héritage », le récit avance comme une tragédie en plusieurs actes, où les trajectoires individuelles s’inscrivent dans la marche funeste de l’Histoire. C’est dans cette construction que l’alchimie opère, transformant cinq biographies en une épopée collective. Les figures sont choisies pour leur complémentarité, voire leur opposition sociologique : l’aristocrate catholique et nièce du général, Geneviève de Gaulle ; la jeune immigrée juive et sioniste, Mila Racine ; l’intellectuelle d’origine populaire devenue icône, Lucie Aubrac ; la championne de tennis issue de la haute bourgeoisie, Simonne Mathieu ; et la chanteuse indépendante et libre, Renée Davelly. Chacune incarne une facette singulière du refus.
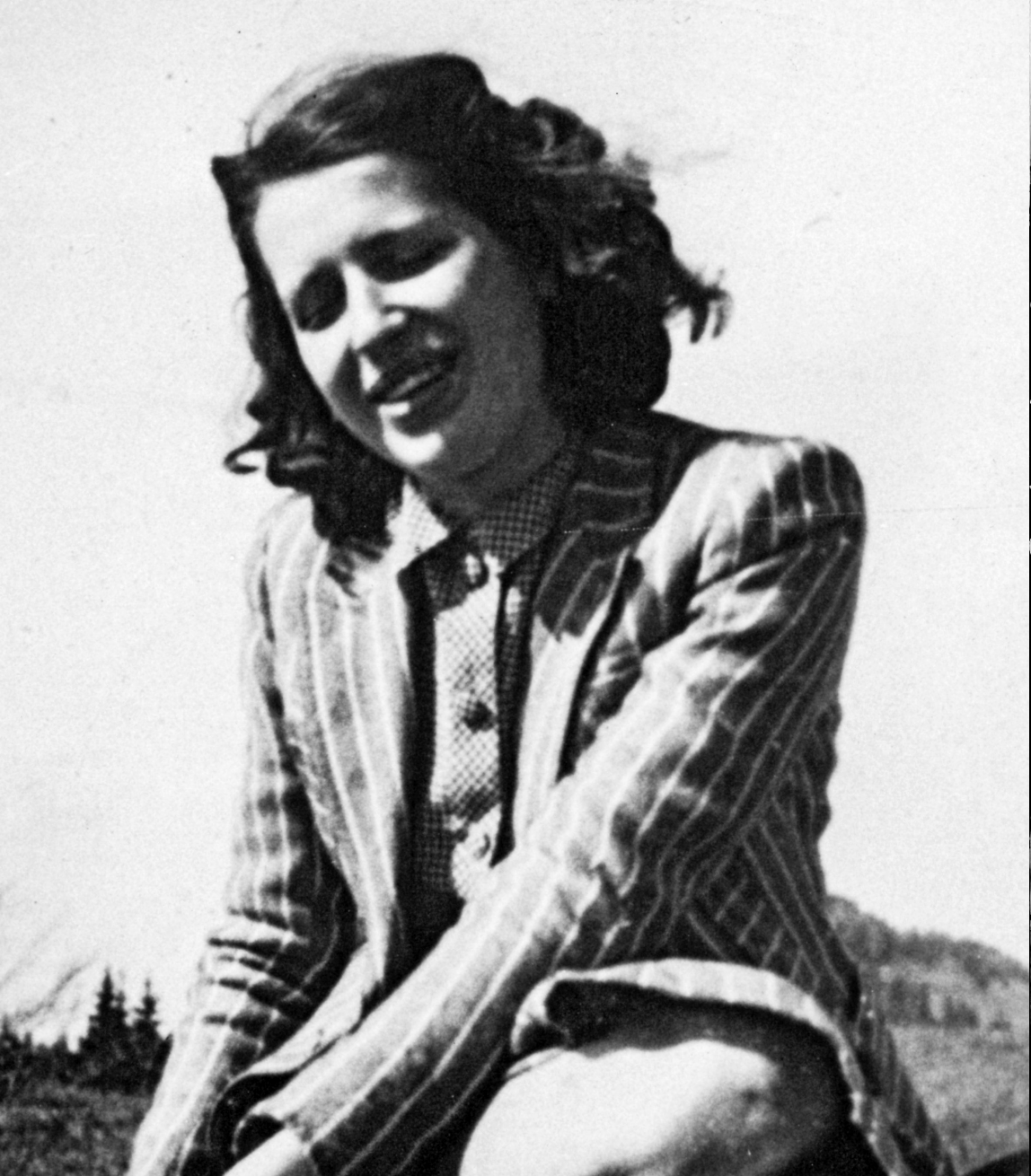
Pour Geneviève de Gaulle, le destin est d’abord une affaire de nom. Un nom qui, dès l’enfance en Sarre occupée, la place du côté de la France, de cette identité nationale blessée mais fière. Son parcours est celui d’une conscience politique et morale aiguisée très tôt par une éducation qui valorise la dignité humaine, un catholicisme social qui contrevient au paganisme hitlérien qu’elle voit monter sous ses yeux. Son premier acte de résistance, arracher un fanion nazi à Rennes, n’est pas un geste calculé, mais le sursaut instinctif d’une âme qui ne supporte pas l’humiliation. Son nom devient étendard et cible, un héritage qui l’expose autant qu’il la définit. Arrêtée, elle apprend la solidarité des murs, communiquant par les tuyaux de la prison de Fresnes avec d’autres femmes dont Germaine Tillion, autre conscience de son temps. Dans le convoi pour Ravensbrück, elle est acclamée, sorte de « de Gaulle en miniature » offrant à ses compagnes un symbole d’espoir tangible. Et c’est paradoxalement ce même nom qui la sauve, quand Himmler, sentant le vent tourner, la met au secret dans le bunker du camp, espérant l’utiliser comme monnaie d’échange. Sa traversée de la nuit, narrée dans ses propres écrits avec une pudeur poignante, la confrontera à l’abjection absolue, mais aussi à l’extraordinaire capacité humaine à la fraternité. Son histoire ne s’arrête pas avec la Libération, elle mute : l’expérience de la déshumanisation des camps nourrit son engagement contre la misère, faisant d’elle le puissant trait d’union entre la mémoire de la Résistance et la lutte contemporaine pour la dignité des plus pauvres.

Le destin de Mila Racine est diamétralement opposé. Elle est l’étrangère, l’émigrée juive russe dont la famille a fui Moscou pour Paris. Sa résistance n’est pas motivée par une longue tradition nationale, mais par la convergence d’une conscience aiguë du danger antisémite et d’un engagement précoce dans les mouvements de jeunesse sionistes comme la WIZO. Son histoire est celle de l’organisation de l’aide et du soutien, où l’action humanitaire est érigée en acte de résistance politique. Avant les réseaux armés, il y a la nécessité de la survie. Mila Racine organise, depuis Luchon, puis la zone d’occupation italienne à Nice, des réseaux de secours pour les camps d’internement. Elle devient une passeuse, une organisatrice de filières d’évasion pour des dizaines d’enfants juifs qu’elle convoie vers la Suisse. Le récit de ces passages, mélange de préparation méticuleuse et d’improvisation face à l’imprévu, la montre comme une figure de courage tranquille, alliant sang-froid et une tendresse infinie pour les enfants dont elle a la charge. Son arrestation, à quelques mètres de la frontière suisse, est une tragédie de l’inachevé. Dans les lettres codées qu’elle envoie de prison, elle maintient la fiction d’une Française non juive partant travailler en Allemagne pour protéger sa famille, preuve d’une abnégation ultime. Sa mort est d’une ironie macabre : survivante de la Gestapo, de Fresnes et de Ravensbrück, elle périt à Mauthausen sous les bombes des Alliés venus la libérer. Son destin symbolise la double peine des Juifs dans cette guerre et la dimension profondément européenne, voire universelle, de la Résistance. Elle est la mémoire d’une lutte où sauver une vie était, en soi, une victoire contre le néant.

Lucie Aubrac, quant à elle, incarne la puissance de l’action, l’énergie plébéienne et intellectuelle qui refuse la fatalité. Son parcours, depuis une enfance modeste jusqu’à l’agrégation d’histoire conquise en candidate libre, est une première résistance contre le déterminisme social. Communiste dans sa jeunesse, elle en garde le sens de l’organisation et une lecture politique des événements. Sa rencontre avec Raymond Samuel n’est pas seulement une histoire d’amour, c’est la naissance d’un couple politique, un binôme dont la complémentarité deviendra une force redoutable. Ensemble, ils fondent le mouvement Libération-Sud. Le récit de Philippe Collin ne cherche pas à démystifier la légende Aubrac, mais à en montrer les ressorts humains et stratégiques. Lucie n’est pas que la femme qui organise la spectaculaire évasion de son mari des griffes de la Gestapo, une mitraillette sur les genoux, enceinte de six mois. Elle est la théoricienne de l’action, celle qui, dans une archive de mai 1993, résume sa philosophie avec une simplicité désarmante : « Moi, je n’aime pas les cambrioleurs et les pillards. Et il y avait dans mon pays une bande de cambrioleurs et de pillards, c’était l’armée nazie. Et puis j’aime encore moins les gens qui aident les cambrioleurs et les pillards et c’était le gouvernement de Vichy. » Sa vie post-Libération témoigne de la persistance de cet engagement : militante anticolonialiste, elle devient une passeuse de mémoire infatigable, allant à la rencontre de la jeunesse pour que la flamme ne s’éteigne pas. Son destin est celui d’une icône qui a su maîtriser sa propre narration, faisant de sa vie un exemple de ce que peut la volonté contre l’Histoire.

Avec Simonne Mathieu, on aborde la résistance de l’indocilité. Grande championne de tennis, star de Roland-Garros, mariée et mère, elle détonne dans le paysage policé du sport d’avant-guerre. Son « mauvais caractère », sa détermination, sa germanophobie affirmée sont le terreau de son engagement. Coincée à Londres en 1940, elle est l’une des toutes premières à rejoindre de Gaulle. Elle ne vient pas pour faire de la figuration : elle obtient du Général, non sans mal, la création du Corps des Volontaires françaises, première unité militaire féminine de l’histoire de France. Elle en devient la capitaine, la dirigeant d’une main de fer, protégeant “ses” filles de la convoitise d’officiers trop entreprenants. Mais cette femme à poigne, peu diplomate, finit par déranger la hiérarchie militaire masculine. Évincée, elle est mise sur la touche, puis intégrée aux services secrets à Alger. Son retour dans le Paris libéré est doux-amer : elle est là, en uniforme de capitaine, figure d’une victoire à laquelle elle a ardemment contribué, mais déjà, elle glisse vers la marge. La France gaulliste aura d’autres icônes. Sa postérité, elle la devra paradoxalement au monde du tennis qui, tardivement, nommera un court et un trophée en son honneur, réparant une injustice mémorielle criante. Son parcours illustre la difficulté pour les personnalités hors normes, surtout si elles sont des femmes, à trouver leur juste place dans le grand récit des héros.

Enfin, le destin de Renée Davelly est celui de la résistance par la présence et le chant. Artiste en devenir, femme libre ayant osé le divorce, elle se trouve en Égypte quand la guerre éclate. Loin de la clandestinité métropolitaine, sa résistance est celle de l’allégeance. Elle choisit le camp de la France Libre et devient l’égérie, la “Madelon” des soldats français du Levant. Elle est ce que le livre nomme un “réarmement affectif” : avec son accordéon, elle fait la tournée des hôpitaux, distribue des croix de Lorraine, chante pour les blessés et devient la marraine de milliers de “gars”. Son engagement est culturel, patriotique, essentiel pour le moral des troupes. Elle est une parcelle de France pour ces hommes exilés. La Libération signe pour elle la fin d’une parenthèse enchantée. De retour en France, elle n’est plus la vedette des armées, mais une artiste parmi d’autres. L’histoire l’oublie, elle doit se réinventer. Sa trajectoire poignante, qui la voit finir sa vie en magnétiseuse à Mantes-la-Jolie, est peut-être la plus mélancolique : elle montre comment l’héroïsme peut être circonstanciel et comment la paix peut être, pour certains, plus cruelle que la guerre, les condamnant au silence et à l’anonymat.
Ces cinq parcours, savamment orchestrés, dessinent une géographie complexe et mouvante de l’engagement. Le dispositif éditorial, en mêlant récits, citations d’historiens et archives sonores, immerge le lecteur dans une expérience quasi sensorielle de la période, où le mot imprimé semble vibrer des voix du passé.
Ces femmes qui nous regardent encore
En documentant la précocité et la spontanéité de l’engagement féminin, Les Résistantes offre une contribution fondamentale au féminisme mémoriel. Il dialogue implicitement avec les travaux fondateurs de Catherine Lacour-Astol sur la répression des femmes ou de Claire Andrieu, qui ont, depuis des décennies, labouré ce champ de l’invisibilité. L’ouvrage de Philippe Collin prolonge et popularise leurs recherches, les rendant accessibles sans jamais les simplifier. Il démontre que la résistance des femmes, loin de se limiter à un rôle ancillaire, fut souvent initiatrice, nourrie par une perception immédiate de l’injustice, une morale du quotidien qui précède l’idéologie. C’est la mère de famille qui voit les étals vides, la voisine qui ouvre sa porte à un soldat en fuite, la citoyenne privée de ses droits qui perçoit l’humiliation fondamentale. Ce récit modifie durablement la grammaire de notre perception du courage. Le courage, nous dit ce livre, n’est pas qu’une affaire d’armes et de grands coups d’éclat, mais une somme de refus silencieux, une fidélité obstinée à soi-même et aux autres. Il réside dans la confection d’une layette avec des chemises d’hommes, dans l’organisation d’un Noël clandestin au cœur du bunker, dans la parole de Geneviève de Gaulle qui, après des mois de silence, ne peut écrire à son geôlier que les paroles d’une chanson d’amour : « Parlez-moi d’amour, dites-moi des choses tendres. »
Ces portraits invitent à une forme d’introspection. Comment ne pas voir dans l’engagement de Geneviève de Gaulle auprès des plus pauvres après la guerre le prolongement direct de l’expérience concentrationnaire ? L’indignité de la misère à Noisy-le-Grand résonne en elle de l’écho de Ravensbrück, et cette continuité de la lutte donne à sa vie une cohérence et une noblesse saisissantes. L’ouvrage, par sa structure chorale, invite à « panthéoniser » autrement. La reconnaissance institutionnelle, qu’il s’agisse de la croix de la Libération (attribuée à seulement six femmes) ou de l’entrée au Panthéon de Germaine Tillion et de Geneviève de Gaulle Anthonioz en 2015, n’est que la pointe émergée d’un iceberg de bravoure. En donnant corps à ces cinq femmes, le livre ne demande pas seulement de réparer une injustice ; il nous incite à repenser ce qui fonde la dignité d’un héros. L’héroïsme, ici, est une constellation, un réseau de solidarités. Et cet héritage, ce « courage en héritage », pour reprendre le titre du dernier chapitre, nous est directement transmis, à travers les voix finales de ces femmes devenues des « veilleurs dans la nuit », nous avertissant, comme le dit Geneviève de Gaulle, des commencements, de cette funeste idéologie qui consiste à dire « que l’autre n’a pas les mêmes droits ». Écouter ces voix, c’est donc aussi prendre notre part de la veille.
















