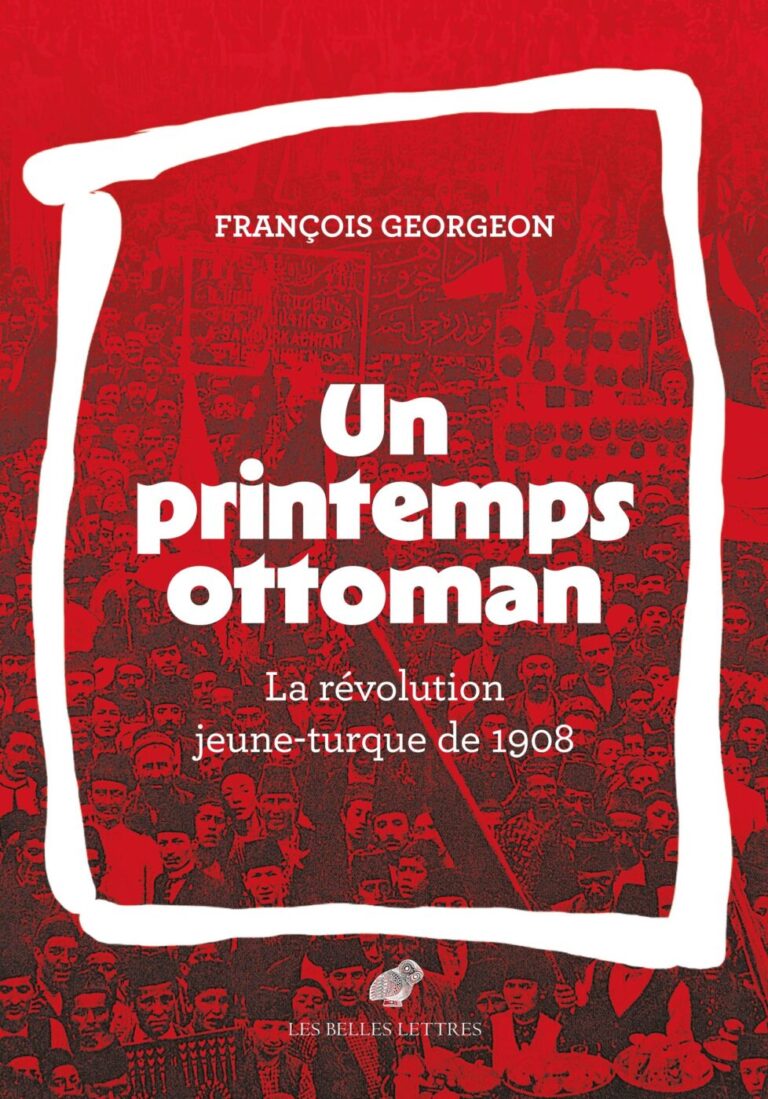Marie Charrel, Les mangeurs de nuit, Éditions de l’Observatoire, 04/01/2023, 21€.
Le roman de Marie Charrel est un hymne magistralement composé au langage et à son pouvoir d’imagination et d’intelligence. Dans Les Mangeurs de nuit, les histoires racontées d’une génération à l’autre sont le ressort de l’esprit de résistance qui anime des personnages que le mouvement de l’histoire des sociétés s’est employé à broyer ou à rendre invisibles.
Hannah – la Nisei (2e génération de migrants japonais au Canada) – et Jack – le creekwalker (le compteur de saumons) – s’avèrent être deux résistants magnifiques. Confrontée à la montée en puissance du racisme antijaponais qui, des années 1920 aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, sévit en Colombie britannique mais forte des histoires de Kuma (son père) qui sont entrées en elle « comme un médicament », Hannah se revendique canadienne ; elle aspire à vivre sa vie avec ce qui lui a été transmis de là-bas et ce qu’elle s’approprie ici. Formé “à écouter la nature” par Ellen, sa belle-mère amérindienne, Jack, que d’aucuns nomment “l’Indien blanc”, consacre sa vie à sillonner “la forêt et ses mondes qui l’emplissent de leur présence”.
Hannah est animée par la volonté d’exister pleinement là où elle se trouve tandis que Jack par celle de protéger la nature. En se rencontrant et se comprenant, tous deux symbolisent les défis contemporains majeurs que sont les devenirs des populations migrantes et de la biodiversité.
Hannah la Nisei éprise de liberté confrontée au racisme antijaponais
Même si Kuma n’est pas le mari séduisant qu’Aika (la mère d’Hannah) a espéré en arrivant au Canada en 1926, elle veut croire aux belles choses que “l’Amérique des possibles” ne manquera pas de lui apporter. D’ailleurs, Kiyoko, l’amie énergique qu’elle s’est faite sur le bateau ne lui a-t-elle pas laissé entendre que la détermination sans faille l’ouvrira à ces possibles ? Et, puisqu’à l’arrivée dans le port de Vancouver, Kiyoko n’est rapidement plus à ses côtés, Aika ne pouvant mettre à l’œuvre “le courage des suiveuses” qu’elle sait pouvoir avoir, n’a d’autre choix que de s’en remettre à elle-même entre renoncements douloureux et espoirs fragiles.
Alors que les Japonais sont encore tolérés à condition de travailler comme des brutes, c’est dans un camp de bûcherons dépourvu de tout confort qu’Aika – seule femme présente – met au monde sa fille Hannah qu’elle ne parvient pas à aimer, laissant Kuma le faire tout en regrettant que celui-ci, insuffisamment réaliste et entrepreneur à ses yeux, abreuve la petite fille d’histoires qu’elle juge inopérantes pour s’en sortir dans une vie de mise au ban. Aika survit en aimant secrètement Hediki, l’ami de Kuma qui lui enseigne l’anglais ainsi qu’à Hannah. Pour soigner en vain la tuberculose dont souffre Kuma, Aika et sa fille s’installent à Vancouver (1936). Avec l’aide de Kiyoko, l’amie retrouvée qui dirige « une maison de filles » très fréquentée, notamment par des notables canadiens, Aika trouve à se loger et à travailler sans difficultés.
Si, perdus dans les contrées de bûcheronnage, Kuma et Hediki ont pu cacher à Aika et Hannah “l’intolérance qui montait à l’égard, des Asiatiques et des Japonais en particulier”, à Vancouver toutes deux y sont confrontées de plein fouet. Hannah et les trois garçons japonais de son école subissent impuissants chaque jour les vexations et humiliations diverses que leur infligent les autres élèves : leurs enseignants, ne les en protégeant pas, seul le concierge de l’école, d’origine italienne et solidaire de ceux qui connaissent l’ostracisme dont tous les migrants du monde sont généralement victimes, leur ouvre sa porte à l’heure du déjeuner.
Devenue adolescente, Hannah ne comprend pas la docilité des adultes japonais face au sort injuste et indigne qui leur est réservé ; notamment, elle s’étonne de les voir suivre sans se rebeller les consignes d’évacuation de leurs terres et biens (en 1940, suite à l’alliance du Japon avec l’Allemagne nazie) et surtout l’ordre de séparer les familles en envoyant les hommes dans des camps de travail et en plaçant femmes et enfants dans des camps de rétention (en 1941, après l’attaque japonaise sur Pearl Harbor aux États-Unis, tous les Japonais vivant en Colombie britannique sont considérés comme des ennemis). Sensible au point de vue des jeunes Japonais diplômés de l’enseignement supérieur à la fin des années 1930, Hannah veut croire à l’intégration des Nisei “dans une société canadienne tolérante et multiculturelle”. Mais, la violence des attaques racistes directes ou indirectes (la mort de son petit frère pour défaut de soins appropriés suivie du suicide d’Aika) ne lui laisse que l’option de la fuite hors du camp de rétention et le recours au vol de survie qui va en découler.
Si le parcours d’Hannah témoigne des conditions d’existence particulièrement difficiles qui, d’une manière générale, sont celles des populations migrantes un peu partout dans le monde, la puissance romanesque avec laquelle il nous est conté lui insuffle une vérité sublimée par la magie sylvestre qui, à la fois, va la blesser et lui laisser espérer un possible apaisement.
Jack le creekwalker solitaire, chantre d’une ode à la nature
Pour Jack, compter les saumons des ruisseaux n’est pas qu’un métier, il s’agit d’une activité essentielle pour la protection de la biodiversité. Ellen, membre de l’une de nations autochtones tsimshian, lui a enseigné que “chaque créature végétale comme animale de la forêt pluviale du Grand Ours dépend de ces poissons d’une façon ou d’une autre”. En écoutant la forêt qu’il sillonne régulièrement sur des kilomètres, Jack a appris à entendre tous les messages de sa “délicate symphonie” de même que “l’intensité et la profondeur des liens” du vivant auxquels elle le fait accéder en devenant souvent “le grand orchestre de l’averse”.
Sachant être en parfaite symbiose avec les rythmes et les sons de la forêt, Jack ne se sent jamais seul ; il revendique cette solitude gorgée des émotions que lui insuffle la nature et qui le rend capable de vivre intensément l’instant. Perçu comme taiseux par ceux qu’il rencontre en ville quand il doit s’y rendre, Jack est convaincu que si, en général, le langage ne parvient pas aisément à dire la force et la complexité de la forêt, celui de la ville lui est fréquemment hostile et méprisant. Son accès à cette force et cette complexité a développé en son for intérieur une posture responsable et morale qui implique de “ne prendre dans la nature uniquement [que] ce dont on a besoin, de ne rien jeter”. Jack a fait sienne la règle de vie transmise par Ellen : “ne tue jamais sans raison. Honore chaque vie prise” à la nature.
Quand Jack trouve le corps d’Hannah attaqué par l’Ours blanc et que le médecin lui demande d’en prendre soin jusqu’à ce qu’elle se rétablisse, il craint de ne pas savoir comment s’y prendre n’ayant partagé la maison des Hautes terres qu’avec Ellen et Mark, son demi-frère (en tant que métisse, Mark adolescent a été enlevé pour être placé dans un centre de rééducation ; il s’est ensuite engagé dans l’armée où il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale). Tant qu’Hannah demeure inconsciente, Jack est préoccupé et embarrassé par le pouvoir que, de fait, il a sur elle. Quand elle retrouve la parole, tous deux savent intuitivement que les confidences ne se réclament pas, elles se méritent. Finalement, c’est le retour d’Hannah à la marche qui va la relier étroitement à Jack qui, dès lors, s’assigne un but unique : enseigner la forêt et son écoute à celle qui a survécu aux griffes de l’Ours blanc. Se sentant désormais en sécurité, Hannah sait qu’elle “doit écrire l’histoire d’Aika et des autres femmes” japonaises qui ont été “taillées pour la survie”.
En mettant en résonance les lois de la nature et les soubresauts de l’Histoire, Marie Charrel nous offre une fresque, tout à la fois sublimement magique et terriblement réaliste, dont le propos nous emporte et nous interpelle. Les mangeurs de nuit nous rappelle en effet que ne nous sommes qu’un maillon minuscule de la chaîne du vivant et qu’il serait donc opportun pour nous – les humains – d’avoir “le désir de ne pas peser, de faire corps avec l’autour”. Le livre suggère aussi qu’éprouver le sentiment d’appartenance à la nature ne peut qu’être bénéfique à la culture et au respect de l’autre dans ses différences.