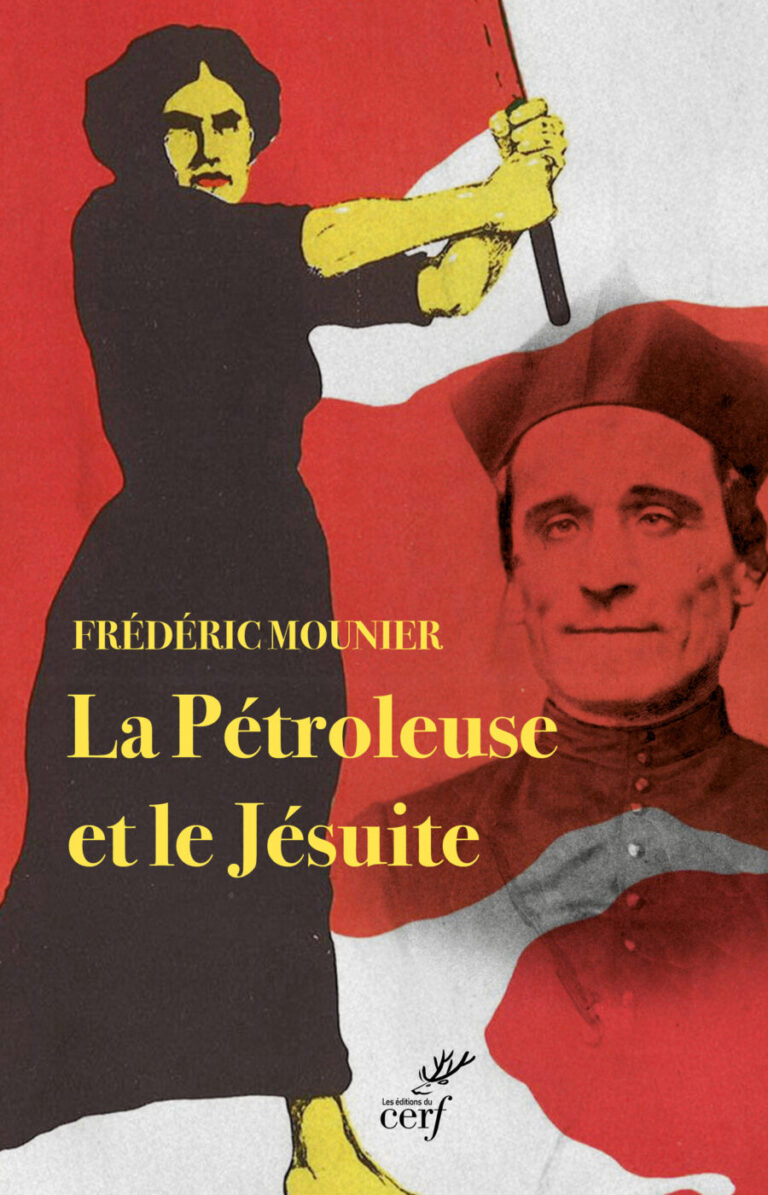Marina Seretti, Un atelier à soi selon Cezanne, Ateliers Henry Dougier, 28/08/2025, 138 pages, 14,90€
Dans les carrières de Bibémus, la pierre ocre garde la mémoire des océans disparus ; sur les pentes du Tholonet, Château Noir dresse ses arches gothiques comme une énigme dorée dans la verdure des pins. Entre ces deux pôles magnétiques du paysage aixois, Paul Cézanne cherchait obstinément ce qu’il nommait sa “petite sensation” – cette vérité colorée où la montagne Sainte-Victoire deviendrait enfin, sur la toile, ce qu’elle avait toujours été : un événement géologique autant qu’une épiphanie visuelle. Marina Seretti, dans Un atelier à soi selon Cézanne, entreprend de raconter cette quête en orchestrant les voix de ceux qui ont approché le maître provençal, tissant un récit où la peinture devient le miroir mouvant du temps lui-même.
Le livre s’ouvre sur une scène dominicale de novembre 1900, alors que Cézanne guide ses compagnons – le poète Joachim Gasquet, le jeune Léo Larguier, les peintres Louise Germain et Joseph Ravaisou – vers Château Noir. “Le château n’est pas à vendre !” martèle le peintre, transformant ce refus du propriétaire en refrain obsédant, presque joyeux. Marina Seretti capte d’emblée l’ambivalence cézannienne : cette manière qu’avait le peintre de transformer ses déceptions en énergies créatrices, ses échecs apparents en victoires secrètes. Car si le château demeure inaccessible comme atelier rêvé, il devient, sous le pinceau de l’artiste et la plume de l’auteure, le foyer incandescent d’une vision où “la pierre chaude comme de la chair” irradie à travers les frondaisons.
L’architecture narrative du roman déploie une polyphonie subtile : après la voix lyrique et emphatique de Gasquet, qui projette sur Cézanne ses propres fantasmes félibréens, vient celle, plus âpre et contradictoire, d’Émile Bernard en 1904, déchiré entre admiration et ressentiment face au “primitif de [sa] propre voie”. Puis surgit, depuis un sanatorium de Merano en 1920, le témoignage crépusculaire de Karl Ernst Osthaus, collectionneur allemand qui se souvient d’une visite printanière de 1906, quelques mois avant la mort du peintre. Cette construction temporelle, qui progresse vers le dénouement tout en multipliant les retours en arrière, mime le processus créateur de Cézanne lui-même : ces couches successives de couleur qui, par leur accumulation patiente, finissent par faire surgir la profondeur.
Marina Seretti fait vibrer la matérialité du geste pictural – “Des frottements pour les aplats. Le bruit du crayon sur le papier” – tout en explorant ses résonances métaphysiques. Lorsque Cézanne explique à Bernard la nécessité d’introduire “une somme suffisante de Bleutés” dans les vibrations lumineuses, l’auteure transforme cette leçon technique en révélation poétique sur la respiration même du visible. Les intercalaires intitulés “aquarelles”, qui scandent le récit en évoquant les ères géologiques, ancrent la quête cézannienne dans une temporalité vertigineuse où “la montagne ouvre les yeux” après quarante millions d’années de gestation minérale.
L’écriture elle-même participe de cette alchimie : phrases qui s’enroulent comme les volutes de fumée montant du tilleul des Lauves, accumulations chromatiques dignes du peintre (“gris-jaune, gris sapin, gris-turquoise, indigo, presque violet”), métaphores géologiques qui transforment les baigneuses en affleurements rocheux et les rochers en corps endormis. Marina Seretti parvient à créer une prose qui respire au rythme de la peinture cézannienne, alternant touches rapides et plages méditatives, éclats de couleur pure et zones d’indétermination féconde.
Au cœur du récit pulse l’obsession du tableau inachevé, cette Montagne Sainte-Victoire et Château Noir conservée aujourd’hui au musée Artizon de Tokyo, que Cézanne reprenait sans cesse entre 1904 et 1906. Seretti en fait le protagoniste silencieux du livre : “Le tableau est un œil”, écrit Émile Bernard dans son journal, saisissant cette réciprocité du regard qui transforme l’observateur en objet de contemplation. Cette toile qui regarde autant qu’elle est regardée devient l’emblème d’un art qui a renoncé à la représentation pour atteindre ce que Merleau-Ponty nommera “cette vision qui va jusqu’aux racines”.
Marina Seretti réussit le pari de faire entendre, à travers les voix multiples qui l’ont approché, la solitude essentielle de Cézanne, cette “solitude d’absolu” qu’évoque Émile Bernard. En mêlant documents authentiques et fiction maîtrisée, elle compose un tombeau littéraire où le peintre continue de chercher, dans l’épaisseur du temps et la vibration des couleurs, cette vérité première que seul l’art peut approcher sans jamais la saisir tout à fait.