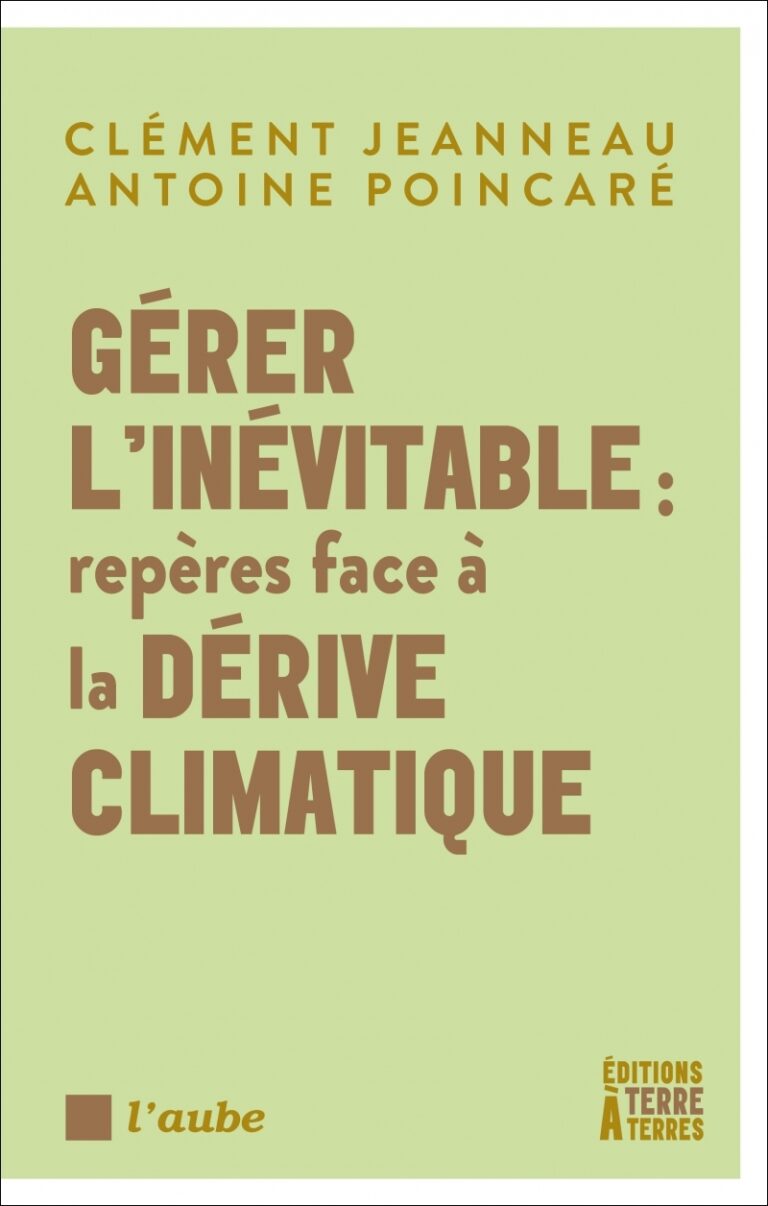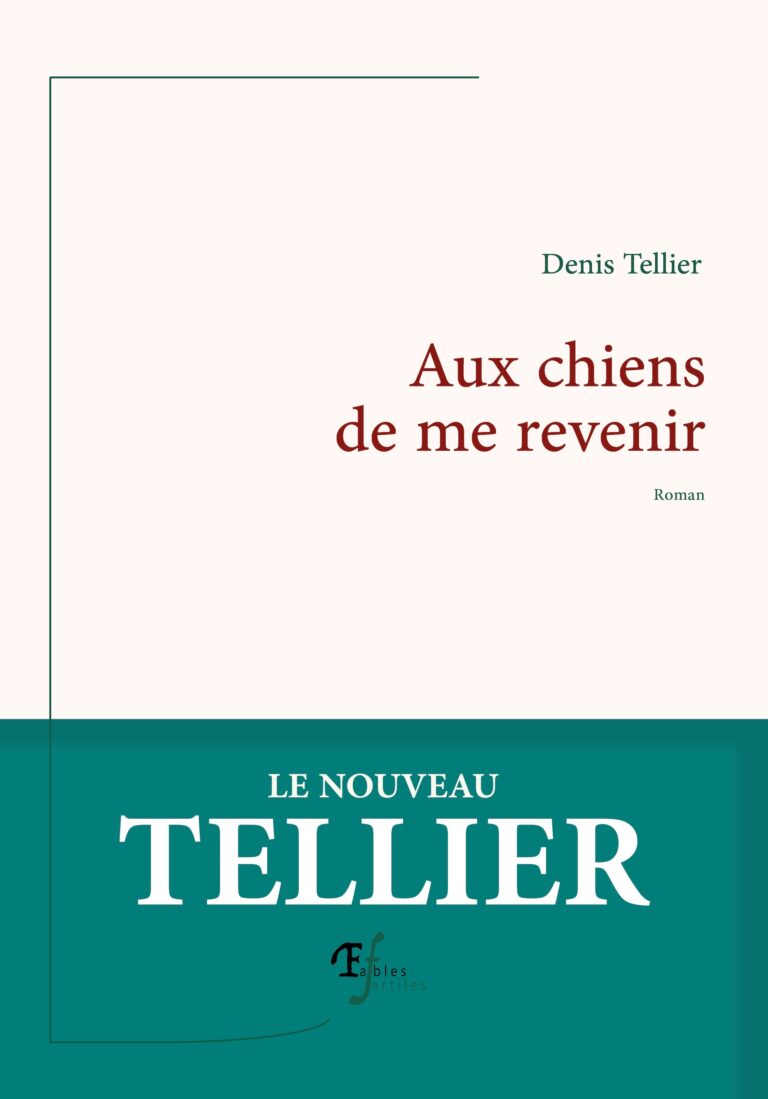Marion Dapsance, Le bouddhisme des bouddhistes – La véritable religion des Asiatiques, Le Cerf, 25/01/2024, 185p. 19€
L’ouvrage de Marion Dapsance nous propose un effort salutaire a priori : sortir des stéréotypes inconscients que la plupart d’entre nous, Occidentaux, avons construits et projetons sur les Bouddhismes et les Bouddhistes. Il est en effet toujours périlleux et incertain de construire une compréhension trans- ou interculturelle de pratiques, de coutumes, plus encore de spiritualités, qui nous sont lointaines dans l’espace, dans le temps et quant à leur univers symbolique de référence. Dès l’introduction l’autrice annonce cette orientation critique que l’on ne peut que trouver stimulante.
L’ouvrage a également la qualité de ne pas se limiter à une zone géographique ou un pays, ni à une tendance ou une école particulière du Bouddhisme. Au long des chapitres, le lecteur voyage dans différents univers bouddhiques et, en même temps, dans différents pays où telle école ou tendance est prédominante. De façon astucieuse le livre est construit, globalement, sur une logique géographique : à chaque chapitre correspond un ou plusieurs cadres territoriaux bien identifiés et un Bouddhisme particulier. Ainsi, le lecteur se trouve projeté une ou plusieurs fois au Sri Lanka, en Chine, au Japon, en Thaïlande, au Tibet. Seul le chapitre VII semble plus hétérogène de ce point de vue (Inde, Sri Lanka, Myanmar, Thaïlande). Sont cependant absents de ce vaste panorama le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Corée du Sud, la Mongolie et quelques zones spécifiques. L’auteur couvre néanmoins un assez vaste champ en termes d’aires culturelles et linguistiques. Nous n’en évoquerons qu’une partie dans cette chronique.
L’ouvrage bénéficie d’une très large documentation, ce qui est appréciable. Sa lecture permet d’apprendre beaucoup de choses sur les différents Bouddhismes dans les pays où ils ont un rôle social, spirituel ou politique majeur. Nous ne sommes, comme lecteur non spécialiste, pas en mesure d’évaluer cette documentation et sa pertinence, sauf pour un point sur lequel nous reviendrons ci-dessous.
Bouddhisme et “exercices spirituels” antiques
La lecture de l’ouvrage permet – comme pour bien des religions ou philosophies orientales – de tirer une passerelle entre Asie et Europe, autour du concept développé par Pierre Hadot “d’exercice spirituel”. La grande force des spiritualités asiatiques, quelle qu’en soit la forme, est de se concentrer non sur l’énoncé du but à atteindre, ni sur la valeur comparative des idées et des arguments, mais sur le “comment ?”. Plus précisément, comment obtenir une transformation intérieure du pratiquant, de l’adepte, du croyant, du religieux comme du laïque ?
Ainsi, le Visuddhimagga (pâli) propose treize pratiques ascétiques (71) que, pour certaines, n’auraient pas désavoué des courants aussi différents que les Cyniques (vivre en plein air, se contenter de n’importe quelle habitation, quêter la nourriture de la journée) ou certains ascètes chrétiens (ne manger qu’une seule fois par jour, vivre dans la forêt, ne porter que des vêtements monastiques). L’Amitâyurdyâna Sûtra (Sûtra des contemplations du Bouddha Vie Infinie, Ve siècle de l’e.c.), quant à lui, propose des méthodes de contemplation (35).
Cette passerelle que permet de tirer le concept d’exercice spirituel entre Asie orientale et Europe ne s’arrête pourtant pas aux exercices eux-mêmes. Au fil des pages, le lecteur attentif trouve quelques échos assez stimulants entre les deux mondes. Ainsi, l’autrice rappelle des fondamentaux du Bouddhisme, comme à propos du Mahâyâna. Elle rappelle que les bodhisattvas ont éliminé en eux-mêmes l’ignorance, l’avidité et l’aversion (42). Comment ne pas y voir un écho des conceptions antiques européennes et plus précisément des vices qui ont pu être désignés par les mots “acédie”, “envie” et “irascibilité” ? Le bodhisattva, comme le sage gréco-romain, est en effet un être qui a su se délivrer des vices (au sens antique du terme) et atteindre l’ἀκακία (innocence, simplicité), dont l’étymologie renvoie à ἄκακος (sans méchanceté, sans malice, ingénu, simple) par le privatif de ce qui est “sans vices”, “sans malice”, donc bon, vertueux, sage.
Les vices apparaissent aussi sous une autre image et une autre terminologie : celles des “chaînes”. Dans la tradition thaïlandaise (que l’on retrouve dans tout le sud-est asiatique, excepté le Vietnam), l’arhat est celui qui s’est délivré de dix “chaînes” (67) qui sonnent comme autant de “vices” au sens antique, c’est-à-dire de travers ou de faiblesses intérieures qui apportent les maux et le malheur, à soi et aux autres. Dans la liste donnée par l’autrice, certains sont des “classiques” : l’orgueil et l’ignorance en particulier.
On est surpris des échos parfois étroits entre tels ou tels enseignements du Bouddhisme et telle ou telle école philosophique de l’Antiquité. Par exemple, de la résonnance entre la première des “quatre pensées incommensurables” (114) et la Maxime capitale première d’Epicure : équanimité, absence d’attachement, absence de colère. Sans compter l’insistance commune, chacun avec ses mots et dans sa culture, sur l’impermanence de l’agrégat corporel et mental (135). Les deux courants – Bouddhisme et Epicurisme – portent également une grande attention à l’effort de mémorisation de l’enseignement (136) en vue, effectivement, de “se rappeler”, de “garder à l’esprit”, autrement dit de maintenir (dans) la conscience. L’autrice en vient elle-même à considérer l’atome comme possiblement “la seule réalité concevable pour le bouddhisme” (143). Au demeurant, les résonnances entre Bouddhisme et Epicurisme sont connues (Christophe Richard, 2012). D’autres aspects du Bouddhisme semblent plutôt faire écho à des enseignements de Pyrrhon d’Elis, comme l’entrainement d’une certaine forme d’indifférence aux phénomènes (145).
Les Yamabushi : une forme syncrétiste du Bouddhisme au Japon
L’autrice s’intéresse à des formes rares et fort singulières de bouddhisme, comme le Shugendô au Japon (54). Mais elle ne semble pas en connaître ou en mesurer le lien étroit avec les arts martiaux classiques japonais. Pourtant, c’est de notoriété publique au Japon (du moins dans le milieu des arts martiaux classiques, i.e. : non-sportifs) : bien des écoles ont tissé un lien avec ces milieux tournés vers une forme singulière d’ascétisme montagnard.
Une école ancienne (XVe siècle) et célèbre, la Tenshin Shôden Katori Shintô Ryû (enseignant une douzaine de techniques de combat réel), a été influencée par une école bouddhiste appelée Shingon (fondée au IXe siècle) et dont parle l’autrice (171). Mais d’autres arts martiaux ou écoles classiques (koryû) ont été ou restent directement liés aux milieux du Shugendô. C’est le cas de certaines écoles anciennes de Ninjutsu (le lecteur pourra s’intéresser au parcours d’un Français comme monsieur Sylvain Guintard). C’est aussi le cas de certaines écoles de Karaté classique métropolitaines (le Karaté est originaire d’Okinawa où le Bouddhisme n’a historiquement pas joué de rôle important. La progression récente de certaines sectes bouddhistes fait évoluer la situation). Citons, par exemple, Tsuneyoshi Ogura (1924-2007) du Gembukan. Ce maître a joué un rôle important – quoique restant plutôt dans l’ombre – dans l’histoire du Karaté au Japon et en France. Une importante facette de sa pratique (à la fois à des fins martiales et à des fins spirituelles) était le Shugendô ; facette de la pratique qu’il partageait avec un autre maître connu de Karaté : Gôgen Yamaguchi du Gojû-ryû.
Ce qui est intéressant dans ces pratiques bouddhistes, dites “ésotériques”, pour des adeptes des arts martiaux classiques, c’est que ce sont des pratiques qui permettent d’amplifier – parfois considérablement – leurs possibilités corporelles par un travail mental réalisé dans un autre cadre. Les pratiques de méditation, de concentration mais aussi d’identification, voire de possession, en lien avec des visualisations de déités bouddhistes et des épreuves physiques (certaines dangereuses) représentent un grand potentiel de surpassement ou de rehaussement des aptitudes physiques communes. Cela ne concerne pas que la force physique, mais aussi les aptitudes en termes de vitesse des gestes et des déplacements, de précision et de coordination également ; d’endurance dans certains cas ; et encore l’appréhension psychique de la violence léthale.
Les arts martiaux sont donc un angle mort dans cet ouvrage alors que dans bien des écoles classiques, en Chine comme au Japon, les références au Bouddhisme foisonnent. Le caractère syncrétiste du Shugendô est également insuffisamment mis en avant. En effet, l’influence du Shintô est avérée : elle se manifeste notamment par les références nombreuses à ses déités propres que sont les kami. C’est aussi une spiritualité dans laquelle la dimension chamanique des pratiques reste très forte, tournée vers le contact avec les “esprits de la nature”. Cela explique sans doute toute la singularité du Shugendô dans le vaste panorama des Bouddhismes.
Bouddhisme et initiation
Un autre aspect de certains bouddhismes est mis en évidence dans l’ouvrage : la notion d’initiation (concernant en particulier le Mahâyâna et le Vajrayâna). Ces processus d’initiation, et les cérémonies qui les accomplissent, passent donc forcément par des rituels… comme dans la Franc-maçonnerie encore aujourd’hui. Dans les deux cas, il s’agit, lors des cérémonies, de “transferts” de qualités, de “pouvoirs”, d’enseignements. Les deux traditions spirituelles présentent des outils parallèles : les francs-maçons ont le tapis de loge (représentation imagée de leur univers symbolique et de ses enseignements) tandis que les bouddhistes ont le mandala ; l’un de leurs points communs est d’ailleurs dans le recours et la référence à la Géométrie.
Dans la franc-maçonnerie aussi, le récipiendaire “entre” dans les cérémonies et dans les supports visuels dans le but de se transformer en s’identifiant à l’Homme sage et juste (Hiram). Les figures d’identification présentent des différences sensibles mais les “procédés” ont des ressemblances intéressantes et se font écho. L’autrice parle à raison de “transformation alchimique” en montrant le lien avec des procédés associant “les formules, les gestes et les actions”. La grande différence est sans doute dans ce que les uns s’approprient leurs cérémonies par une interprétation symbolique tandis que les autres, ou certains d’entre eux, y mêlent une pensée et une sensibilité magique ou religieuse.
On retrouve une autre importante passerelle sur la question de la performativité des rituels, bouddhistes ou maçonniques : “on est bouddha au moment même où l’on réalise correctement le bon rituel, parce que pratiquer ces rituels, précisément, c’est être bouddha” (96). Cela est bien proche de ce que “font” les Francs-maçons avec la figure purement mythique du maître Hiram. Et encore, quelques pages plus loin, toujours à propos des rituels : “Il convient donc de les accomplir avec sérieux, en faisant “comme si” tout était absolument vrai” (101, 154) … justement pour que cela le soit. C’est justement l’un des principes-clés sur lesquels reposent la performativité des rituels initiatiques depuis l’Antiquité (il était alors question des « religions à mystères”).
Quelques réserves cependant
Mais l’ensemble de l’ouvrage peut laisser le lecteur dans une sorte de malaise. Tout d’abord, l’on s’interroge : pourquoi si peu de références bibliographiques en Français ? Pourquoi tant de références anglophones ? On est pris de doute à se demander si réellement aucun chercheur français, ou si peu, n’a écrit quelque chose d’intéressant et de défendable sur les Bouddhismes (par exemple au sein de l’École Française d’Extrême-Orient).
Ensuite, l’autrice souligne la part très importante de ce qui se peut qualifier de superstitions, de religiosité populaire et de pratiques magiques. C’est factuellement recevable. Mais cela disqualifie-t-il d’autre facettes du Bouddhisme et des Bouddhistes ? Ainsi, il y eu aussi de grands philosophes et de grands sages qui, comme en Occident, ont vu leur héritage souvent travesti ou oublié. Cela ne signifie pas que quand les Occidentaux s’intéressent à eux, ils soient “hors du réel”.
Les pratiques sur lesquelles se concentre l’autrice ont existé et existent toujours dans le Christianisme occidental sous des formes homologues. Il suffit de visiter quelques sanctuaires chrétiens à travers l’Europe pour s’en rendre compte. Cela occulte-t-il pour autant l’existence, la valeur et l’influence des grands théologiens et des grands philosophes ainsi que de leurs disputatio ? Est-ce que Socrate ou Descartes doivent être occultés et l’intérêt que leur ont porté et leur portent d’innombrables personnes recherchant leur propre voie spirituelle sous le prétexte des pratiques votives de Lourdes ou de Lisieux ou encore sous le prétexte de telle ou telle pensée magique sur le divin ?
En outre, on est étonné que le rapport entre les pratiques mises en avant et le chamanisme n’apparait, étrangement, que page 158, c’est-à-dire vers la fin du livre. Pourtant, bien des descriptions de pratiques ou de cérémonies y font penser. L’examen de la dimension chamanique – sans doute héritée d’autres praxis spirituelles, antérieures ou historiquement parallèles – aurait probablement enrichi l’analyse d’ensemble des Bouddhismes, des Bouddhistes et de leurs pratiques.
Enfin, on reste pantois quant à la tonalité franchement agressive de la conclusion, voire antibouddhiste tant le discours tenu par l’autrice apparait ouvertement dévalorisant. Le Bouddhisme est présenté comme un « nihilisme » (180). Mais la transformation permanente du Tout et de tout, le caractère éphémère de tout ce que nous percevons, ce n’est pas « rien » (il faut relire Lucrèce).
L’autrice accuse également le Bouddhisme de méconnaître le principe de non-contradiction (attribué un peu vite à Aristote), confondant le discours philosophique et l’agir spirituel. Il se peut pourtant, il se peut souvent d’ailleurs, que l’idée à “utiliser” pour produire un changement en soi-même ait des contradictions apparentes avec la téléologie de celui-ci ; téléologie qui, de plus, n’est pas toujours clairement formulée dans un langage logique, à la façon des Européens. Cela doit-il mener à jeter tel ou tel Bouddhisme ou le Bouddhisme tout entier aux orties ?
Le Bouddhisme est même taxé d’anti-intellectualisme (182). Si la pratique de Bouddha et de nombre de ses disciples et successeurs ne semble pas avoir été structurée prioritairement par l’exercice du logos, faut-il pour autant nier les authentiques philosophes que le Bouddhisme a produits ? Et Asvaghosa ? Et Nâgârjuna (que l’on tient pour un grand dialecticien : voir Nâgârjuna – Mettre fin aux controverses aux Editions du Cerf, traduit et commenté par Michel Bitbol) ? Et Dharmakîrti ?
Les excès de la conclusion créent un doute sur les buts réellement poursuivis par l’autrice à travers ce livre.