Vingt stations. Ce titre énigmatique, qui pourrait évoquer un chemin de croix (et c’en est un, d’une certaine manière, même s’il ne s’agit pas de la religion chrétienne), raconte l’errance du protagoniste du récit, auquel les diverses stations de tramway servent de point de départ à une introspection, déclinée sous forme d’un long “flash-back” linéaire, qui retrace les événements importants de sa vie. Par sa forme circulaire, qui opère toujours un retour au présent, le “flash-back” enferme la narration dans un système aussi clos que celui d’une tragédie grecque : tout est déjà passé, nul ne pourra changer le cours des événements.
La mémoire du narrateur peut être déclenchée par un lieu, un visage, une odeur, (comme celles des épices, dégagée par une femme qui lui rappelle sa grand-mère, et disparaît à la station suivante, laissant un sillage olfactif), ou une sensation auditive (le livre abonde en notations sensorielles).
Le bruit de ferraille en profite pour cadencer mes pensées et me permet de remonter le vieux réveil que j’ai gardé pour emprisonner le temps et m’empêcher de grandir. Un cran, un claquement métallique… Je réglais chaque soir sur sept heures du matin la machine en fer-blanc couleur bleu céladon, made in Taïwan, surmontée de ses deux cloches infernales. Sa sonnerie diabolique suffisait à me faire détester l’école.
Le tramway, ici décrit comme le mode de déplacement des plus pauvres (les classes moyennes lui préfèrent le taxi et les gens aisés la voiture individuelle), atteste la déchéance du héros, qu’un événement tragique a conduit à la clochardisation. Celui-ci remonte le temps, en partant de son enfance jusqu’au moment présent. Il dresse la figure d’un homme sensible, mal aimé de ses parents, un père volage et alcoolique, une grand-mère odieuse, une mère aux mœurs légères, et harcelé à l’école, mais qui puise son réconfort dans la lumineuse et sensuelle présence de Nedjma, avec laquelle il vivra une grande histoire d’amour.
Le film brosse un tableau sans concession de la condition des femmes, sujettes à la maltraitance ou la répudiation, mariées toutes jeunes à des vieillards, vendues sans état d’âme par leurs mères pour améliorer leur quotidien. Il dénonce avec vigueur leur statut, mais sans manichéisme, et dresse de certaines d’entre elles des portraits peu sympathiques. Elles apparaissent comme les produits d’un système qui les opprime et que paradoxalement certaines, comme la grand-mère, contribuent à perpétuer. Quelques-unes ont obtenu du régime politique actuel de minuscules concessions, comme la jeune fille voilée qui fait un selfie dans le tramway :
… les femmes ont négocié une liberté bien dérisoire, consistant pour la plupart à sortir maquillées tout en acceptant de cacher leurs cheveux sous un carré de tissu et leurs corps dans des vêtements amples et de couleur sombre.
Celles qui s’y refusent finiront tôt ou tard par capituler, pour éviter le harcèlement sexuel des hommes et “les remontrances des autres filles, jalouses de paraître moins sexy dans leurs habits informes de nonnes musulmanes”. Beaucoup font des études, qui constituent un “répit de quelques années avant la condamnation ultime : la sanction du mariage et les maternités consécutives”, heureux moments d’insouciance que l’auteur compare à “la dernière clope du condamné”. L’image de la prison demeure omniprésente, et l’auteur appelle les autres conscrits, lorsqu’il effectue son service militaire, “mes codétenus”.
En effet, l’action se déroule en grande partie dans l’Algérie des années noires, et la ville, jamais nommée, sauf dans la dernière phrase du livre, “Je n’avais jamais pris le tramway d’Oran avant ce matin”, sert de cadre à la violence perpétrée par le GIA, expéditions punitives et chasses à l’homme, souvent dirigées contre les étudiants qui représentent l’avenir intellectuel du pays. Celui-ci n’est jamais désigné sous ce terme, l’auteur préférant parler de “barbus” ou de “frères” (le nom qu’ils se donnent à eux-mêmes), ou encore, de “hipsters aux mains tachées de sang”, qui s’opposent aux “ninjas”, les unités d’élite de la police, pendant la guerre civile). La violence y apparaît insoutenable, après celle qui s’exerce envers les enfants et les femmes, et revêt ici un nouveau visage, prenant pour se légitimer le prétexte de la religion. Les couples non mariés sont des victimes désignées, la police puis les islamistes s’adonnant à une répression féroce du vice, car, comme le précise l’auteur avec une ironie glacée : “Ils traquaient ainsi les dangereux couples d’amoureux pour les battre ou bien prélevaient leur impôt révolutionnaire directement en violant la fille sous les yeux du garçon pour qu’ils retiennent la leçon.” Dans tous les cas, ceux qui perpètrent la violence dans le livre, que ce soit au nom d’une simple cruauté enfantine, des forces de l’ordre ou de Dieu, sont désignés sous le nom de “meute”. Le terme renvoie à une masse anonyme, agressive, prête à mordre, dépecer ou tuer ses victimes, et animalise ceux qui s’y adonnent, avec une intention extrêmement péjorative, le chien étant synonyme d’impureté dans la religion musulmane, ce qui réactive la force d’une expression devenue banale, que le livre ne cesse de réitérer. La monstruosité s’exprime également par l’image de l’ogre, ou de l’ogresse, dont l’activité principale se concentre sur la dévoration, et qui hante le récit. Les islamistes ont causé une désertion massive du pays, les riches faisant des études dans des filières prometteuses à l’étranger, tandis que les pauvres embarquaient, à leurs risques des périls, dans des bateaux gonflables. Pour le protagoniste, le rêve d’un grand jardin fertile se réduit à l’image d’un unique citronnier qui finit par mourir, et la déliquescence du pays s’exprime dans l’image d’une place vouée aux tags et aux détritus, d’où s’élèvent des emballages de bonbons emportés par le vent, avec pour seul témoin un balayeur hypnotisé, dont l’écrivain décrit ainsi le mouvement ascensionnel :
…s’élevant dans un tournoiement léger, presque hypnotique, qui achève de donner des airs dérisoires à cette place. La spirale monte et disperse le tout en confettis joyeux. Pourquoi aller ramasser ces lucioles magiques ?
L’écriture sobre et efficace d’Ahmed Tiab renforce l’émotion de ce récit tragique, sur fonds politique et religieux (les deux apparaissant étroitement mêlés) qui entraîne le lecteur dans un constat impitoyable, celui d’un pays qui a payé sa paix sociale au prix d’une loi d’amnistie qu’il dénonce dans son livre, car elle implique une forme d’amnésie, celle des victimes sacrifiées par le terrorisme, parfois directement, parfois indirectement, en tant que dommages collatéraux. Le lieu, témoin de tant d’horreurs et gangrené par la drogue, paraît sans charme, sans mémoire ni avenir :
Le temps s’étire et m’étrangle. Dans cette ville, il n’y a jamais de touristes. Il n’y a rien à admirer, ni à photographier. Pas de monuments à la gloire des hommes, encore moins à celle des femmes. Les seules ruines historiques, vestiges d’une occupation étrangère lointaine, sont surpeuplées. Bâtisses bourgeoises, construites par l’occupant. Elles s’effritent, tombent en miettes, mêlent la poudre du ciment pourrissant de leurs murs à la poussière rouge de la terre africaine, triomphante et féconde. Seules de tristes nostalgies s’expriment parfois à travers de rares visiteurs à la recherche d’un parfum, d’un souvenir d’enfance heureuse, de rues dont les noms ont été changés afin de mieux se perdre dans le dédale, sous les yeux d’autochtones indifférents.
Un peu plus loin il ajoute :
Oui, cette ville manque de monuments. Elle manque de lieux dédiés aux gloires. Ni hommes politiques illustres, ni poètes à honorer au centre des squares. Ils ont jeté aux oubliettes les héros populaires, comme ils ont assassiné les chanteurs et les hommes de théâtre. Les places ne portent pas les noms des hommes et des femmes lettrés, d’artistes ou de médecins, seuls les martyrs de la révolution y ont droit… Je ne suis pas un touriste, je suis un visiteur errant dans une ville sans autre mémoire que celle portée par le sang et rendue par les armes.
Cet effacement de la mémoire s’avère l’antithèse de la démarche du héros, s’efforçant de recomposer les fragments de sa propre vie, et de faire revivre les êtres aimés. Le narrateur évolue au fil du temps. D’abord enfant maltraité, puis adolescent insolent, affirmant son désir de liberté et sa recherche du bonheur, il apparaît enfin, quand débute le roman, comme un homme brisé par une tragédie personnelle et collective, celle d’un individu qui se confond avec celle de son pays dont il épouse le destin. Plein d’émotion et de sensibilité, réflexion sur l’Algérie actuelle et ses dérives (difficultés économiques, jeunesse en souffrance ou répression sociale), le livre d’Ahmed Tiab plaide en faveur des plus faibles, les enfants et les femmes, mais aussi des intellectuels et des artistes, de la modernité et de la liberté. L’auteur vit aujourd’hui en France mais retourne régulièrement à Oran, sa ville natale. Après avoir publié des romans policiers, il livre dans ce récit, sans doute le plus personnel, l’émouvant portrait d’un pays autrefois déchiré, dont les cicatrices ne sont pas encore refermées.
Marion Poirson-Dechonne
articles@marenostrum.pm
Tiab, Ahmed, “Vingt stations”, Ed. de l’Aube, “Regards croisés”, 08/04/2021, “1 vol. (203 p.), 19,90€.
Retrouvez cet ouvrage chez votre LIBRAIRE et sur le site de L’ÉDITEUR
Faire un don
Vos dons nous permettent de faire vivre les libraires indépendants ! Tous les livres financés par l’association seront offerts, en retour, à des associations ou aux médiathèques de nos villages. Les sommes récoltées permettent en plus de garantir l’indépendance de nos chroniques et un site sans publicité.





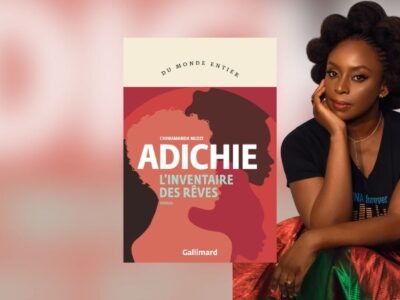
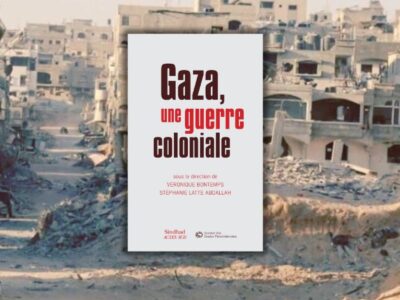
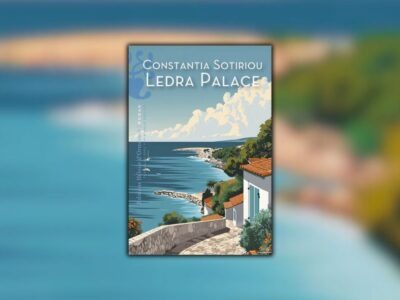


Do you mind if I quote a couple of your posts
as long as I provide credit and sources back to your site?
My blog is in the very same niche as yours and my users would
definitely benefit from a lot of the information you provide
here. Please let me know if this ok with you. Cheers!