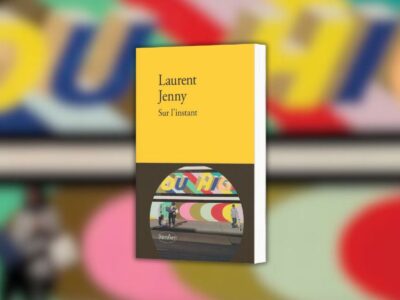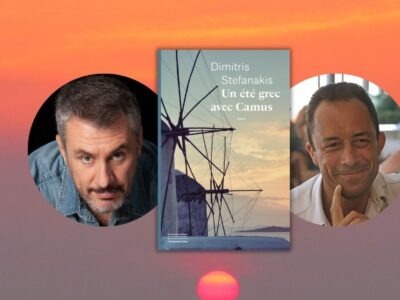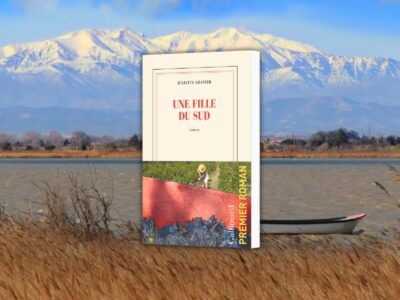Un titre en forme de métaphore. La saison qu’il évoque est restée dans l’histoire sous le nom de printemps arabe, et les oiseaux aux ailes brisées renvoient aux combattants pour la liberté. L’action du livre de Marion Guénard, fondée sur les événements de la place Tahrir et leurs conséquences, se déroule essentiellement en Égypte. Deux figures de femmes que tout pourrait sembler opposer interviennent alternativement au fil des chapitres. Kaouthar, la première, rend visite à son frère Hassan, à la prison Scorpion, dans l’entame du roman, avec son fils Mohamed. Elle est issue d’une famille qui appartient à la mouvance des Frères Musulmans et porte le voile. Au moment des faits, elle a fait preuve d’un esprit de rébellion en allant manifester place Tahrir, en dépit du mot d’ordre des Frères, où elle a rencontré Ashraf, incarnation de l’esprit révolutionnaire, qu’elle a épousé. Le début du livre s’attarde longuement sur l’atmosphère d’espoir et de liberté qui règne sur la place, comme pour mieux la mettre en opposition avec le climat anxiogène du pays, qui règne dix ans après. Cette période a constitué pour la jeune femme l’apprentissage de la sexualité, et motivé son désir de devenir sage-femme. Mais la suite des événements a changé Ashraf, qui passe son temps à traîner devant la télévision et à boire. Quant à Mohamed, né de leur union, il reproche à ses parents leur manque d’engagement politique.
Mariam, la deuxième figure féminine forte, est une jeune femme issue de l’immigration, qui s’est attachée à satisfaire ses parents par une intégration réussie. Elle a coupé tout lien avec l’Égypte avec la mort de sa grand-mère, a passé l’examen du barreau, puis a épousé Antoine, et donné naissance à leurs deux filles. Elle incarne la modernité. Elle a nourri sa quête identitaire de la lecture de Franz Fanon et du livre d’Angela Davis, “Femme, race et classe”, prêté par un professeur et jamais rendu. Elle a suivi l’actualité égyptienne à l’époque du printemps arabe, avec son amie Amal, étudiante à Paris, née dans une riche famille cairote, qui vit dans une somptueuse maison des beaux quartiers de la capitale et héberge les fugitifs. Ces événements ont réactivé l’attachement de Mariam à son pays d’origine, lui rappelant des souvenirs oubliés. Puis elle a semblé s’en désintéresser, jusqu’à sa disparition. Son époux tente de comprendre pour quelle raison elle est retournée dans son pays natal, et entreprend le voyage dans ce but. Pourquoi Mariam, à qui tout paraît avoir réussi, opère-t-elle ce choix ? Quel élément déclencheur l’a poussée à tout quitter ?
Aux côtés de ces deux figures féminines évoluent des personnages secondaires, Amal et Halim, les militants, Ashraf le désabusé, qui s’enfonce dans la boisson et se montre parfois violent, Mohamed le jeune rebelle inconscient du danger, qui n’hésite pas à jeter des cailloux sur la police, et ses amis. L’espoir nourri par les événements de la place Tahrir s’est heurté à une impitoyable prise de pouvoir par l’armée égyptienne, dont le chef suprême n’est jamais nommé. Marion Guénard ne l’appelle jamais par son nom, préférant le désigner par sa fonction militaire, Le Maréchal, en jouant sur un terme qui rappelle aux lecteurs français les années sombres du régime de Vichy. Le livre doit beaucoup à sa connaissance du pays, où elle a exercé pendant dix ans le métier de journaliste. Sa connaissance du terrain, du contexte politique et économique et des gens lui permet de dresser un tableau implacable de la réalité égyptienne contemporaine. Le texte français, pour plus d’authenticité, est ponctué d’expressions calligraphiées en arabe. L’atmosphère de la prison, dès l’incipit du récit, donne le ton :
On les (les visiteurs) guidait comme des bêtes qu’on mène à l’abattoir, froidement, sans les voir, à coups de bâton si nécessaire. Là encore, ils avaient dû attendre plusieurs heures sous un toit de tôle offert aux courants d’air. On les avait fouillés, on leur avait tout pris, les boîtes de conserve et la nourriture qu’ils transportaient depuis le matin, la force qui leur restait. Quand ils entrèrent enfin dans le cœur du complexe pénitentiaire, Scorpion, prison dans la prison, ce bloc ultra-sécurisé, réservé aux pires ennemis de l’Etat, ils étaient comme nus, absolument démunis. Plus rien ne les protégeait. Ils étaient aux prises avec la bête.
L’emploi du “on” qui déshumanise et les métaphores animalières permettent d’installer un climat spécifique qui se retrouve aussi à l’extérieur de la prison. En effet, le roman parle de la peur suscitée par la dictature. De la destruction des personnalités comme celles d’Ashraf, l’époux de Kaouthar, qui sombre peu à peu dans la dépression. De la propagande diffusée par la radio d’Etat, dominée par la figure du Maréchal qui s’attache à dénoncer l’ennemi aux frontières, décorer les martyrs ou se présenter comme le pourfendeur du terrorisme, supporté par l’armée et la police. De l’incitation à la délation. Le livre retrace aussi l’historique de ces dix années marquées par la violence et les abus de pouvoir. Les Frères musulmans portent une grande part de responsabilité. Kaouthar découvre les conséquences d’une répression sanglante, après un des nombreux sit-in organisés par le mouvement.
Les rues étaient désertes. Kaouthar terrorisée par le silence. En quelques heures, les forces d’intervention spéciales de l’armée égyptienne tuèrent près de mille personnes. Des pères, des mères, des enfants que les Frères, pourtant conscients du danger, avaient envoyés au massacre.
D’une plume simple et efficace, Marion Guénard décrit l’horreur, l’odeur suffocante du plastique brûlé, la cendre, les débris, les douilles de balles parsemant le sol, les semelles des chaussures de Kaouthar, “lestées d’une boue visqueuse” qui s’avère être du sang, le sol de la mosquée jonché de cadavres, les mouches, les bombes de désodorisant qu’on vaporise “pour atténuer l’odeur douceâtre de la pourriture”, ou l’image d’un bébé mort dans les bras de sa mère.
Les arrestations préventives, la banalisation de la torture avaient été dénoncées au début du printemps arabe par la jeunesse un vingt-cinq janvier, date choisie par le gouvernement, dix ans après les faits, pour célébrer la fête de la police, par un renversement ironique. Le pays aujourd’hui dominé par la censure s’apparente à une dystopie, dont le modèle serait “1984”, de Georges Orwell. Un livre dont Kaouthar relit régulièrement des pages.
Elle a lu “1984”. Le livre circulait sous les tentes de Tahrir. C’était Ashraf le premier qui lui en avait parlé, avec son enthousiasme habituel. Dans les mois qui suivirent la révolution, on trouvait l’ouvrage partout dans les cafés, les kiosques à journaux, à même le trottoir aux pieds des vendeurs ambulants. 1984 était devenu le livre de chevet de toute une nation. Au lendemain du coup d’état, aussi rapidement qu’il était apparu, il avait disparu de la voie publique.
Le roman montre aussi l’engagement des femmes au cours des révolutions arabes. Pour Mariam comme pour Kaouthar, la conscience politique passe par la découverte du féminisme. Kaouthar se montre plus forte que son mari dans l’épreuve, et Mariam porte seule le poids de ce qui la hante. Une inversion toutefois les oppose : Kaouthar cherche Ashraf, qui a disparu, tandis que Mariam a disparu volontairement, et c’est Antoine qui se lance à sa recherche. En toile de fond, la ville du Caire se déploie sous le regard de ce dernier, perdu dans une mégalopole qu’il ne connaît pas, et s’apparente pour lui à un labyrinthe prêt à l’engloutir, le laissant étrangement passif.
Tous savent se déplacer, quelle trajectoire emprunter dans ce chaos familier. Tous sauf Antoine, qui, toujours immobile, n’a pas le mode d’emploi. Il voudrait quitter cet angle de bitume où il semble condamné à rester pour toujours.
La ville apparaît comme un concentré de sensations agressives, bruits des klaxons, cris des marchands ambulants, “odeur écœurante de mazout et d’huile”, grossièreté lorsque Antoine se montre “effaré même par ces bouches ouvertes qui mastiquent et vocifèrent en même temps”, crachats, postillons, saleté des pieds nus dans les sandales en plastique, avec “le noir et la crasse incrustés jusque sous les ongles”. Loin des clichés touristiques, Marion Guénard décrit une capitale surpeuplée, qui grouille et vit, en dépit de la chape de plomb qui l’oppresse.
Anna Roussillon, qui a passé son enfance en Égypte, dans “Je suis le peuple”, un très beau documentaire, plusieurs fois primé, multipliant les témoignages forts, a montré le désenchantement des paysans du sud après l’espérance de la place Tahrir. Marion Guénard a recours à la fiction pour nous emmener au plus près de ces dix années vécues par le peuple égyptien. Elle nous permet de comprendre la complexité de l’histoire de ce pays tout au long ces dernières années. Les remerciements de la fin, adressés aux vivants comme aux disparus, sont emplis d’une grande force émotionnelle. Il est probable que certains des dédicataires aient inspiré les personnages du roman. Un livre fort et émouvant, qui donne le point de vue de ceux qui ont vécu le printemps arabe, et ont vu leur révolution confisquée par le gouvernement en place. Une leçon de géopolitique, portée par des personnages nuancés, attachants et sans manichéisme, qui permet de comprendre les difficultés de l’Égypte actuelle et les dérives du pouvoir.
Marion Poirson-Dechonne
articles@marenostrum.pm
Guénard, Marion, “Au printemps on coupe les ailes des oiseaux”, Ed. de l’Aube”, Regards croisés”, 06/01/2022, 1 vol. (304 p.), 20€
Retrouvez cet ouvrage chez votre LIBRAIRE et sur le site de L’ÉDITEUR
Faire un don
Vos dons nous permettent de faire vivre les libraires indépendants ! Tous les livres financés par l’association seront offerts, en retour, à des associations ou aux médiathèques de nos villages. Les sommes récoltées permettent en plus de garantir l’indépendance de nos chroniques et un site sans publicité.